Che.r.es ami.e.s,
Je vous transmets ici les informations concernant les rencontres de la « Fabrique du dire » qui a lieu les 14 et 15 mars 2026, à la Clinique de la Toussaint – Strasbourg. Cette année, il sera question des « Écritures du Réel… Quitter l’impossible réel pour écrire ce qui ne peut se Dire. »
**
De nos partages… : Je pense aux lectures que j’ai faites il y a quelques années en grec et en français des poèmes de Yannis Ritsos et, dont Louis Aragon a écrit qu’il était « le plus grand poète vivant de ce temps ».
Il a été déporté (en tant que résistant politique, il était militant du Parti communiste grec), à plusieurs reprises, sur différentes îles, entre autres à Makronissos où des milliers de déportés étaient soumis aux privations et à la torture.
Interné dans des camps de concentration, le poète écrivait en cachette avec acharnement sur de petits carnets ou sur des paquets de cigarettes…
Dessins, lettre gravée dans le marbre de la déportation, bouteilles enterrées avec, cachée, une écriture dont l’auteur ne saura pas si elle trouvera, un jour, son destinataire.
Misère de l’exil où l’horreur de l’indicible réel ne se fait récit, chant ou poésie que de la médiation d’une ou d’un autre.
Nécessité, plus qu’urgence, de mettre des mots sur ce qui du réel ne se laisse pas dire.
Écriture du réel quand l’écriture est ce qui excède le pouvoir dire.
Urgence et impossibilité auxquels sont convoqués Georges Semprun comme Imre Kertesz (et d’autres), au sortir des camps (1).
Il faudrait commencer par l’essentiel de cette expérience… L’essentiel ? Je crois savoir, oui. Je crois que je commence à savoir. L’essentiel, c’est de parvenir à dépasser l’évidence de l’horreur pour essayer d’atteindre à la racine le Mal radical, das radikal Böse (2).
À l’inverse de nos écritures pulsionnelles où le destinataire ne reçoit plus son message sous forme inversée (Lacan), de nos mots qui ne s’entendent plus du long écho (Lévinas) que l’épreuve (Erlebnis) dépose en soi, l’écriture du réel est d’abord l’impossibilité de dire, l’impossibilité de continuer à vivre, un impossible (3) qui se mue en roman (Kertesz, Semprun) ou en poésie (Hölderlin). En promesse !
Et notre embarras même, de mettre des mots pour une session que nous voulons ouverte, chemin pour que quelque chose de ce réel puisse faire vérité pour nous. Ce Nous que nous appelons ailleurs : « Collectif », « petite machine abstraite pour traiter l’aliénation », celle qui fait le lit de ce Mal radical, quand l’Histoire se conjugue au présent mais que le geste désintéressé est infini.
(texte de Pierre Isenmann)
NOTES:
(1) Jorge Semprun « L’écriture ou la vie », folio, Gallimard 1994, Imre Kertesz, « Être sans destin », Actes Sud.
(2) Jorge Semprun, Ibid p. 119.« das radikal Böse », référence à Kant.
(3) « Trois termes demandent à être précisés : le nécessaire, le contingent et l’impossible tels que Lacan en donne l’écriture. Il s’agit de trois termes de logique que Lacan reprend d’Aristote en les modifiant et il propose cette écriture : « Le nécessaire c’est ce qui ne cesse pas de s’écrire ; l’impossible c’est ce qui ne cesse pas de ne pas s’écrire ; le contingent c’est ce qui cesse de ne pas s’écrire. » (Du réel contingent, par Chantal Bonneau).
**
Cet événement est organisé par : Marie-Dominique Bolitt, Martine Frezouls, Pierre Isenmann, Marielle Jourdain, Christiane Motz-Gravier, Makis Yalenios.
Avec : Les Ateliers de Lecture, 35 rue du Schnockeloch 67000 STRASBOURG.
&
La Société de Psychanalyse Freudienne, 23, rue Campagne Première, 75014 PARIS.
**
Voici le document de présentation et les renseignements pratiques :
Bonjour,
Vous trouverez ci-joint le programme et les modalités d’inscription pour les activités de l’ASSERC 2026.
Les présentations cliniques auront lieu à 18 h, en direct, dans l’amphi de la Clinique, suivies d’une discussion, aux dates suivantes : 09 janvier, 30 janvier, 13 février, 06 mars 27 mars (voir programme).
Les conférences suivront les présentations cliniques en présentiel à 20 heures.
Il sera cependant possible de suivre les conférences en visio Zoom : le lien Zoom pour sera adressé aux inscrits à l’Asserc pour la session 2026 au cours de la semaine précédente.
Il est impératif d’être inscrit à l’ASSERC pour avoir accès à l’amphi ou recevoir le lien zoom pour les conférences.
Coordonnateurs : J.R. FREYMANN, G. RIEDLIN, M. RIEGERT, J. ROLLING, M. ROTH
Responsable universitaire : Professeur G. BERTSCHY
_____________________________________________________________
« Amours, Familles, Ruptures »
Nous avons pour ambition cette année d’explorer le triptyque « amours, familles, ruptures » au travers de la clinique, à notre habitude, et également au travers de la culture. Sous la forme de table ronde, de conférence, de représentation théâtrale, nous avons convié des auteur(e)s et nous retraverserons des images d’archives.
Le malaise dans la culture se renouvelle. Il prend des formes variées et emprunte sa présentation à l’actualité sociétale. S’il y a de grandes lignes communes aux malaises aujourd’hui (quêtes identitaires, radicalités, dépressions, burn-out, crises familiales et professionnelles, difficultés d’engagement…), d’aucuns se débrouille singulièrement avec ces malaises. Comment dé-brouiller ce dans quoi nous gisons ?
Est-ce que l’amour est une solution ? ou la rupture ? Et que faire de la famille ?
L’approche psychanalytique s’adresse au sujet, et c’est sous cet angle, c’est-à-dire avec le souci d’être à son écoute, lui qui n’affleure qu’entre deux signifiants, selon la formule de J. Lacan, que nous guiderons encore une fois nos travaux de cette année.
*
Le vendredi à 20 heures
Amphithéâtre de la Clinique Psychiatrique
Hôpital Civil, 1 place de l’Hôpital
CHU Strasbourg, aux dates suivantes :
Vendredi 09 janvier 2026 : J.-R. FREYMANN, Guillaume RIEDLIN, Martin ROTH, Myriam RIEGERT, Julie ROLLING: Amours, Familles, Ruptures – Table ronde introductive
Vendredi 30 janvier 2026: Anne REVAH: L’intime étrangère, un voyage en folie
Vendredi 13 février 2026: Thierry VINCENT: Ne dites pas à mère que je suis Psychanalyste: Elle pense que je fais du stand-up !
Vendredi 06 mars 2026: Daniel MARCELLI : Que deviennent les liens familiaux dans la famille du XXIe siècle ?
Vendredi 27 mars 2026 :J.R. FREYMANN, Guillaume RIEDLIN, Martin ROTH, Myriam RIEGERT, Julie ROLLING, « Parlez-moi d’amour », A partir d’archives de films de Lucien Israël, suivi d’une discussion à plusieurs voix
*
Le lien d’inscription est le suivant :
Les groupes cliniques :
Les personnes qui suivent les présentations cliniques doivent s’inscrire dans un groupe clinique (s’inscrire directement auprès du responsable du groupe choisi) – voir liste et coordonnées des groupes cliniques sur le programme). Pas de visio en Zoom en ce qui concerne les présentations cliniques.
Voici le programme:
Cher.e.s ami.e.s,
Vous trouverez ici le lien vers la passionnante conférence de Monique David-Ménard (psychanalyste, philosophe, Univ. Paris-Diderot) intitulée « La psychanalyse est profane, cela veut dire quoi ? », donnée le 17 janvier 2026 à la SPF.
Cette conférence traite de la spécificité de la psychanalyse et de la question de savoir si cette spécificité peut faire son chemin de manière intéressante et efficace dans les bouleversements de nos sociétés.
Cette rencontre est organisée par Isabelle Alfandary et Daniel Koren dans le cadre des Conférences pour la psychanalyse de la SPF (1).
Monique David-Ménard est philosophe (Univ. Paris-Diderot, où elle a dirigé le Centre d’études du vivant) et psychanalyste (membre associée de la SPF).
Elle a entre autres publié :
- La Folie dans la raison pure. Kant lecteur de Swedenborg, Paris, Vrin, 1990
- Tout le plaisir est pour moi, Paris, Hachette Littératures, 2001
- Corps et langage en psychanalyse. L’Hystérique entre Freud et Lacan. 1ère édition 1983 Universitaire. Réédition Éditions Campagne Première 2016
- Les constructions de l’universel : psychanalyse, philosophie, Paris, PUF, 1997 Réédition PUF (Quadrige) 2009
- Deleuze et la psychanalyse, Paris, PUF, 2005
- Éloge des hasards dans la vie sexuelle. Hermann 2011
- La Vie sociale des choses. L’animisme et les objets. Éditions du Bord de l’eau. 2020
L’ouvrage collectif dont il est question s’intitule « Die Freiheit der Psychoanalyse. Eine kommentierte Ausgabe von Sigmund Freuds ’Die Frage der Laienanalyse’ » (« La liberté de la psychanalyse. Une édition commentée de « La question de l’analyse profane » de Sigmund Freud ») (Turia+Kant, Vienne-Berlin, 2026). Il a été co-dirigé par Marcus Coelen, Monique David-Ménard et Mai Wegener.
¡Hola! / bonjour / hello,
Les informo sobre las actividades de la Escuela Libre de Psicoanálisis (Buenos Aires), que tiene muchas actividades en línea:
/ Pour les personnes qui comprennent l’espagnol, je vous informe des activités de l’Escuelalibredepsicoanalisis (Buenos Aires), qui a beaucoup d’activités en ligne :
/ For those who understand Spanish, I would like to inform you about the activities of the Escuelalibredepsicoanalisis (Buenos Aires), who has a lot of online activities:
(les sous-titres youtube sont en général excellents / YouTube subtitles are generally excellent)
Pequeño Manifiesto de la ELP / Petit manifeste de la ELP / Short manifesto of the ELP :
La Escuela Libre de Psicoanálisis propone un espacio de formación y de interlocución donde el psicoanálisis se despliegue en la diversidad y complejidad de sus teorizaciones y donde dialogue de forma abierta y no dogmática con otros discursos.
La Escuela no sigue una línea teórica, sino que convivan en sus espacios distintos modos de leer y entender la teoría y la praxis del psicoanálisis. La idea es promover es un espacio que fomente la creatividad y la invención, y no la repetición de un saber supuestamente ya constituido.
La Escuela reconoce y se nutre del legado de los maestros que la precedieron, pero orienta su trabajo hacia devenires inesperados e innovadores. En ese sentido, considera fundamental sostener un diálogo permanente con los discursos contemporáneos, siempre mutantes, ya que la vitalidad del pensamiento reside en el cambio y no en la recitación de dogmas incuestionados.
*
La escuela está coordinada por : / L’école est coordonnée par : / The school is coordinated by:
Bruno Bonoris, Psicoanalista, Escritor y Docente Universitario
Mauricio Portillo, Psicoanalista y Docente Universitario
Jorge Reitter, Psicoanalista, Escritor y Docente Universitario
Matías Tavil, Psicoanalista y Divulgador
*
Membres:
Elena Bravo Cecineros, Psicoanalista y Escritora
Emiliano Exposto, Doctor en filosofía, Docente y Investigador,
Rodrigo Aguilera Hunt, Psicoanalista, Docente, Investigador y Escritor
Tomàs Pal, Psicoanalista y Editor
Julia Lorena Silveira, Silveira, Psicóloga y Psicoanalista
Agostina Silvestri, Investigadora, Docente y Ensayista
Débora Tajer, Doctor en Psicología, Docente, Escritora
…
*
https://www.instagram.com/escuelalibredepsicoanalisis/?hl=fr
Bonjour,
Je vous informe ici d’un séminaire auquel je me réjouis beaucoup de participer. C’est le séminaire animé par Georges Bocchini-Revest et Jean-Pierre Marcos, lié à la SPF, et intitulé : « Langue affectée / discours désaffectés et affects retranchés » qui a lieu à Marseille en présentiel et sur zoom, sur inscription.
Dates : samedi 9h30 à 12h30, 24/01,07/02, 07/03, 11/04, 23/05, 27/06
Lieu : Les Arcenaulx, 25 cours Estienne d’Orves, 13001 Marseille
Format : hybride (zoom)
Invités : Dorothée DUSSY, « Corps/Inceste » et Malik BOURICHE, « Corps/Colonisation »
Texte de présentation
Nos pratiques d’aujourd’hui, issues de l’œuvre freudienne (la métapsychologie) et de l’héritage lacanien, s’inscrivent dans une tradition intellectuelle occidentale où le langage et le discours ont été érigés en principes fondamentaux, souvent au détriment du sensible et des émotions. Cette perspective, qui structure encore largement notre clinique, nous engage à approfondir cette recherche qui se nourrit de l’apport de S. Ferenczi, A. Green, P. Aulagnier, J. McDougall, en particulier dans ce séminaire.
La clinique analytique, via l’analyse du transfert, nous pousse à réfléchir à la fonction de traducteur, de transmetteur qu’il nous arrive parfois de pratiquer, face à des affects, ou à l’absence curieuse d’affects non reliés à des représentations.
Cette année nous continuons la recherche en axant vers la question somatique.
S’inscrire auprès de l’un d’entre nous.
Pour s’inscrire, contacter l’un de nous par mail ou par téléphone:
Georgette BOCCHINI-REVEST
45, quai de Rive-Neuve
13007 Marseille
04 91 55 63 62
revest.georgette@wanadoo.fr
Jean-Pierre MARCOS
57 bis, rue de Tocqueville
75017 Paris
06 60 82 69 41
jnprrmrc@aol.com
Bonjour,
Je vous informe ici du séminaire d’Alexandre Lévy (psychologue, psychanalyste, UCO Angers).
Séminaire ouvert à tous et en hybride, à Angers, UCO (salles du bâtiment Jeanneteau) et en visio par Zoom.
Dates (les jeudis entre 12h30 et 14h) : Jeudi 12 février (salle IB 108), jeudi 26 mars (salle IB 112), jeudi 9 avril (salle IB 108), jeudi 21 mai (salle IB 108), jeudi 18 juin (salle IB 210).
En extension des développements précédents, depuis le séminaire intitulé La vie du langage, nous poursuivons cette année autour des signifiants de la chute, de ces signifiants in fine déterminants dans l’existence de tout parlant, comme rencontre avec le réel qui en signe sa structure.
« Retrouvant pour ce faire les chutes qui témoignent que le sujet n’est qu’effet de langage : nous les avons promues comme objets a. Quel qu’en soit le nombre et la façon qui les maçonne » (1). Il s’agira de préciser quelles sont les lois – plurielles – qui concourent à ce qui chute. Car la chute révèle le nouage autant qu’elle entérine ce qui revient à la même place.
Dans l’expérience analytique, les chutes s’éprouvent comme tout à fait asymétriques, côté analysant et côté analyste. A la condition de prendre au sérieux la portée des signifiants qui y insistent et qui dérangent, la nécessité de ces chutes nous font entrer dans le temps des conséquences : de là, se dessine une éthique – et nous aurons à en préciser les termes pour ne pas en faire un autre gros mot.
Ces développements seront aussi l’occasion d’actualiser ce qu’il en est de la situation de la psychanalyse en 2026.
(1): Lacan J. « La logique du fantasme. Compte rendu du séminaire 1966-67 », in Autres écrits, Paris, Le Seuil,
*
Alexandre Lévy est psychologue, psychanalyste, Maître de conférence à l’Université Catholique d’Angers, membre du laboratoire RPPsy, membre de l’EPFCL.
Je citerai ici l’ouvrage collectif qu’il a codirigé (avec David Bernard), Pas de limites? Approche psychanalytique de la vie moderne,Presses Universitaires de Rennes, 2021. Pour plus de détails sur ses publications : https://recherche.uco.fr/user/146/publications-chercheur-annee
*
Pour participer, écrire à : alexandre.levy@uco.fr
Bonjour,
Je vous informe ici de la conférence de Jean-Pierre MARCOS le 14 février 2026 (16h-18h), intitulée « Comment dire ? – Psychanalyse et parole ».
Jean-Pierre MARCOS est philosophe et psychanalyse (Paris 8, SPF).
Pour vous inscrire à cette conférence, veuillez cliquer sur le lien d’inscription ci-dessous :
https://3a35f2b8.streaklinks.com/Cmds63bqarBT10xUBAl1KIr0/https%3A%2F%2Fforms.gle%2FtPzX1KjAVwfCNJ2B8
INSCRIPTION OBLIGATOIRE
*
Cette conférence fait partie du cycle des Conférences pour la psychanalyse de la SPF :
Lieu : par Zoom et au local de SPF à Paris
Autres dates : (Samedis après-midi de 16h à 18h), 1ère conférence le samedi 17 janvier 2026
17/01, 14/03, 14/02, 20/06
Les conférences pour la psychanalyse de la SPF visent à faire mieux connaître la psychanalyse à toutes les personnes désireuses de découvrir ou d’approfondir la découverte de l’inconscient. Les psychanalystes de la SPF y abordent la psychanalyse au prisme de questions ouvertes et actuelles.
Organisateurs : Isabelle ALFANDARY et Daniel KOREN
Le 2ème lundi du mois
à 21h
1re réunion le 8 décembre 2025
Les dates de séminaires de cette année :
12 janvier 2026, 09 février 2026, 09 mars 2026, 13 avril 2026, 11 mai
2026, 08 juin 2026.
-en Zoom avec l’ID (identifiant) 7503377025 sans code secret ou bien en
cliquant directement sur le lien : https://us02web.zoom.us/j/7503377025
-En présentiel au local : 23 rue Campagne Première, 75014 PARIS (Petite
salle) ;
Il s’agira de lire ensemble les textes de Freud retenus pour nous permettre de nous confronter aux points d’inflexion de sa métapsychologie, non sans rapporter nos lectures à nos gestes cliniques.
L’ambition du séminaire est de mettre ainsi à l’épreuve chacun de nous dans son acte de lecture, dans l’usage de ses références et la mise en perspective théorique de sa pratique. Nous nous attacherons cette année aux premiers textes de Freud dont les « Études sur l’hystérie ».
Interviendront dans ce séminaire :
Danielle ELEB (A.L.I.) « Automaton et Tuche dans la Gradiva » (Date à déterminer)
Marine ESPOSITO-VEGLIANTE « Écriture et transmission » (Juin 2026)
Sara FADABINI (Date à déterminer)
Malgorzata MALISZEWSKA (S.P.F.) (Mars 2026)
*
Jean-Pierre MARCOS (philosophe, psychanalyse, Paris 8, SPF)
06 60 82 69 41
jnprrmrc@aol.com
Cher.e.s tout.e.s,
Voici le programme des formations 2025-2026 Apertura (FEDEPSY):
Vendredi 23 janvier 2026 : Malaise dans les institutions
Mercredi 11 mars 2026 : Cela ne va pas s’en dire – Les registres de la parole
Vendredi 29 mai 2026 : La vieillesse en analyse
Mercredi 10 juin 2026 : Bien-être – plaisir – désir – jouissance
Vendredi 16 octobre 2026: À la recherche du génie du chaque Un. Les vérités du sujet (intuition, interprétation)
Mercredi 18 novembre 2026 : Influence, hypnose et identifications à l’époque du virtuel et des réseaux sociaux
Vendredi 11 décembre 2026 (en présentiel): Journée sur les cliniques actuelles de l’enfant et de l’adolescent « Hors de la norme… mais où alors ? »
Plaquette à télécharger:
Cher.e.s tou.te.s,
Puisque, le 5 février 2026 (21h), Isabelle Alfandary nous fera la joie et l’honneur de participer au séminaire « Freud à son époque et aujourd’hui » sur le « masculin »/ »féminin » (sur zoom), pour une discussion autour de ce son si important « Le scandale de la séduction. D’Oedipe à #Metoo » (PUF, 2025).
Donc je relaie ici la belle émission qu’elle a fait sur France Inter, dans le Grand Face-à-Face, chez Thomas Snégaroff. Dans ce passage à la radio, elle nous parle de son si important « Le scandale de la séduction. D’Oedipe à #Metoo » (PUF, 2025).

Présentation du livre par l’éditeur :
La séduction est à double tranchant : elle peut s’avérer la plus douce ou la plus redoutable des expériences. Elle est indispensable et potentiellement menaçante.
Aux premières heures de la psychanalyse, Freud écoute des femmes qui se remémorent des scènes d’abus sexuels. Il en conclut que la séduction est une cause majeure de traumatisme psychique avant de se raviser et de ramener ces « souvenirs » à des fantasmes.
Malgré cette volte-face initiale, la séduction ne cesse d’opérer un retour en psychanalyse, et de hanter son histoire.
La séduction est porteuse d’un scandale, celui du sexuel, et plus particulièrement de la sexualité infantile qui vient rebattre les cartes du normal et du pathologique, de l’innocence et de la perversion.
Isabelle Alfandary tente d’éclairer ce scandale, en prenant en compte les débats les plus récents autour de la sexualité, de la vie érotique et amoureuse, de leurs éventuels impasses et débordements traumatiques.

**
Isabelle Alfandary est professeure de littérature américaine à l’université Sorbonne-Nouvelle, philosophe et psychanalyste. Elle a été présidente du Collège international de philosophie de 2016 à 2019. Ses recherches sont à la croisée de la psychanalyse, la philosophie et la littérature.
**
Ouvrages en philosophie, psychanalyse
– Derrida – Lacan : L’écriture entre psychanalyse et déconstruction, Paris, Editions Hermann, 2016
– Science et fiction chez Freud. Quelle épistémologie pour la psychanalyse? Édition originale : Paris, Ithaque, 2021
– (pt) Traduction portugaise (Brésil) : Ciência e ficção em Freud: qual epistemologia para a psicanálise?, São Paulo, Blucher, 2022
– (es) Traduction espagnole (Argentine) : Ciencia y ficcion en Freud. Qué epistémologia para el psicoanalisis?, Buenos Aires, Manantial, 2023, 193
– Le Scandale de la séduction. D’Œdipe à #Metoo, Paris, Presses universitaires de France, 2024
Ouvrages sur la littérature américaine
– E. E. Cummings ou la minuscule lyrique, Paris, Belin, 2002
– Le risque de la lettre : lectures de la poésie moderniste américaine, Lyon, ENS-éditions, 2012
Direction d’ouvrages en philosophie, psychanalyse, théorie critique
– Lire depuis le Malaise dans la culture, en collaboration avec Chantal Delourme et Richard Pedot. Paris, Hermann, 2012
– L’Enigme Nietzsche, en collaboration avec Marc Goldschmit. Paris, Manucius, 2019
– Dialoguer l’archive, Paris, INA éditions, 2019
– La littérature sans condition, Paris, Le Bord de l’Eau, 2021
– Crise dans la critique. Une cartographie des studies. Paris, Le Bord de l’Eau, 2023
– Qui a peur de la déconstruction ?, en collaboration avec Anne-Emmanuelle Berger et Jacob Rogozinski, PUF 2023
– Où va la philosophie française ?, en collaboration avec Sandra Laugier et Raphael Zagury-Orly, Vrin, 2024
Direction d’ouvrages en littérature anglophone
– Modernism and Unreadability, en collaboration avec Axel Nesme, Montpellier, Presses Universitaires de la Méditerranée, 2011
– Genre/genres I, en collaboration avec Vincent Broqua. Paris, Michel Houdiard éditeur, 2015
– Genre/genres II, en collaboration avec Charlotte Coffin et Vincent Broqua. Paris, Michel Houdiard éditeur, 2015
– Literature and Error, en collaboration avec Marc Porée. New York: Peter Lang, 2018
– Stein et les arts, en collaboration avec Vincent Broqua. Paris, Presses du Réel, 2019
**
Chères amies, chers amis,
J’aimerais ici vous faire part de la manière dont j’appréhende la très importante réflexion de Darian Leader dans son livre, La jouissance, vraiment ? (Stilus, 2020). De cet ouvrage, je vais présenter et mettre au travail des éléments[1].
En complément de cela, j’aimerais annoncer ici que je parlerai de son ouvrage « Qu’est-ce que cache le sexe? » récemment traduit en français (Albin Michel, 2024) lors de la séance du 8 janvier 2026 de notre séminaire « Freud à son époque et aujourd’hui » (FEDEPSY) sur le « féminin »/ »masculin ». La séance sera l’occasion de deux interventions : l’une de Frédérique Riedlin (psychanalyste) à partir du titre « L’orgasme: féminin? masculin? autre? » ; l’autre de moi élaborant sur le titre « Sexe créatif, satisfaction subjectivante et orgasme : élaboration avec Donald W. Winnicott (« Vivre créativement »), Darian Leader, Maggie Nelson et Eve Kosofsky Sedgwick ».
**
Dans ce livre, l’auteur, en historicisant la pratique et la pensée de Lacan, rouvre les questionnements de Lacan sur la jouissance. Ainsi déploie-t-il ce que j’appellerais un freudo-lacanisme personnel et rénové, solidement subjectivant, car permettant le déploiement chez le sujet d’un mode de jouissance subjectivant. Darian Leader nous aide à nous repérer cliniquement et théoriquement face à la notion de jouissance que Lacan a développée, mais aussi plus généralement face à l’enseignement de Lacan. Cela nous est très précieux, car la problématisation de Lacan en termes de jouissance est fondatrice cliniquement et théoriquement, en même temps que son élaboration de ce problème est souvent contradictoire, plurielle – et demande tout un travail de réélaborations[2].
La psychanalyse dans son histoire a développé différentes lignes pratiques et théoriques, le freudo-lacanisme, dans sa pluralité, étant une de ces lignes parmi d’autres[3]. Dans sa pratique et théorisation personnelle, l’analyste peut essayer d’articuler de manière rigoureuse les apports de différentes pratiques et théorisations. Plus encore, s’appuyer sur les apports de Lacan nous dote d’outils cruciaux pour nous orienter dans la pratique. En ce sens, la clinique contemporaine et notre nouveau contexte[4] demandent de nouvelles interprétations de la pensée de Lacan – et de son apport fécondement irritant[5].
C’est en sens que Darian Leader déploie un freudo-lacanisme ouvert aux théorisations post-freudiennes fécondes. Un freudo-lacanisme aussi plus centré sur le désir du sujet – au sens freudien – et sur le lien à l’Autre, que sur le désir de l’Autre. Le désir de l’Autre, comme désir de désir, devant, dans le lien du sujet à l’Autre, être soutenant du désir du sujet[6]. Toutefois, Darian Leader refuse d’ « anthropomorphise(r) » (p. 101) la psychanalyse et le sujet[7]. Plus encore, l’auteur n’hésite pas à prendre Lacan à rebrousse-poil, pour tirer certains fils d’habitude peu élaborés de son oeuvre, et les approfondir dans le sens qui lui semble fécond.
Plus largement, du point de vue de l’histoire de la psychanalyse, Darian Leader fait partie de ces auteurs qui nous permettent d’appréhender en quoi Freud[8], Lacan, et le freudo-lacanisme, ont apporté des avancées fondamentales, en nous apportant des concepts qui nous orientent dans la pratique. De plus, tout savoir étant partiel, il considère à raison : que ces avancées ont aussi eu des limites ; que Freud et Lacan ont étudié certains problèmes de manière partielle ; et que d’autres questions, concepts et élaborations, qui ont surgi après Freud, et en dehors de Lacan, sont aussi intéressantes à étudier. Bref, ces autres questions, concepts et élaborations, l’analyste freudo-lacanien gagne s’il le souhaite à les prendre en compte[9]. En d’autres termes, bien des analystes post-freudiens, et bien des analystes tenants d’une psychanalyse de la relation d’objet, dans la mesure où leurs pratiques et leur théorie s’opposent à toute normalisation, ont traité des problèmes importants et proposé des concepts et des élaborations féconds. Dès lors, il est intéressant de déplier tranquillement les problèmes posés, et la pluralité des élaborations de ceux-ci. Ce qui ouvre aussi à la possibilité, pour l’analyste (freudo-lacanien dans mon cas), de méditer les apports ou les limites d’apports divers, et de se nourrir de manière rigoureuse de ceux qu’il trouve fécond, dans son style analytique singulier. Et d’ouvrir ainsi à des nouvelles lectures de Freud, de Lacan – ou d’autres. D’ailleurs Darian Leader – et ce n’est pas le moindre de ses apports – développe une perspective considérant que le fait que l’analyste se donne, dans sa petite théorie psychanalytique portative, la possibilité d’élaborer une pluralité de perspectives analytiques, est fécond du point de vue de sa pratique et de sa théorie. Comme du point de vue de sa lecture – et de sa transmission – de Freud, de Lacan (et d’autres), et de l’histoire de la psychanalyse. Ce pour bricoler au mieux la complexité de la clinique. Et aussi pour développer une parole psychanalytique et une pensée de la psychanalyse en dynamique, en partant avant tout de la clinique, et de ses événements qui toujours viennent interroger notre théorie.
Ainsi, la relecture de Lacan par Darian Leader[10] ne s’interdit pas, malgré les préventions de Lacan contre la psychanalyse de la « relation d’objet », de se nourrir d’auteurs d’autres traditions, particulièrement de la psychanalyse fondée sur ce que Darian Leader appelle un « modèle relationnel » (p. 34) – et donc prenant largement en compte le « lien à l’Autre », la « relation d’objet ». Plus encore, je dirais que Darian Leader élabore les apports de la théorie de la relation d’objet sous sa forme féconde, subjectivante, car insistant sur la sexualité et le pulsionnel, mais aussi sur la singularisation du sujet par rapport à son environnement – j’aimerais ici citer Balint ou Winnicott, sur lesquels je reviendrai. Ce qui, pour le dire dans mes termes, permet d’éviter toute soumission du sujet aux tendances normalisatrices qui, dans cet environnement, s’opposent à sa subjectivation. Car si Lacan a fécondement critiqué la psychanalyse de la relation d’objet sous sa forme normalisatrice (comme celle de Bouvet), et s’il a aussi fécondement critiqué la manière dont nombre de tenants de la théorie de la relation d’objet négligent la sexualité au sens freudien, Darian Leader nous montre à mon sens pourtant qu’il peut être fécond de prendre en compte, contre cette version normalisatrice de la psychanalyse de la relation d’objet, une autre psychanalyse de la relation d’objet, plus féconde. Et qui est elle, je dirais (dans ma perspectivre propre, différente de Darian Leader sur certains plans), à la fois dénormativante, singularisante et subjectivante, particulièrement chez les auteurs qui prennent en compte la sexualité au sens freudien. Je citerais pour ma part en premier lieu Balint, ou Winnicott[11], que Darian Leader élabore – il élabore aussi particulièrement Erikson, Stephen, ou Fromm. D’ailleurs, même si certains tenants de cette psychanalyse de la relation d’objet, comme justement Fromm, ne prennent pas assez en compte la sexualité au sens de Freud, ce qu’il a donné à penser peut-être sur certains points importants fécond. Bref, ce sont là des débats classiques de la psychanalyse et de son histoire, mais Darian Leader nous propose de les reprendre autrement pour élaborer avec différentes lignes pratiques et théoriques les différentes dimensions de la cure et de la subjectivité dans leur complexité.
En ce sens, Darian Leader reprend créativement Lacan et se donne le droit d’en donner une lecture personnelle et parfois critique, lorsque celui-ci, malgré son immense apport, lui semble déployer plus un élément de fermeture qu’une élaboration créative. En relisant la théorie de la jouissance de Lacan, il ouvre à une forme singulièrement relationnelle de freudo-lacanisme personnel et rénové. Pour cela, Darian Leader travaille à repérer ce qui chez Freud et Lacan relève d’une conflictualité entre ce qu’il appelle : d’un côté, l’ouverture d’élaborations allant dans le sens du « modèle relationnel », en ce qu’il est subjectivant, et prenant en compte, concernant le sujet, le « lien » (de parole) « à l’Autre » ; et de l’autre, la refermeture sur une conception du sujet comme « monade isolée »[12].
**
Dans cette lecture par l’auteur de la manière dont Lacan a posé le problème de la jouissance, lecture donc depuis un « modèle relationnel » sous sa forme subjectivante, le sujet est envisagé d’abord dans le lien à l’Autre – Autre à la fois relationnel, mais aussi Autre de la parole et du signifiant. Ce qui permet d’éclairer sous une lumière nouvelle, avec Lacan mais aussi quelque peu au-delà de Lacan, ce problème de la jouissance. Et ainsi d’envisager tout un ensemble de questions cliniques que le freudo-lacanisme, sous sa forme ouverte, n’a pas l’habitude de prendre en compte.
Plus en détails, Darian Leader se démarque de ce qu’il appelle le « modèle fermé » de la psychanalyse, que l’on trouve, montre-t-il, dans tout un pan des pratiques et pensées de Freud et de Lacan – considérant que leurs pratiques et leurs pensées sont conflictuelles. Dans ce « modèle fermé », le sujet est avant tout un « réservoir fermé de libido » (p. 34), plus encore une « monade isolée » (p. 13). Chez Lacan, cette « monade isolée » est « sans lien à l’Autre » (p.13) et est structurée par un « pur Un de la jouissance ». Dès lors, la cure a fondamentalement pour fonction de mettre en crise cette subjectivité monadique par la mise en place de l’objet petit « a » et par la « positivation du manque » (p. 113). Il en va ici de ce que j’appellerais le primat du manque que déploie souvent le freudo-lacanisme (ce qui implique un dans une lecture de Lacan que l’on peut qualifier de négativiste, dominante dans l’histoire de la lecture de Lacan, comme je vais le développer tout de suite), et que Darian Leader, tout en reconnaissant la part du manque, critique. Et il est vrai que le manque, dirais-je, dans les faits, dans la vie comme dans la cure, ne doit pas être hypostasié : il implique d’ailleurs, comme l’établit Lacan – et y a insisté Lucien Israël -, la nécessité de la satisfaction, de la joie et de la rencontre sous leurs formes subjectivantes[13]. Ce qui veut dire que, dans la cure, et comme le propose Lacan, l’analyse doit pouvoir procurer au sujet une rencontre – à la fois symbolique et sinthomalisante – avec le tiers[14], ouvrant à une satisfaction subjectivante, à un mode de jouissance subjectivant spécifiquement analytique. En lien à la mise en place dans la cure d’une nouvelle relation, ouverte, à la satisfaction, à la jouissance. Lorsque je dis cela, j’envisage, avec Lacan[15], une pratique analytique qui pose la nécessité du manque, mais non point son primat. Qui prend en compte l' »expérience dialectique » de la psychanalyse que Lacan pratique et éclaire : le fait qu’il n’y a pas que de la négativité dans l’analyse (manque, finitude…[16])[17], mais aussi une positivité subjectivante et créative, avec joie, satisfaction – et même enthousiasme[18] – spécifiques, liée au désir et à la « hâte » ou l’urgence de vivre. Ouvrant, par l’analyse et dans la vie, à une joie et une satisfaction subjectivante et créatives, un mode de jouissance subjectivant et créatifs[19]. Bref, la lecture que l’on pourrait appeler négativiste de Lacan posant le primat absolu du manque, courante dans le freudo-lacanisme, relève d’une interprétation de son enseignement qui passe à côté de la dialectique que Lacan a bien plutôt pratiquée et pensée. Face cela, au regard de l’expérience dialectique de la psychanalyse et de l’enseignement de Lacan, je pense plus juste de s’orienter dans le sens d’une élaboration de Lacan qui prenne en compte sa pratique et sa conception, justement dialectiques, de la psychanalyse. C’est-à-dire articulant négativité inéluctable (du manque, de la finitude, de l’angoisse…) et positivité subjectivante et créative. Ce avec une lecture de Lacan[20] allant dans le sens de la prise en compte de la satisfaction, de la joie, de l’enthousiasme, de la rencontre subjectivante, de la créativité du symbolique et de l’amour de transfert…[21] Notons d’ailleurs que Lacan lui-même a dans certains passages de son oeuvre cédé à ce que l’on pourrait appeler ce négativisme, dans la propre conception qu’il avait de la cure et de son oeuvre[22]. Et que le présent éclairage de son apport va contre cette propre tendance chez Lacan.
En ce sens, un point crucial de ce livre consiste dans le fait qu’il éclaire de manière particulièrement féconde ce qui dans la pratique et la pensée de Lacan permet de penser et de soutenir, dans la cure, le déploiement chez le sujet de son « désir ». Et ce par le déploiement du « refus fondamental de la demande de l’Autre, un rejet de ses signifiants, ou de certains d’entre eux » (p. 80). D’ailleurs cela rejoint ce que nous dit Lacan dans le Séminaire D’un Autre à l’autre, sur le fait que la parole du sujet doit se singulariser par rapport au discours de l’Autre.
Sans ce refus fondateur pour la subjectivation, montre Darian Leader, il y a « assimilation à la demande de l’Autre », ce qui « annule » en fait le sujet (p. 80) : le sujet est alors pris dans la jouissance de l’Autre. Bref, il en va là d’un non fondateur permettant au sujet de se dégager de cette demande et de cette jouissance. Ce qui fait du sujet – il me semble dans une formulation plus freudienne que lacanienne – « un pôle d’action et de motivation ». Ce qui aussi, point très important, « impliqu(e) en même temps le manque d’un signifiant ». Ici, notons-le, le sujet n’est « pas » « vide », il n’est pas non plus un « pur effet » : il est « pure action, fût-elle minimale » (p. 80).
Cette action subjectivante du sujet, Darian Leader l’élabore aussi en reprenant Erikson et Fromm, en la liant donc au refus des signifiants inscrits dans le lien (de parole) à l’Autre lorsqu’il est désubjectivant. Ce qui ouvre, dirais-je, au déploiement d’un mode de jouissance subjectif et subjectivant. Plus encore, je rapprocherais cette réflexion de l’auteur sur cette action du sujet avec la réflexion de Freud sur le fait que le complexe d’Oedipe du sujet doit le mener à l’adolescence au « détachement par rapport à l’autorité parentale »[23] – Freud ayant formulé ce problème fondamental, malgré l’élaboration hétéro-patriarcale que Freud peut en donner [24].
Plus encore, Darian Leader insiste sur le fait que, souvent, dans la cure ou dans le cheminement subjectif du sujet, cette pure action du sujet, liée au refus fécond de la demande de l’Autre, passe, pour le sujet, par un temps où il n’est pas sans se faire du mal à lui-même, sans que le sujet s’attaque lui-même. Ce en tant qu’il prend sa propre jouissance dans la demande – et dans la jouissance – de l’Autre (p. 80). Bref, il en va là d’une « douleur constituante » (p. 65), d’ailleurs liée au plaisir[25]. En lien au déploiement sur soi de la destructivité. Ce retournement sur soi de la destructivité constitue, dirais-je, un trouble pouvant devenir, par la cure, un symptôme. Car, dialectiquement, le travail analytique vise alors à aider le sujet à passer par la traversée de ce trouble lié au déploiement de la destructivité, pour en faire un symptôme. Ce en premier dans le lien de parole à l’analyste
Plus encore, la subjectivation passe même, selon Darian Leader (élaborant ici Erikson), pour le sujet ayant été pris dans des liens à l’Autre désubjectivants, par le fait d’aller vers la « recherche radicale de toucher le fond ». Ce dans une « identité négative » où le sujet « s’identifie aux éléments que le parent lui a présentés comme les plus indésirables ou les plus dangereux, mais aussi les plus réels ». Ce qui est « à la fois comme l’ultime limite de la régression et l’unique fondation solide pour une progression » (citation d’Erikson, pour qui, rappelle Darian Leader, la parole est un « pacte » et « définit » le sujet[26]) (p. 39-41).
**
Une fois ceci posé, je peux en venir au fait que Darian Leader voit dans la « jouissance », telle que la pense Lacan dans des termes nourris du discours juridique, une forme particulière de « lien à l’Autre », de « relation d’objet » où l’Autre pose une « hypothèque » sur le sujet. Ce en un « processus » d’« abolition » et de « non-reconnaissance » de celui-ci (p. 28) – je parlerais pour ma part de processus désubjectivant, car prenant le sujet dans un mode de jouissance désubjectivant. Ici dans son lien au sujet, l’Autre, ayant donc un mode de jouissance désubjectivant, déploie effectivement, dans son lien au sujet, à la fois une jouissance abolissant le sujet, et poussant le sujet dans l’abolition de soi (p. 13). En d’autres termes, il en va là de la question du pouvoir.
Dès lors, face à cela, la cure vise à soutenir, dans le lien analytique ouvrant, la reconnaissance de l’existence, dans l’histoire infantile du sujet, mais aussi plus tard, de ce lien (de parole) à l’Autre et à son mode de jouissance désubjectivant – d’une partie de son environnement et de son discours. La cure vise aussi à la reconnaissance et au déploiement, par le sujet, de la séparation d’avec cet Autre et d’avec sa jouissance désubjectivante[27]. Ce qui passe par la différenciation des jouissances, et donc par le déploiement et la reconnaissance par le sujet du refus de la demande de l’Autre – liée à sa jouissance – qui habite ses troubles. Et donc par le refus des signifiants liés à cette jouissance.
Ce geste de séparation, insiste Darian Leader, a sa part de « douleur » (p. 81). Car la douleur, en lien au plaisir, est une question centrale dans la cure – sur laquelle Lacan n’insiste pas assez selon l’auteur. Bref, la douleur est un affect qui permet d’orienter l’écoute de l’analyste pour suivre le fil de la subjectivation du patient.
Ce geste de séparation a aussi sa part de « risque » (p. 81). En effet, dirais-je, il peut aussi échouer, suivant la manière dont le sujet trouver ou non dans son environnement des liens d’appuis, qui permettent que se déploie sa subjectivation
Ainsi, nous montre Darian Leader, l’analyste, s’il se positionne dans le sens évoqué (ce qui demande, selon moi, de sa part tout un travail de retour sur son propre rapport à la destructivité, à la jouissance, un travail sur sa résistance – une traversée de son symptôme et un travail de repérage de son sinthome – comme y insiste Lacan), peut aider le sujet à reconnaitre ce qu’il en est de sa jouissance et de la jouissance dans son environnement. L’analyste peut ainsi aider le patient à cheminer vers le fait de ne plus reporter sur lui-même la « haine » ni la « rage », qu’il ressent (légitimement) vis-à-vis de l’Autre le prenant dans sa demande et dans sa jouissance (p. 29). Et donc de ne pas rester pris dans une douleur pas assez élaborée.
Dans ce cadre, le cheminement analytique passe ainsi pour le sujet par la traversée et par la reconnaissance de sa propre jouissance, de celle(s) de son environnement, et de l’encastrement des deux. Il passe aussi par la traversée et la reconnaissance de ces impulsions affectives nécessaires à la subjectivation que sont la haine et la rage. Ce qui aide le sujet à reconnaître la « part de refus de la demande qui habite son geste d’auto-abolition de soi » (p. 29), et à rendre la compulsion de répétition créative – pour citer Lucien Israël[28]. En effet, je l’ai dit, pour Darian Leader, les affects de haine et de rage, en lien à la douleur, lorsqu’ils sont donc retournés contre le sujet, sont liés au déploiement masochiste par le sujet d’une auto-abolition qui répète l’abolition subie de la part de l’Autre, et qui agit aussi la demande – surmoïque – d’abolition de ce dernier. Il reste que ces affects de haine et de rage constituent déjà pour le sujet, même dans cette auto-abolition masochiste, une tentative, dirais-je, de résister à l’environnement, et de tenter de produire quelque chose comme une subjectivité – un désir. Ce alors même que le sujet était, du fait d’un rapport de force défavorable (celui de l’enfant face à l’Autre), pris dans le mode de jouissance désubjectivant de l’Autre.
Plus encore, l’éclairage de Darian Leader permet à l’analyste de solidement repérer dans la cure la manière dont le sujet est parfois « prisonnier d’un idéal mortifère » (p. 29). Et de solidement repérer aussi la manière dont cet idéal désubjectivant – que le sujet reprend le plus souvent de l’autre – verrouille le lien (de parole) à l’Autre désubjectivant et le mode de jouissance dans lequel le sujet est pris. Ce qui le bloque dans cette « abolition » de soi qu’il connaît (et a connu).
Bref, on le verra j’espère, la cure telle que la pratique et la théorise Darian Leader constitue une forme singulière et solidement ouvrante de psychanalyse freudo-lacanienne. Car, dirais-je, par son mode de parole et d’écoute désirant, créatif, produisant une reconnaissance et une traversée, l’analyse initie aussi le sujet à un mode de jouissance subjectivant – ayant consenti au désir. Ce qui permet une satisfaction ouverte spécifique analytique[29], et une joie de la subjectivation[30]. Cela ouvre au dégagement singularisant de la jouissance du sujet de la jouissance de l’Autre. Ce qui permet au sujet de produire un symptôme singulier. Cela ouvre aussi au travail interminable de dialectisation de ce symptôme et de la jouissance, qui existe inéluctablement dans la vie corporelle et psychique, mais aussi dans la parole, du sujet.
Dans l’analyse telle que la pratique et la théorise Darian Leader, il en va d’un lien (de parole) désirant à l’Autre – à l’analyste – qui permet au sujet de se déprendre de la jouissance de l’Autre, celle de l’analyste en premier lieu, mais aussi particulièrement celle de l’Autre des liens désubjectivants passés et présents.
Tout ceci pose la question de la forme que prend factuellement la demande – mais aussi le mode de jouissance – de l’Autre qui, au début de la vie psychique du sujet et dans sa jeunesse, a inscrit le sujet, justement dans une certaine forme de demande et dans une relation spécifique à la jouissance – ainsi qu’aux signifiants. Cela amène Darian Leader à considérer (avec Erikson encore) que le sujet, dans son enfance, s’il a eu à faire à un environnement désubjectivant, a parfois « reconnu la faiblesse des parents ou leurs souhaits inexprimés » (p. 40). Il en va là des questions, déjà évoquées plus avant : du fait de « se séparer de l’Autre » et de l’ « idéal négatif » dans lequel le sujet est pris (p. 38-39). Ici, le sujet, dans la cure, doit donc pouvoir perlaborer cette première expérience de lucidité infantile, prenant une forme désubjectivante, concernant les limites de ses parents, leur finitude. Cette élaboration permettra au patient d’accéder, je dirais (en élaborant Lacan), au fait que ses parents sont des Autres marqués par la finitude. Ce même s’ils l’ont dénié, et ont érigé en ce sens un scénario d’omnipotence de l’Autre – et ont pris le sujet dans celui-ci.[31]
Ainsi, selon Darian Leader, c’est « l’objet » qui « est créé à travers la relation à l’Autre, plutôt que l’inverse » (p. 89). Ce qui pose aussi la question de la transitionnalité au sens de Winnicott (p. 93). D’ailleurs – et c’est une question clinique cruciale -, la jouissance, rappelle Darian Leader, est liée à l’autoérotisme infantile. En effet, l’expérience psychanalytique montre que l’autoérotisme infantile n’est pas primaire, qu’il est lui-même pris dans le lien à l’Autre[32], comme l’établit Freud (p. 13). Cela permet d’envisager l’autoérotisme non comme quelque chose de désubjectivant, comme y insiste le plus souvent Lacan[33] (par exemple, pour donner une référence qui me vient, lorsqu’il parle du « clitoris » comme « autistique »[34]), mais bien comme quelque chose de fondamentalement subjectivant, car élaborant au niveau de la sexualité les affects de haine et de rage[35].
Cela concerne directement le positionnement de l’analyste. Sur ce point, celui-ci, justement, propose Darian Leader, gagne à accueillir l’élaboration psychique existante chez le sujet dans son autoérotisme, ainsi que les affects de douleur et de plaisir, de haine et de rage qui lui sont associés. Ce que, malgré son apport, Lacan, dans sa pratique, ne fait globalement pas assez, ajoute Darian Leader.
Plus encore, dirais-je, le positionnement analytique que pratique Darian Leader propose à l’analyste me semble aller dans le sens du fait de déployer un désir de désir proposantun lien (de parole) à l’Autre ouvert, où peut avoir lieu, ajouterais-je, une rencontre symbolique au sens de Lacan[36] et d’Israël[37] – permettant ce que Darian Leader appelle lui un « acte de foi archaïque dans le symbolique » (p. 106).
En ce sens, Darian Leader propose aussi, il me semble, à l’analyste de travailler à accepter de prendre en compte le fait que le lien (de parole) à l’Autre – et à l’environnement du sujet – a une dimension factuelle : dans l’histoire du sujet, le lien (de parole) à l’Autre a pu et peut être factuellement subjectivant ou désubjectivant. Ici, la prise en compte de la réalité et de la factualité du lien (de parole) à l’Autre ne s’oppose pas à l’écoute de la parole et de signifiant, depuis la vie psychique et fantasmatique du sujet. Comme c’est plutôt le cas dans le « scepticisme » de Lacan[38], proche de celui de Freud, qui l’amène à régulièrement opposer d’un côté le lien factuel à l’Autre et de l’autre le signifiant. Ici je dirais que, si ce scepticisme a historiquement accompagné le geste psychanalytique de reconnaitre les réalités psychiques et discursives, la perspective de Darian Leader propose d’envisager les choses autrement.
Ainsi, si ce lien (de parole) à l’Autre a factuellement été désubjectivant, si le sujet s’est vu factuellement imposer un mode de jouissance désubjectivant, eh bien la cure a pour fonction de l’aider à s’en dégager et à mettre en place un mode de jouissance subjectivant. Je dirais que Darian Leader nous propose d’envisager et pratiquer une psychanalyse qui prend en compte, de manière équilibrée et complexe, ces différentes réalités : signifiante, psychique, mais aussi celle du lien (de parole) à l’Autre.
Dans le positionnement de l’analyse, cela va avec le fait d’éviter toute position d’autorité[39]. Ici, pour le dire avec Leclaire[40] dans son débat avec Lacan : il s’agit pour l’analyste de déployer un « désir de l’Autre un peu délié ». De déployer un désir de l’Autre, ou un désir d’analyste, habité, si j’élabore l’expression de Leclaire, par la « déliaison » de l’ « analyse ». En effet, ainsi que la définit Freud, l’analyse, comme proche de l’analyse chimique, est déliaison, et je dirais, dès lors : ouverture au fait que le lien (de parole) à l’Autre dans l’analyse en vient à être délié, ouvert.
Nous en venons aussi ici, à mon sens, en ce point où Lacan parfois problématiquement confond le désir et la jouissance. Et où parfois, lorsqu’il insiste manifestement sur le geste, pour l’analyste, de ne pas céder sur son désir, en fait plutôt, de manière latente, oriente l’analyste vers le fait de ne pas céder sur sa jouissance[41].
En ce sens, selon Darian Leader, la théorie de Lacan du pur Un de jouissance et du primat du manque (parce que comme le dit Darian Leader la douleur, ainsi que la haine et la rage, sont évitées dans la cure) n’est pas en mesure d’aider l’analyste à soutenir solidement le patient dans le sens d’une sortie de la compulsion de répétition. Cela est d’ailleurs, ajoute l’auteur, à relier à la manière dont la théorisation de Lacan, concernant la jouissance, passant par l’élaboration de la réflexion de Hegel sur le maitre et l’esclave, est insuffisante. Ce dans la mesure où, affirmant que le maitre ne jouit pas, Lacan évite la question de la jouissance du maitre (p. 66). Cela empêche d’ailleurs Lacan, ajouterais-je, d’aller jusqu’au bout des élaborations pourtant ouvrantes sur la question du pouvoir.
**
Darian Leader insiste sur la nécessité d’historiciser l’œuvre de Lacan, pour approfondir les problématisations et les élaborations fécondes de son enseignement, en même temps que d’autres de ses élaborations sont à critiquer, abandonner ou à reprendre. En ce sens, montre l’auteur, Lacan a l’immense mérite de problématiser les mécanismes de la jouissance. Mais son élaboration sur la jouissance gagne à être remise en perspective, afin d’éviter différentes apories. Parmi ces apories, l’on trouve tout d’abord les limites de sa théorie du stade du miroir (p. 46sq.) – limites qu’a aussi relevées Lucien Israël[42].
En fait, c’est l’ensemble des réflexions de Lacan sur la jouissance, que Darian Leader retraverse et remet en perspective. Ce entre autres pour insister sur le fait que c’est selon lui dans son virage de 1963, dans le séminaire sur L’Angoisse, que l’enseignement de Lacan se rigidifie. Dans ce séminaire, Lacan pose en effet, à la suite des textes de Freud où il déploie, j’y reviens, un modèle fermé[43], celui de l’existence d’une monade, sans lien à l’Autre, etsoi-disant primaire. Bref, le sujet est ici défini comme (je cite le séminaire X. de Lacan lu par Darian Leader p. 46 de son livre) une « réserve de libido » liée à « ce qu’on appelle auto-érotisme », ou encore une « jouissance autiste »[44].
Plus encore, cette théorie du sujet comme monade chez Lacan, Darian Leader nous invite, en lien à ce qui concerne le modèle RSI, à la relier au « sinthome » de Lacan (p. 127) . Je parle ici de sinthome car l’auteur voit dans « la fascination de Lacan pour les bouts de ficelle et les noeuds », lié à la topologie, un « sinthome », « une tentative de trouver un point de cohérence dans son monde ». La théorie de Lacan des 3 anneaux renvoyant au « logo de l’entreprise de son père » (p.127-128), et constituant ainsi une écriture sinthomale, liée au sinthome de son père – en un geste fondamental de création sinthomale. Bref, la théorie de RSI et du sinthome constituent bien une ouverture fondamentale pour la psychanalyse, dans laquelle s’est déployée le propre sinthome de Lacan, de manière créative. Mais la forme d’élaboration topologique de RSI de Lacan, selon l’auteur (j’en parlerai plus loin), laisse de côté certaines questions qu’il serait pourtant intéressant de prendre en compte, pour ouvrir à un freudo-lacanisme plus solidement subjectivant.
Je le répète, il en va ici de la théorie de Lacan, posant l’existence, nous dit donc Darian Leader, d’une « monade isolée », d’un « pur Un de jouissance », voyant dans l’autoérotisme quelque chose où le sujet serait indemnisé de tout lien à l’Autre (p. 13). Ce à quoi Lacan ajoute, dit Darian Leader, le déploiement de la part de l’analyste du petit « a« comme « positivation du manque » (p.113). Pour Lacan, l’objet petit a – qu’il a si fécondement inventé en 1963 – permet la mise en crise de la subjectivité monadique, du pur « Un de jouissance » qui structurerait la parole du sujet (p.113).
Une remarque ici : alors que Darian Leader voit dans l’objet petit a de Lacan une positivation du manque, autrement dit l’expression d’un primat du manque, j’aurais pour ma part tendance à insister sur le fait que l’objet petit a, Lacan le pense plutôt dans l’expérience dialectique de l’analyse, articulant d’un côté manque, expérience de la finitude, et de l’autre joie et satisfaction – satisfaction devenue subjectivante par l’analyse, comme je le l’ai dit plus avant.
Mais j’en reviens à cette théorie monadique du sujet que Lacan déploie à partir des années 60. Dans cette théorie, selon Darian Leader, la « raison de la répétition », qui est à chercher dans le lien factuel à l’Autre, est « évitée ». Ce qui n’a pas toujours été le cas chez Lacan. En effet, cette « raison de la répétition » est, montre Darian Leader, ailleurs « traitée » par le « premier » Lacan (p. 113)[45]. En effet, avance l’auteur[46], dans son texte sur Gide publié dans les Ecrits, et datant de 1958, il relie en effet, la « jouissance primaire » à « la tentative de séparation d’avec l’Autre » (p. 84).
De la même manière, Darian Leader développe dans ce livre ce qu’il considère comme les limites, malgré ses apports, du modèle topologique de Lacan[47]. En effet, celui-ci, parce qu’il « évite » de « donner » des « qualités positives » à la « Chose », n’est « pas en mesure » de nous permettre de penser psychanalytiquement la manière dont la « Chose (…) ‘appell(e)’ le sujet ou l’attir(e) vers elle » (p. 67-68). En d’autres termes, ce modèle topologique ne nous permet pas de penser la factualité du lien (de parole) du sujet à l’Autre. Ce même si, selon l’auteur, Lacan est pourtant sur la bonne voie, dans le Séminaire sur l’Ethique, lorsqu’il nous dit que « l’insondable agressivité » – la jouissance, commente Darian Leader -, qui habite pulsionnellement le sujet, est liée à la « Chose »[48] (p. 67).
**
Pour élaborer de manière personnelle les apports majeurs du livre de Darian Leader, j’aimerais brièvement développer plusieurs points.
Premièrement, pour ma part j’aurais tendance à moduler sa mise en perspective de l’évolution ou de l’oscillation de Lacan sur cette question du lien à l’Autre et de la relation d’objet. En effet, Lacan, dans le séminaire IV (1956-1957) sur la relation d’objet, développe une critique développée de la théorie de la relation d’objet. Et si Darian Leader évoque peu ce séminaire, j’aurais de mon côté tendance à dire que Lacan, dans son évolution pratique et théorique, est passé d’un refus ambivalent de la question de la relation d’objet, où il a donc parfois, pour des raisons cliniques, reconnu malgré tout son existence ; à un refus plus massif, à partir des années 60.
Deuxièmement, j’aurais pour ma part aussi tendance à dire que si Lacan a à raison ferraillé contre les théories de la relation d’objet sous leurs formes fermées, désubjectivantes et normalisatrices (particulièrement dans son débat avec Bouvet), son orientation subjective et la virulence de ce conflit l’ont amené à critiquer les théories de la relation d’objet en général, et donc aussi les théories plus subjectivantes de la relation d’objet – même si dans les faits il a largement mis au travail Klein, Balint, Winnicott, ou encore Fromm (concernant ce dernier, voir plus loin). D’ailleurs, c’est dans son débat avec les psychanalystes de la relation d’objet, et avec l’objet transitionnel de Winnicott, que Lacan a développé sa théorie de l’objet petit a.
Troisièmement, concernant la théorie de l’objet petit a, je considère – avec d’autres[49] – que, au regard de l’expérience psychanalytique et de l’histoire de la psychanalyse, c’est une invention fondamentale de Lacan, un concept nous permettant, comme chez Lacan, d’élaborer de manière très ouvrante les problèmes de la perte et du manque, et de la pulsion partielle et de la destructivité. Ce en déployant une pratique psychanalytique échappant au primat du manque, mais relevant plutôt d’un » « expérience dialectique » articulant d’un côté perte, manque expérience de la finitude, et de l’autre rencontre, satisfaction et joie subjectivantes. Il reste qu’ici Darian Leader nous pose une question importante, concernant la théorie de l’objet petit a, dans l’interrogation sur le fait que cette théorie de Lacan ne prend peut-être pas assez en compte la dimension de lien à l’Autre, avec les affects de rage, de haine. En ce sens, il propose une alternative très ouvrante pour l’élaboration psychanalytique des questions de la perte et du manque, et du destin de la destructivité – sans il me semble pour autant évoquer les pulsions partielles, qui sont le coeur de l’expérience psychanalytique de l’objet petit a.
Ainsi cette théorie alternative de Darian Leader, l’analyste, dans sa petite théorie portative, gagne je pense à la méditer et à l’élaborer, car elle touche juste concernant certains points de butée de la théorie de Lacan, et nous permet d’envisager des problèmes que Lacan – comme Freud – ne prend en compte que partiellement, ou pas vraiment.
Quatrièmement, concernant la topologie de Lacan, je considère aussi – avec d’autres – que, au regard de l’expérience psychanalytique et de l’histoire de la psychanalyse, c’est une invention importante de Lacan, une théorie nous permettant d’élaborer de manière ouvrante les questions de la structure de la parole et de la vie psychique du sujet. Pour autant, Darian Leader me semble ouvrir ici encore à une perspective qui touche juste concernant certaines limites de cette théorie – dont la manière dont les mathèmes et la topologie lacaniennes déploient une parole laissant de côté l’affect -, et proposer une élaboration alternative fort féconde par beaucoup de points, en prenant en compte la question du lien à l’Autre.
**
Concernant la relation de Lacan à Fromm dont j’ai parlé, j’évoquerai la caractérisation par Darian Leader, a priori fort étonnante mais si éclairante, du fait que, concernant sa propre théorie de la singularisation de la parole et du désir, Lacan, même s’il passe ce fait sous silence, doit beaucoup à Erich Fromm[50]. Fromm qu’il a vertement critiqué pour ses importantes limites concernant les questions de la sexualité et de la pulsion). En effet, comme le montre Darian Leader (p. 65sq), Fromm a été largement lu par Lacan, en même temps que celui-ci le critiquait à raison. Lacan a ainsi particulièrement mis au travail, dans une autre perspective, le texte de Fromm de 1936 écrit en collaboration avec Horkheimer et Adorno dans un volume collectif sur la question de l’autorité. Dans ce texte, Fromm insiste sur le fait que le sujet « incorpore le discours parental et culturel », tandis que « la psychanalyse suppose de différencier notre propre désir de la demande de ce dernier » (p. 66-67). Ce que Lacan donc met largement au travail, dans une optique différente. Et puis le fait que Lacan ne fasse pas référence à cette reprise est tout à fait logique, dans la mesure où son enseignement s’oppose sur bien des points à Fromm – dont la réflexion a donc de très importantes limites, dans sa difficulté à prendre en compte la sexualité et la pulsion. Mais cela ne nous empêche pas, nous, de pouvoir relever, grâce à Darian Leader, ce lien de Lacan à Fromm, malgré tout[51].
**
Ce livre de Darian Leader est aussi important, concernant Lacan, pour mettre en perspective sa réflexion sur le « féminin » et le « masculin », particulièrement dans le séminaire Encore (1972-1973). En effet, la réflexion de Lacan sur le « féminin » et le « masculin » dans Encore apparait selon l’auteur, malgré une avancée réelle, encore prise dans les limites du discours collectif – que je qualifierais de patriarcal – de son époque. Ce dans la mesure où Lacan « est, semble-t-il, impressionné par les femmes qui se sacrifient » (p. 119) [52]. Ce qui constitue un élément fort intéressant dans le débat sur les apports et les limites de Lacan concernant la sexualité féminine.
Plus encore, Darian Leader avance d’autres pistes théoriques fort novatrices, par exemple celle selon laquelle l’élaboration discursive par le sujet de sa sexualité vise à représenter le lien à l’Autre (p. 89 et 93).
Un autre point fort novateur du livre est la manière dont, dans nos sociétés que je qualifierais de postmoderne, au mythe patriarcal du père de la horde jouissant de toutes les femmes, s’est substitué le nouveau mythe d’un père de la horde numérique qui absorbe tous les datas, dans le sens d’une omniscience qui lui permet d’exploiter ces données et d’en jouir (p. 72).
**
Pour ceux d’entre vous qui comprennent l’anglais, je mets ici le lien vers la passionnante intervention de Darian Leader concernant et à partir de son ouvrage, sur postcast Rendering uncounscious, de Vanessa Sinclair.
Darian Leader est psychanalyste à Londres, membre de Centre for Freudian Analysis and Research. Il a publié (de nombreux livres ont été traduits en français):
Bibliographie en anglais :
- Lacan for Beginners, 1995, later editions with a changed title: Introducing Lacan (2000, 2005)
- Why Do Women Write More Letters Than they Post?, 1996
- Promises Lovers Make When It Gets Late, 1997
- Freud’s Footnotes, 2000
- Stealing the Mona Lisa: What Art Stops Us from Seeing, 2002
- Why Do People Get Ill? Exploring the Mind-Body-Connection (with David Corfiel), 2007
- The New Black. Mourning, Melancholia and Depression, 2008
- What Is Madness?, 2011
- Strictly Bipolar, 2013
- Hands: What We Do With Them – and Why, 2016
- Why Can’t We Sleep?, 2019
- Jouissance: Sexuality, Suffering and Satisfaction. 2021
- Is It Ever Just Sex? 2024
Traduit chez Stilus:
- Qu’est ce que la folie? 2017
Récemment publié en francais:
- Qu’est-ce que cache le sexe? Albin Michel, 2024
Son site : https://www.darianleader.com/
[1] Non sans garder toutefois quelque insatisfaction concernant cette élaboration, qui passe sans doute à côté d’éléments importants de ce livre si riche.
[2] Comme l’a montré Nestor A. Braunstein. La jouissance, un concept lacanien, Stilus, 1992.
[3] Guénaël Visentini, Ecrire et penser par cas en psychanalyse.
[4] Sur ce nouveau contexte, que je qualifie de postmoderne, en définissant de manière irréductible personnelle et positive ce terme, je me permets de renvoyer à Dimitri Lorrain (2024) sur Maggie Nelson. https://dimitrilorrain.org/2024/12/06/sortie-de-refaire-famille-pour-en-finir-avec-les-stereotypes-de-genre-coordonne-par-thierry-goguel-dallondans-anthropologue-univ-strasbourg-et-jonathan-nicolas-psyc/
Sachant que certains bouleversements politiques et culturels récents allant dans le sens de l’autoritarisme produisent de nouvelles modifications de notre contexte.
[5] Jean-Michel Rabaté, Lacan l’irritant: https://dimitrilorrain.org/2024/03/26/sur-lacan-lirritant-de-jean-michel-rabate-stilus-2023/
[6] Ce pour dire les choses avec Leclaire dans son débat avec Lacan. Voir Rompre les charmes.
[7] Ce que j’aurais pour ma part sans doute tendance à faire quelque peu.
[8] Concernant Freud, voir particulièrement Darian Leader, La question du genre.
[9] Je rejoins ici ce qu’écrit Guénaël Visentini sur la fécondité d’une psychanalyse non freudo-centrée.
[10] D’ailleurs largement nourrie des travaux de Genevière Morel, La loi de la mère.
[11] Une lecture serrée de Winnicott montre à mon sens qu’il prend en compte à sa manière la sexualité au sens freudien, de manière certes spécifique.
[12] Sur ce point précis d’ailleurs, il reprend Balint, comme il le dit explicitement . En effet, Balint, dans Le Défaut fondamental, étudie chez Freud les limites de sa réflexion pour ouvrir sur la question de la relation à l’objet ou du lien à l’autre. Il étudie aussi les oscillations de Freud qui lui font ouvrir à une réflexion sur cette dernière.
[13] Sur la joie dans la pratique analytique, voir d’ailleurs Lacan lorsqu’il dit « quelle joie trouvons-nous dans ce qui fait notre travail ? » in « Allocutions sur la psychose de l’enfant », Autres écrits p. 369. Sur la satisfaction selon Lacan, j’aimerais rappeler que la pulsion est vécue à la fin de l’analyse à partir de la marque de la satisfaction: « Le mirage de la vérité (…) n’a d’autre terme que la satisfaction qui marque la fin de l’analyse. Donner cette satisfaction étant l’urgence à quoi préside l’analyse » « Préface à l’édition anglaise », Autres écrits, p. 572.
Sur Lacan concernant la satisfaction et la joie dans le processus analytique, voir Lucien Israël, Boiter n’est pas pécher, Erès, 2010; Luis Izcovich, Urgence et satisfaction, Stilus, 2022.
[14] Sur cette question, je renvoie à un texte à venir.
[15] Israël va en ce sens. Luis Izcovich aussi.
[16] Je préfère parler de « finitude » que de « castration ». Pour ma part, et pour le dire trop vite, je considère que la théorie par Lacan du « complexe de castration » est une formulation contextuellement datée, phallocentrée (voir particulièrement Laplanche (1980), S. Lippi et P. Maniglier (2023)), du fait que l’Autre barré est porteur du manque et de la finitude, et que le sujet, s’il se subjective, est psychiquement et discursivement structuré par le manque et la finitude – de l’Autre et la sienne.
[17] Lacan: « il n’y a pas de désir dans l’analyse si c’est uniquement dans la dépression » in « L’étourdit ». Voir Izcovich p. 83-84.
[18] Lacan sur l’enthousiasme: « S’il n’est pas porté à l’enthousiasme, il peut bien y avoir analyse, mais d’analyste aucune chance » (Note italienne, dans Autres écrits p. 309). Izcovich p. 49sq.
[19] La « hâte » est la « liaison propre de l’être humain au temps (…). (..) c’est là que se situe la parole » (Séminaire XVI, D’un Autre à l’autre, p. 209. Voir Izcovich, p. 160-164.
[20] Je rejoins ici Lucien Israël et Luis Izcovich.
[21] Voir sur ce point mon texte https://dimitrilorrain.org/2025/09/23/les-differents-temps-de-la-subjectivation-analytique-logique-sociale-de-limmediatete-jouissance-et-subjectivation-mon-intervention-a-la-formation-apertura-du-27-novembre-2024-a/. Cette psychanalyse dialectique capable donc d’une positivité en tension rejoint en cela les élaborations en faveur d’une psychanalyse nourrie du féminisme et de la théorie queer. Je développe ailleurs des éléments pour une psychanalyse ainsi nourrie du féminisme et de la théorie queer: https://dimitrilorrain.org/2023/04/09/texte-dynamique-de-parole-creatrice-et-creation-du-lien-de-parole-desirant/
[22] Ce dans sa tendance allant dans le sens d’un éloge de la jouissance, voir P. Guyomard, La jouissance du tragique. Antigone, Lacan et le désir de l’analyste, Paris, Aubier , 1992.
[23] Trois essais sur la théorie sexuelle.
[24] Jorge Reitter, Heteronormativity and psychoanalysis. https://dimitrilorrain.org/2023/01/13/sortie-de-heteronormativity-and-psychoanalysis-de-jorge-n-reitter-routledge-2023/
[25] Ici Darian Leader élabore largement Bergler (p. 37).
[26] Identity and the life circle.
[27] Ce qui rejoint ce qu’élabore Jean-Pierre Marcos : https://dimitrilorrain.org/2023/07/14/jean-pierre-marcos-il-faut-renoncer-a-la-jouissance-davoir-ete-lobjet-de-la-jouissance-de-lautre-pour-faire-se-lever-le-desirconference-longtemps-jai-joue-a-me-sep/
[28] Boiter n’est pas pécher.
[29] Voir Lucien Israël, Boiter n’est pas pécher; Luis Izcovich, Urgence et satisfaction.
[30] Boiter n’est pas pécher.
[31] Nous retrouvons ici la question du fantasme du Sujet Supposé Savoir ; Darian Leader insiste avec Geneviève Morel (La loi de la mère) sur le fait que la vie fantasmatique ne peut être réduite à cet unique fantasme, à moins de risquer une refermeture pratique et théorique de la psychanalyse.
[32] Ce qui rejoint ce que dit Balint sur cette question.
[33] L’on pensera aussi aux menaces surmoïques de castration dont parle Freud, concernant les pratiques masturbatoires du sujet, et qui vont dans le sens de sa désubjectivation. Ce qui ne sera pas non sans nous orienter pour mettre en perspective ce que nous dit Freud de la castration. Sur ce point, voir particulièrement J. Laplanche, Problématiques II. Castrations, symbolisations, PUF, 1980. Voir aussi le livre récent de S. Lippi et P. Maniglier.
[34] « Propos directif pour un congrès sur la sexualité féminine ».
[35] Darian Leader rejoint ici Balint.
[36] Ecrits.
[37] Boiter n’est pas pécher.
[38] Les Quatre concepts fondamentaux de la psychanalyse.
[39] Darian Leader, Qu’est-ce que la folie?
[40] Voir https://dimitrilorrain.org/2023/04/09/texte-dynamique-de-parole-creatrice-et-creation-du-lien-de-parole-desirant/.
[41] Patrick Guyomard, La jouissance du tragique. Antigone, Lacan et le désir de l’analyste, Paris, Aubier , 1992.
[42] Boiter n’est pas pécher.
[43] Concernant Freud, voir la critique de Balint dans Le Défaut fondamental.
[44] Séminaire X, L’Angoisse, Seuil, p. 57.
[45] Darian Leader ajoute à cela que premier Freud pose aussi une élaboration en ce sens, dans ses études sur l’hystérie, concernant Emmy von M. (p. 124).
[46] En élaborant les réflexions de G. Morel (La Loi de la mère, 233sq).
[47] J’ai développé plus avant, en quoi selon Darian Leader le modèle topologique est lié au sinthome de Lacan.
[48] Séminaire V., L’éthique de la psychanalyse, Seuil, p. 219.
[49] En premier lieu Lucien Israël, Boiter n’est pas pécher ; et Luis Izcovich, Urgence et satisfaction.
[50] Voir particulièrement La Peur de la liberté.
[51] Et, pour finir sur ma lecture singulière de ce livre, ce lien de Lacan à Fromm, en ce qui concerne sa théorie de la singularisation de la parole et du désir, est un point particulièrement ouvrant du livre. De mon côté, j’ai ailleurs justement travaillé sur le lien que l’on peut faire – avec Lucien Israël – entre d’un côté la théorie de Lacan de la singularisation de la parole et du désir, et de l’autre la réflexion d’Adorno sur l’autonomisation psychique et discursive du sujet. Or, comme on le sait, Adorno fait comme Fromm partie de l’Ecole de Francfort, et ils ont, malgré de vifs débats, en commun une telle réflexion sur l’autonomisation psychique et discursive. En même temps qu’Adorno a largement et à juste titre critiqué Fromm, justement sur ses limites en ce qui concerne la question cruciale, de la prise en compte de la sexualité et de la pulsion (Voir particulièrement Th. W. Adorno, « La psychanalyse révisée »). Ce justement afin d’ouvrir à une pensée de l’autonomisation psychique et discursive qui prenne pleinement en compte, avec Freud, la sexualité et la pulsion. Mais qui aussi inscrit le sujet dans un lien à l’Autre ouvrant, s’opposant ainsi à une conception « monadique » du sujet, qu’Adorno critique. Le concept de « monade » apparaissant d’ailleurs dans ses travaux (Minima Moralia). Dans sa lecture de Lacan nourrie d’Adorno, Lucien Israël réélaborera le problème de l’autonomisation discursive et psychique par rapport aux logiques de pouvoir.
Je me permets de renvoyer à https://dimitrilorrain.org/2023/06/09/texte-que-peut-nous-dire-la-psychanalyse-de-lautorite-et-de-la-transmission-aujourdhui/.
[52] Concernant son analyse des apports et des limites de Lacan concernant la sexualité féminine, on pourra aussi lire le texte de Darian Leader « The gender question from Freud to Lacan », dans le volume collectif dirigé par P. Gherovici et M. Steinkoler, Psychoanalysis, Gender and sexuality, Routledge, 2023. Voir sur mon blog: https://dimitrilorrain.org/2023/04/17/video-patricia-gherovici-et-manya-steinkoler-sur-sur-leur-livre-psychoanalysis-gender-and-sexualities-from-feminism-to-trans-routlegde-2022-rendering-uncounscious-2023-en-a/
Animé par Dimitri Lorrain.
Le 1er jeudi du mois, à 21h.
Par Zoom.
Programme 2025-2026 :
2/10/2025 : Dimitri Lorrain (psychanalyste, philosophe, chargé de cours à l’université de Strasbourg): « Cheminement de genre, lien subjectivant et subjectivation ; critique et mise en perspective de la théorie du ‘féminin’/’masculin’ chez Freud »
6/11/2025 : Virginie Valentin (psychanalyste et anthropologue ): « Retour sur Freud et sa ´neurotica’: malaise dans la séduction »
4/12/2025 : Dialogue avec Laurie Laufer (psychanalyste, univ. Paris-Cité) autour de son dernier ouvrage ‘Les héroïnes de la modernité’; échanges avec Benjamin Lévy, Dominique Marinelli, Ondine Arnould, Virginie Valentin, Dimitri Lorrain…
8/1/2026 : Dimitri Lorrain : Subjectivation et hétéro-patriarcat
5/2/2026 :Dialogue avec Isabelle Alfandary (psychanalyste et philosophe, Sorbonne-Nouvelle) autour de son dernier ouvrage ‘Le scandale de la séduction. D’Oedipe à #Metoo’: échanges avec Virginie Valentin, Stéphane Muths, Dimitri Lorrain…
5/3/2026 : Pas de séminaire
2/4/2026 : Ondine Arnould (philosophe) sur le « féminin » et le « masculin » chez Lou Andreas-Salomé
*
Intervenants 2026-2027
Michèle Benhaïm (psychologue, psychanalyste, Univ. Aix-Marseille)
Benjamin Lévy (psychologue, psychanalyste, Paris)
Christophe Lucchese (traducteur) sur Fantasmâlgories de Klaus Thewelheit
Stéphane Muths (psychologue, psychanalyste, Strasbourg)
Jorge Reitter (psychanalyste, Buenos Aires) sur Les Aveux de la Chair de Michel Foucault
Frédérique Riedlin (psychanalyste, Strasbourg)
Virginie Valentin (psychanalyste, anthropologue, Paris)
Dimitri Lorrain : Eléments pour une psychanalyse freudo-lacanienne élargie élaborant solidement la clinique post-Metoo ; Amour et érotisme créatif ; La pensée queer d’Eve Kosofsky Sedgwick et ses apports à la psychanalyse
Séance sur les réflexions de D.W. Winnicott concernant Freud, la créativité dans le couple et le ´féminin’/‘masculin’
**
Pour demander à participer, écrire à lorrain.dimitri@gmail.com.
Notre travail collectif portera sur les questions du « féminin » et du « masculin », concernant la clinique et la théorie psychanalytiques.
Nous nous intéressons à l’étude de l’œuvre et du geste de Freud dans son contexte historique et culturel (psychanalytique, psychiatrique, intellectuel, philosophique, littéraire, artistique, etc.). Nous essayons d’envisager la portée à la fois clinique, théorique et culturelle de son œuvre dans le contexte actuel. Il s’agit donc de lire Freud, de le discuter, afin d’ouvrir des pistes théoriques pour la clinique contemporaine. Ce en caractérisant la dynamique de son œuvre et la manière dont Freud a traversé ses propres résistances.
En ce sens, nous lisons Lacan, mais aussi et entre autres les élèves strasbourgeois de Lacan (par exemple Lucien Israël), afin de transmettre et de pratiquer un freudo-lacanisme solidement ouvert.
Pour travailler sur le contexte de Freud, nous étudions aussi le cheminement des femmes psychanalystes de l’époque de Freud et certaines grandes oeuvres, dont littéraires, de l’époque de Freud (Andreas-Salomé, Nietzsche, Rilke, Schnitzler, S. Zweig…).
Nous partirons du fait que les signifiants « féminin » et « masculin », et les autres signifiants liés au genre et à la sexuation, sont des catégories construites par des discours collectifs, à la fois historiques et culturels. Ils sont toujours énoncés depuis la parole du sujet, située dans son contexte discursif. Or, l’écoute analytique, lorsqu’elle est ouverte au contemporain, constate factuellement que notre contexte discursif est globalement marqué par des normes patriarcales, mais aussi hétérocentrées et binaires. Dès lors, comment, dans la cure, écouter les signifiants « féminin » et « masculin », et les autres signifiants liés au genre et à la sexuation, mais aussi les désirs, les fantasmes et les normes auxquels ils sont associés, depuis la dynamique de parole du sujet singulier, et sa situation singulière par rapport à ces normes ?
Toujours dans la cure, on pourra se demander ce que cela implique concernant la relation du sujet à sa et à la sexualité, à l’amour, à son orientation sexuelle, à son cheminement de genre, aux normes. Et ce que l’expérience de la cure nous apprend de l’évolution contemporaines des normes.
Comment envisager la pratique et la pensée de Freud (prises dans leur contexte) au regard de ces interrogations ? Qu’est-ce que l’étude et la critique de son oeuvre nous apporte ? Et quelles implications cela peut-il avoir pour la pratique de la psychanalyse ?
Dans ce cadre, nous envisageons et discutons de manière psychanalytique les apports de l’anthropologie, de la philosophie (particulièrement Foucault), des pensées féministes et queer, et des études de genre, gaies, lesbiennes, trans, et sur la masculinité, les plus stimulantes. Nous envisageons aussi la psychanalyse contemporaine qui élabore de tels apports.
Cette année, nous nous intéresserons particulièrement aux premières théories de Freud (théories de la séduction et du fantasme) et à la pratique d’une psychanalyse soutenant à la fois le déploiement d’une dynamique créative de parole (1) et la reconnaissance de la réalité psychique (2), au regard de la prise en compte des violences sexuelles et de leur omniprésence dans nos sociétés et donc dans la clinique (3). Nous dialoguerons avec Laurie Laufer à propos de son passionnant ouvrage « Les héroïnes de la modernité », puis avec Isabelle Alfandary sur son si important « Le scandale de la séduction. D’Oedipe à #Metoo ». Nous envisagerons ce qu’il en est du cheminement de genre subjectivant et de la subjectivation dans le système hétéro-patriarcal; nous parlerons du « féminin »/ »masculin » chez Freud donc, mais aussi chez Lou Andreas-Salomé.
Plus tard dans notre programme, nous parlerons de : Les Aveux de la chair de Michel Foucault; Fantasmâlgories de Klaus Thewelheit ; la psychanalyse solidement subjectivante à l’heure de la clinique post-Metoo; l’érotisme subjectivant (en élaborant sur les réflexions des psychanalystes Laurie Laufer, Darian Leader et Winnicott, et les pensées queer de Maggie Nelson et Eve Kosofsky Sedgwick); la pensée queer d’Eve Kosofsky Sedgwick et ses apports à la psychanalyse. Nous étudierons aussi les réflexions de Winnicott sur le « féminin »/ »masculin », sur la créativité dans le couple (et dans le sexe) et sur le cheminement clinique et théorique de Freud.
Pour cela, nous invitons des intervenantes et des intervenants psychanalystes et appartenant aux champs connexes à la psychanalyse. Bref, le séminaire associe des personnes venant de différents champs, différentes générations, différents pays.
Notes :
(1) : Envisagée selon la lecture créative qu’a Lucien Israël (Boiter n’est pas pécher) de Lacan.
(2) : Selon l’exigence de Freud, posée au fondement de la psychanalyse : voir particulièrement Vorlesungen zur Einführung in die Psychoanalyse (Leçons d’introduction à la psychanalyse), 1916-1917.
(3) : Sur cette question, voir particulièrement le récent livre d’Isabelle Alfandary, Le scandale de la séduction, dont nous parlerons.
Bibliographie pour notre travail de cette année :
– Sigmund Freud, Vorlesungen zur Einführung in die Psychoanalyse (Leçons d’introduction à la psychanalyse), texte de 1916-1917
– Sigmund Freud, Lettres à Wilhelm Fliess 1887-1904, PUF, nouvelle édition 2006
– Jacques Lacan, Le Séminaire Livre VI, 1958-1959, Le désir et son interprétation, 2013
– Lucien Israël, Boiter n’est pas pécher, érès-Arcanes, coll. Hypothèses, 2010
– Isabelle Alfandary, Le scandale de la séduction, PUF, 2024
-Dorothée Dussy, Le berceau des dominations, Pocket, 2021 (1e éd. 2013)
-Camille Froidevaux-Metterrie (dir.), Théories féministes, Seuil, 2025
-Darian Leader, Qu’est-ce que cache le sexe?, Albin Michel, 2024
– Nicolas Evzonas, Devenir trans de l’analyste, PUF, 2023
-Laurie Laufer, Les héroïnes de la modernité. Mauvaise fille et psychanalyse matérialiste, La Découverte, 2025
– Eve Kosofksy Sedgwick, Epistémologie du placard, Amsterdam, 2008, texte de 1990
-Darian Leader, Qu’est-ce que cache le sexe?, Albin Michel, 2024
– Benjamin Lévy, L`ère de la revendication, Flammarion, 2022
-Dimitri Lorrain, « Cheminements de genre et de faire-famille », in Thierry Goguel d’Allondans et Jonathan Nicolas (dir.), Refaire famille, pour en finir avec les stéréotypes de genre, Chronique sociale, 2025.
-Maggie Nelson, Les Argonautes, Éditions du sous-sol, 2018, texte de 2015.
-Jorge Reitter, Heteronormativity and psychoanalysis, Routledge, 2023
– Donald W. Winnicott, « Vivre créativement », dans Conversations ordinaires, Gallimard, 1988, p. 54-77, texte de 1966
– Donald Winnicott, « Sigmund Freud », in Lectures et portraits, Gallimard, 2012, p. 281-290, texte de 1962
Autres interventions et intervenants à venir :
Jorge Reitter (psychanalyste, Buenos Aires) sur Michel Foucault,Les aveux de la chair ; sur le « féminin » et le « masculin » d’après Lucien Israël dans Boiter n’est pas pécher; Eléments pour une histoire des femmes psychanalystes (3): Mélanie Klein; sur Simone de Beauvoir, Le Deuxième sexe; sur bell hooks, A propos d’amour et La volonté de changer; sur Daniel Boyarin, Unheroic Conduct: The Rise of Heterosexuality and the Invention of the Jewish Man; sur le « féminin » et le « masculin » chez Stefan Zweig et Schnitzler…
Bibliographie pour notre travail de cette année :
– Sigmund Freud, Vorlesungen zur Einführung in die Psychoanalyse (Leçons d’introduction à la psychanalyse), texte de 1916-1917
– Sigmund Freud, Lettres à Wilhelm Fliess 1887-1904, PUF, nouvelle édition 2006
– Jacques Lacan, Le Séminaire Livre VI, 1958-1959, Le désir et son interprétation, 2013
– Lucien Israël, Boiter n’est pas pécher, érès-Arcanes, coll. Hypothèses, 2010
– Isabelle Alfandary, Le scandale de la séduction, PUF, 2024
– Nicolas Evzonas, Devenir trans de l’analyste, PUF, 2023
– Eve Kosofksy Sedgwick, Epistémologie du placard,Amsterdam, 2008, texte de 1990
-Laurie Laufer, Les héroïnes de la modernité. Mauvaise fille et psychanalyse matérialiste, La Découverte, 2025
-Darian Leader, Qu’est-ce que cache le sexe?, Albin Michel, 2024
– Benjamin Lévy, L`ère de la revendication, Flammarion, 2022
-Dimitri Lorrain, « Cheminements de genre et de faire-famille », in Thierry Goguel d’Allondans et Jonathan Nicolas (dir.), Refaire famille, pour en finir avec les stéréotypes de genre, Chronique sociale, 2025.
-Maggie Nelson, Les Argonautes, Éditions du sous-sol, 2018, texte de 2015.
-Jorge Reitter, Heteronormativity and psychoanalysis, Routledge, 2023
– Donald W. Winnicott, « Vivre créativement », dans Conversations ordinaires, Gallimard, 1988, p. 54-77, texte de 1966
– Donald Winnicott, « Sigmund Freud », in Lectures et portraits, Gallimard, 2012, p. 281-290, texte de 1962
Bibliographie générale (non exhaustive) :
– Sigmund Freud, Trois essais sur la théorie sexuelle (1905), Gallimard, 1989
– Sigmund Freud, « Le tabou de la virginité » (1918), in La vie sexuelle, PUF, 1969
– Sigmund Freud, « Sur la sexualité féminine » (1931), in La vie sexuelle, PUF, 1969
– Sigmund Freud, « La féminité » (1932), in Nouvelles conférences d’introduction à la psychanalyse, Gallimard, 2002
– Jacques Lacan, Le Séminaire, Livre XX, 1972-1973, Encore, Seuil, 1975
– Jean Allouch, « L’homosexualité en Grèce et à Rome », entretien avec Sandra Boehringer et Louis-George Tin,, https://www.jeanallouch.com/document/139/2010-Entretien-avec-Sandra-Boehringer-et-Louis-Georges-Tin (in Sandra Boehringer et Louis-Georges Tin, Homosexualité. Aimer en Grèce et à Rome
Les Belles Lettres, 2010
– Simone de Beauvoir, Le Deuxième sexe I. et II., Gallimard, 1949 et 1951
– Daniel Boyarin, Unheroic Conduct: The Rise of Heterosexuality and the Invention of the Jewish Man, University of California Press, 1997.
– Judith Butler, Défaire le genre, Amsterdam, 2013
– Fabrice Bourlez, Queer psychanalyse, Hermann, 2018
– Emmanuelle Chatelat, https://dimitrilorrain.org/2023/02/15/emmanuelle-chatelat-desirez-et-vous-etes-libre-car-un-desir-qui-nest-pas-libre-nest-pas-concevable-nest-pas-un-desir/
– Jacques Derrida, « Le facteur de la vérité », dans La carte postale, de Socrate à Freud et au-delà, Flammarion, 1980
– Jean-Pierre Dreyfuss, Jean-Marie Jadin, Marcel Ritter, Qu’est-ce que l’inconscient ?, Erès, 2016
– Michel Foucault, Les Aveux de la chair, éd. F Gros, Gallimard, 2018
– Camille Froidevaux-Metterie, La révolution du féminin, Gallimard, 2015
– Manon Garcia, La Conversation des sexes, Philosophie du consentement, Flammarion, 2021
– Olivia Gazalé, Le mythe de la virilité, Robert Laffont, 2017
– Patricia Gherovici, Transgenre : Lacan et la différence des sexes, Paris, Stilus, 2021
– Patricia Gherovici et Manya Steinkoler, Psychoanalysis, Gender and Sexualities: From Feminism to Trans*, Routledge, 2022
– Françoise Héritier, Masculin/féminin 1., Odile Jacob, 1995
– bell hooks, A propos de l’amour, Divergences, 2022
– Lucien Israël, Boiter n’est pas pécher, Arcanes-érès, 2010, particulièrement « Que reste-t-il de notre amour ? », p. 153-162
– Thierry Goguel d’Allondans et Jonathan Nicolas (dir.), Refaire famille. Pour en finir avec les stéréotypes de genre, Chronique sociale, à paraître en 2024
– Françoise Héritier, Masculin/féminin 1, Odile Jacob, 1995
– Jean Laplanche, Problématiques II. Castration et symbolisations, PUF, 1980
– Thomas Laqueur, La fabrique du sexe : essai sur le corps et le genre en Occident, Gallimard, 2013
-Darian Leader, La jouissance, vraiment?, Stilus, 2020
– Lionel Le Corre, L’homosexualité de Freud, PUF, 2017
– Benjamin Lévy, L`ère de la revendication, Flammarion, 2022.
– Silvia Lippi et Patrice Maniglier, Soeurs, pour une psychanalyse féministe, Seuil, 2023
– Dimitri Lorrain, « Avec Stefan Zweig: penser la Vienne de Freud et le geste de Freud. Une
lecture du « Monde d’hier » », in Ephéméride 11, FEDEPSY, novembre 2020
– Dimitri Lorrain, https://dimitrilorrain.org/2023/04/09/texte-dynamique-de-parole-creatrice-et-creation-du-lien-de-parole-desirant/
– Elissa Marder, « Glossâ and ‘Counter-Will: The Perverse Tongue of Psychoanalysis », in Patricia Gherovici et Manya Steinkoler, Psychoanalysis, Gender and Sexualities: From Feminism to Trans*, Routledge, 2022
– André Michels, « De la pulsion comme subversion du genre », in Laurence Croix et Gérard Pommier (dir.), Pour un regard neuf de la psychanalyse sur le genre et les parentalités, Erès, 2018
– Maggie Nelson, Les Argonautes, Seuil, 2017
– Gérard Pommier, La révolution du féminin, Pauvert, 2016
– Jorge N. Reitter, Heteronormativity and psychoanalysis. Oedipus gay, Routledge, 2022
-Jean-Michel Rabaté, Lacan l’irritant, Stilus, 2023
– Frédérique Riedlin, « Sur un air de famille(s). À partir d’une question de Judith Butler. La parenté est-elle toujours déjà hétérosexuelle ? », in Laurence Croix et Gérard Pommier (dir.), Pour un regard neuf de la psychanalyse sur le genre et les parentalités, Toulouse, Erès, 2018.
-Rainer Maria Rilke, Lettres à un jeune poète.
– Moustapha Safouan, Le Transfert et le Désir de l’analyste, Seuil, 1988
– Sylvie Steinberg (dir.), Une histoire des sexualités, PUF, 2018, avec des textes de Christian Bard, Sandra Boehringer, Gabrielle Houbre, Didier Lett, Sylvie Steinberg
– Guenaël Visentini, Penser et écrire par cas en psychanalyse. L’invention freudienne du style de raisonnement, PUF, 2024
– Stefan Zweig, Le Monde d’hier (1943), Livre de poche, 1996
Programme passé :
5/1/2023 Emmanuelle Chatelat et Dimitri Lorrain : « La situation contemporaine de la psychanalyse »
2/2/2023 Emmanuelle Chatelat et Dimitri Lorrain : « Le ‘féminin’ selon Freud et aujourd’hui »
2/3/2023 Frédérique Riedlin (psychanalyste) : « Le tabou de la virginité selon Freud »
Dimitri Lorrain: « Elaborer psychanalytiquement la mutation culturelle contemporaine de l’individualisation du genre » (15mn).
6/4/2023 Thierry Goguel d’Allondans (anthropologue, Univ. Strasbourg) et Jonathan Nicolas (psychologue) : « Anthropologie clinique des caméléons. A propos de Choisir son genre ? (ouvrage collectif qu’ils ont dirigé) »
4/5/2023 Stéphane Muths (psychanalyste) : « La bisexualité psychique selon Freud et aujourd’hui »
Karina Pacheco (philosophe, Porto Alegre) : « Le virilisme dans le Brésil de Bolsonaro » (15mn)
1/6/2023 Frédérique Riedlin et Dimitri Lorrain : Lecture de Lacan, Séminaire XX., Encore, leçon du 13/3/1973
9/11/2023 Dimitri Lorrain : « La psychanalyse, la subjectivation, le ‘féminin’: élaboration avec Michel Foucault et Simone de Beauvoir »
7/12/2023 Dominique Marinelli (psychanalyste) : « Eléments pour une histoire des femmes psychanalystes (1) : Rosenthal, Hug-Hellmuth, Hilferding, Eckstein. »
11/1/2024 André Michels (psychanalyste): « Les enjeux cliniques et politiques de la question trans »
1/2/2024 Dominique Marinelli (psychanalyste) : « Eléments pour une histoire des femmes psychanalystes (2) : Andreas-Salomé, Spielrein, Deutsch, Bonaparte, Mack Brunswick, Lampl de Groot. »
14/3/2024 Sandra Baumlin (psychanalyste) et Emmanuelle Chatelat : « La servitude volontaire (Lacan, Manon Garcia, La Boétie) »
4/4/2024 Emmanuelle Chatelat : « Eléments d’histoire du genre pour la psychanalyse »
3/10/2024 : Dimitri Lorrain : « Comment parler psychanalytiquement aujourd’hui du « féminin » selon Freud? »
7/11/2024 : Catherine Klein (psychanalyste): « La fin de cure résonne-t-elle avec un amour Autre ? », suivie de Sandra Baumlin (psychanalyste): « Sur ‘Le mythe de la virilité’ d’Olivia Gazalé »
5/12/2024 : Jorge Reitter (psychanalyste, Buenos Aires) : « Amour et deuil dans le placard (sur Les plaines de Federico Falco »
9/1/2025 : Thierry Goguel d’Allondans (anthropologue, Univ. Strasbourg) et Jonathan Nicolas (psychologue clinicien, Univ. Strasbourg): A propos de leur ouvrage Refaire famille. Pour en finir avec les stéréotypes de genre (Chronique sociale, à paraître en 2024)
6/2/2025 : Stéphane Muths (psychanalyste, chargé de cours Univ. Strasbourg): « De la révolution des frères à celle des soeurs? (Freud, G. Pommier, Silvia Lippi et Patrice Maniglier) »
6/3/2025 : Emmanuelle Chatelat : A propos de Lucien Israël, « La castration dans le couple » dans L’amour de la transmission ; et Dimitri Lorrain : « Lien amoureux, sexe et subjectivation »
3/4/2025 : Philippe Breton (psychanalyste, Univ. Strasbourg): « La tentation de la violence entre honte et culpabilité »
Jorge Reitter est psychanalyste à Buenos Aires. Il a publié Edipo Gay. Heronormatividad y psicoanálisis (Letra viva, 2e édition 2024), traduit en anglais sous le titre Heteronormativity and psycoanalysis (Routledge, 2023)[1].
Il est membre de la Escuela Libre de Psicoanalisis.
Voici le très beau texte de son intervention au séminaire Freud à son époque et aujourd’hui, co-animé par Emmanuelle Chatelat, Dominique Marinelli et Dimitri Lorrain[2], le 4 décembre 2024.
La page du séminaire:
**
Bonjour à tous,
Je suis très heureux d’être ici avec vous. Malheureusement, je ne suis pas à Strasbourg. Je tiens à remercier tout particulièrement Dimitri Lorrain, qui, depuis qu’il a lu mon livre sur l’hétéronormativité dans la psychanalyse, a toujours fait preuve d’une grande générosité à mon égard. Je peux dire que nous partageons une amitié à la fois intellectuelle et affective.
Lorsque Dimitri m’a invité à participer à ce séminaire, j’ai choisi de proposer un sujet qui, bien qu’il s’écarte légèrement de l’axe principal du séminaire, me semblait pertinent à partager avec vous. Je vais vous lire un travail que j’ai écrit à partir d’un roman intitulé Les plaines (Los llanos), de l’écrivain argentin Federico Falco.
Depuis que j’ai lu Les plaines, je suis tombé amoureux de ce livre. J’ai alors décidé de lire les autres ouvrages de Falco, ceux qui l’ont précédé. J’ai été très déçu : je n’y ai rien trouvé de ce qui m’avait tant ému dans Les plaines. Si vous me le permettez, je vais avancer ce que j’admets devant vous comme une interprétation sauvage : je crois que Falco fait quelque chose de complètement différent dans ce roman. Il devient un autre écrivain que celui qu’il était (et nous verrons que cette mutation est incluse dans la trame du roman), car ce roman est en même temps sa propre sortie du placard. Le roman ne parle pas, ou plutôt ne parle que de manière tangente, de la sortie du placard. Mais, selon mon interprétation sauvage, ce roman est sa sortie du placard. J’ai l’impression que, dans ses ouvrages précédents, Falco fait semblant d’être hétérosexuel, et cela, à mon avis, enlève beaucoup de vitalité à son écriture.
Ce roman semble assez simple et linéaire, mais c’est trompeur : en réalité, de nombreux fils se croisent et s’entrelacent dans sa trame. Mon objectif est d’articuler ces fils autour de la question du placard (closet en anglais) et de son effet sur les deuils – je parle au pluriel, car, comme vous le verrez, ce n’est pas un seul deuil qui est en jeu dans cette histoire. Bien que ce sujet puisse sembler en dehors du cadre strict du séminaire, je pense qu’il peut apporter un éclairage complémentaire à vos réflexions.
**
Je vais regretter ce livre. Nous avons parcouru ensemble des chemins de terre et de mémoire.
Je l’ai acheté pour son titre et pour la photo de la couverture. Bien que « llanos » évoque des « pleins », c’est la photo d’un vide qui se trouve sur la couverture. (Dans le texte en espagnol, il y a ici un jeu de mots qui se perd dans la traduction entre « llanos », qui veut dire « plaines », et « llenos », qui veut dire « pleins »). Une piscine au milieu de nulle part. J’aurais pu prendre une photo pareille. « Ici, il n’y a nulle part où poser les yeux. N’importe quel eucalyptus, n’importe quel poteau électrique est bienvenu, car il aide à fixer le regard. » La piscine, qui se fond par son horizontalité dans la plaine, n’arrive pas à retenir le regard, qui se perd au-delà. « Le monde est si vaste qu’il semble qu’il n’y ait rien à voir : seulement le ciel, seulement le champ, toujours semblables à eux-mêmes. »
Vers la fin du roman, Falco écrit : « Le temps passe facilement dans les films, dans les romans. Seules les actions importantes sont comptées, celles qui font avancer l’intrigue. Le reste – les doutes, l’ennui, les longs jours où rien ne change, la tristesse stagnante – disparaît sous le coup des ellipses, des coupures nettes, des résumés rapides. » C’est, en négatif, ce que fait le roman, écrire la tristesse stagnante, les longs jours où rien ne change, ou bien où quelque chose change si lentement qu’on ne le perçoit pas. Et, en même temps, c’est l’écriture d’une métamorphose radicale.
C’est un roman jalonné par les mois et les saisons. De janvier à septembre, de l’été au printemps. « En ville, on perd la notion des heures du jour, du passage du temps. À la campagne, c’est impossible. » Ce sont les mots qui ouvrent le récit. À la campagne et dans le deuil, il est impossible d’oublier le temps. Les premières pages m’ont accablé. La solitude, le paysage, la sécheresse, le potager, la chaleur qui ne laisse aucun répit, le silence. Des tâches souvent condamnées à l’échec. Puis j’ai compris que c’était de cela qu’il s’agissait, ressentir l’oppression et l’angoisse du narrateur.
À la page 31 du livre en espagnol, nous apprenons que Fede, le narrateur, s’est séparé de Ciro. Ou, pour le dire avec ses propres mots, que Ciro les a séparés. Sa vie s’est alors désassemblée. Nous comprenons que, bien qu’il soit rarement mentionné, tout tourne autour de Ciro et de son absence. Cependant, ce n’est pas, du moins dans un sens conventionnel, une histoire gay. Il ne s’agit pas d’un coming out, et l’homosexualité n’est pas un thème notable du livre. C’est une histoire presque sans histoire, un récit propulsé par la perplexité, le désarroi et l’abandon du narrateur à partir du moment où Ciro lui a demandé de quitter la maison. C’est l’histoire des ruines d’un amour.
Ciro les sépare, et Fede ne comprend rien, il n’arrive plus à écrire. Il ne sait même plus s’il est écrivain. « Avant, j’étais écrivain. » Il décide de louer une maison dans les environs de Zapiola, un tout petit village de la province de Buenos Aires, et de faire un potager. « Ici, personne n’a jamais entendu même mentionner le nom de Ciro. Pourquoi croyais-je qu’en partant la lumière n’allait pas blesser mes pupilles ? » Seul dans la campagne, ou plutôt assiégé par ses fantômes, Fede habite un monde sonore : la campagne nous atteint par l’oreille. Il y a des bruits, mais presque pas de voix. Les rares paroles échangées sont banales : des commentaires sur le temps, des conseils du voisin pour améliorer le potager, de brefs échanges avec l’épicier. Le téléphone portable ne capte pas dans la maison. Les mots significatifs ne se trouvent que dans la mémoire, ils ne se prononcent pas. On n’écoute pas non plus de musique, seulement le son des oiseaux, des insectes, du vent. Des bruits consubstantiels à la solitude extrême du narrateur, partition du désarroi.
Zapiola est un retour au paysage qu’il avait dû « laisser derrière, abandonner, perdre pour pouvoir être. » La plaine est le paysage de son enfance, des week-ends dans la campagne de ses grands-parents. Comme tant d’enfants différents, Fede, à un moment que l’on imagine à la puberté, sent qu’il ne trouve plus sa place. C’est pourquoi « il lisait » : « parce que lire était ordre, harmonie, la promesse d’un troisième acte où tout s’imbriquerait, où tout aurait un sens. » La promesse d’un monde, lointain, où il trouverait sa place. Un monde qu’il imaginait élégant, parfait. « J’étais convaincu qu’une autre vie m’attendait quelque part. » Il savait qu’il ne pouvait pas gaspiller sa vie à Cabrera. La lecture et les études deviennent plan d’évasion et illusion de maîtrise, incantation magique pour que tout ait un sens, pour enfin trouver un lieu qui ne le rejetterait pas, un lieu où il voudrait revenir. « C’était seulement le besoin de tout garder sous contrôle : le chaos, le non-sens, la peur. » La lecture devient aussi un piège, un appât, une illusion que la trame parfaite pourrait le sauver de la mort et de la peur. Une tentative pour éviter de payer le prix.
« Ou bien je le savais, ou bien je l’ai su un après-midi, soudain un soupçon : et si les garçons me plaisaient ? Et si j’étais l’un de ceux-là ? » « Ne même pas me l’avouer à moi-même ou je me mettrais en danger de mort. » La mort par laquelle il doit passer dans cette seconde plaine pour donner naissance au narrateur de Les plaines. « Une fois, j’ai essayé d’en parler à maman. Non, a-t-elle dit. Son visage s’était assombri. Non, a-t-elle dit, et je n’ai jamais vraiment su ce que signifiait ce refus. Ce n’est pas vrai. Je ne te le permets pas. Je ne le crois pas. Je ne veux pas le savoir. Ne le dis pas. Je ne peux pas. Après, on n’en a plus jamais parlé. Si j’abordais le sujet, c’était comme si cette partie de la conversation n’était pas entendue. Silence. Parler d’autre chose, changer de sujet. » Fede n’a pas insisté. Peut-être sentait-il qu’il n’y aurait pas de réponse, que questionner serait inutile. « Fais ce que tu veux, » a dit le père, « mais ne t’avise même pas de te pointer avec un type au village, ni de raconter ça partout. » Parfois on croit avoir décidé de fuir et on ne voit pas qu’on avait déjà été expulsé. Fede revient à la plaine pour se faire une place, à travers nous, ses lecteurs, là où il avait été rejeté à coups de silence.
« Jusqu’au moment où, de nombreuses années plus tard, j’ai rencontré Ciro, ce sentiment ne m’a jamais quitté. Ne pas être à ma place. Ne pas avoir de lieu. » « Trouver Ciro, c’était trouver quelqu’un avec qui parler, quelqu’un avec qui cesser de faire silence. » Mais les refuges où l’on arrive en fuyant risquent facilement de devenir des prétextes pour éviter la mort et l’insensé. Ciro le lui dit lors de leur conversation au bar : « le refuge est devenu une cage. » « Tu maintenais tellement notre relation que je ne trouvais aucun moyen. » « Je ne peux pas être ta famille, tu en as déjà une. »
Le deuil par Fede de Ciro en entraîne un autre, plus profond, plus radical. « J’étais attiré par ces intrigues si bien ficelées, où le point final se transformait toujours en le soulagement de tous les tourments, la confirmation que toutes les épreuves, tous les conflits avaient valu la peine. » Happy end. Mais un jour, Ciro les a séparés, quelque chose s’est brisé, et maintenant le narrateur ne comprend plus rien et ne peut plus écrire. « Comment écrire parmi les décombres, entre la boue et les flaques, en rassemblant, ici et là, les restes détrempés de ce qui avait été un quotidien, de ce qui avait été une maison ? Comment écrire une histoire parmi les décombres d’une histoire ? » Ne s’agit-il pas de cela, en psychanalyse ?
« Parfois, je sens que je ne vais jamais comprendre ce qui nous est arrivé. Et si je le comprenais, la peine prendrait fin et tout cela serait derrière nous. Parfois, je sens que je comprends, que je comprends parfaitement, mais ça fait quand même mal. » Comme le narrateur de Les plaines, celui qui consulte un analyste cherche un sens qui soulage la douleur. Si tout se passe assez bien, cela arrivera, il ne s’agira pas tant d’un sens, mais de sens au pluriel. Fragmentaires, contradictoires, mais aussi curatifs. L’attente de soulagement par le sens n’est pas totalement déçue. Mais il y a un au-delà, au fur et à mesure que l’on traverse le deuil du happy end : la rencontre avec le non-sens inéliminable. La limite de tout sens. « Et parfois, je pense qu’il y a des choses qu’on ne finit jamais par comprendre, qui restent là, flottant autour de nous, prêtes à frapper à tout moment. Que la peine ne s’éteint pas, elle s’éloigne juste pendant quelques heures, quelques jours, puis elle frappe par surprise, inonde, renverse, qu’il faut apprendre à vivre avec ça. » Je le souscrirais comme l’horizon d’une analyse : apprendre à vivre avec ça. Avec le non-sens, avec l’irrémédiable, l’irréparable. Ce qui ne cadre pas. Comme le dit le narrateur, il y a des choses qu’on ne finira jamais par comprendre, les vrais deuils ne se terminent jamais. « Un dessin plein de gribouillis, de ratures, de faux pas, de projets qui s’effondrent, de personnes aimées qui cessent d’aimer, qui disent c’est fini, pars, pars loin. »
Les plaines relate la mutation d’un écrivain. Apprendre à « ne pas demander à l’écriture ce que l’écriture ne peut donner ». Résister à « la tentation d’un monde ordonné. La sensation de contrôle que procure la narration ». « Avant, je pensais qu’il fallait traiter l’écriture comme l’argile. Maintenant, je me demande si l’on pourrait écrire comme on fait un potager ». « Avec l’argile, l’harmonie s’obtient par l’habileté et en appliquant de la force. La beauté implique de poser des limites, d’utiliser les muscles, une certaine violence, un certain effort. Dans un potager, il y a toujours quelque chose qui naît et quelque chose qui meurt. S’il y a de l’harmonie, c’est par pure contingence, elle ne dure qu’un instant ». Le livre même est la réponse en acte à la question que le narrateur se pose : « Comment raconter sans histoire ? Sans ordonner ? Sans essayer de donner du sens ? »
Écrire le conte parfait était, pour cet écrivain qu’était Fede avant que Ciro ne les sépare, l’illusion de conjurer le rejet. La panique que le lecteur abandonne le livre, qu’il le trouve mauvais. Ce rejet tant redouté, on pourrait dire en termes winnicottiens, est le rejet qui avait déjà eu lieu et qui l’avait poussé à fuir son village, celui-là même qui a façonné un lien qui finirait par étouffer Ciro. « C’est toujours cette seule peur, le rejet. De mon père, de ma famille, de mon village. C’est la douleur indicible : le rejet de Ciro ». Une douleur indicible que, pourtant, tout le livre raconte ; même lorsqu’il semble parler d’autre chose, du ciel, de la plaine.
Dans la plaine, un nouvel écrivain prend naissance, qui écrit comme on fait un potager, en composant avec la contingence, au risque que quelque lecteur abandonne le livre, un écrivain qui trouve une façon de raconter sans histoire, sans chercher à donner du sens. Alors, le sens explose dans une profondeur nouvelle, car il devient capable d’accueillir la part de non-sens qui nous absout de toute obéissance. « Aucun mot ne dompte la peine. Aucun mot ne l’effraie. Aucun mot ne parvient vraiment à la dire ». Certes, aucun mot ne la dit vraiment, mais beaucoup parviennent, peut-être, à la dire à moitié, et d’autant plus qu’on renonce à expliquer et à comprendre. C’est l’apprentissage de Fede, c’est aussi celui de tout analysant qui aura porté assez loin l’expérience analytique. Accueillir le non-sens sans mélancolie. La mélancolie est la plus féroce nostalgie d’un sens plein. Le non-sens auquel s’ouvre Fede, et auquel mène une analyse, est une ouverture à toute créativité, à toute invention. « Simplement raconter sans chercher à comprendre en chemin ».
Dans le récit de Fede, Ciro est dur, parfois cruel. « Pars maintenant », lui dit-il, « je ne veux plus de ça. Ne reste pas à attendre. Je ne veux pas revenir avec toi. Je ne crois pas que je voudrai plus tard ». Ciro, qui ne répond pas aux messages désespérés de Fede. Dans la conversation au bar, il lui dit que lorsqu’il l’a vu au bord du gouffre, il l’y a poussé. Chacun tue ce qu’il aime. Fede a la générosité de nous laisser comprendre (même si cela lui est tellement difficile) que Ciro a raison. Il lui laisse le dernier mot. Si Ciro est brutal, c’est parce que Fede, en niant désespérément le non-sens et la mort, ne lui a laissé aucune alternative. Dans son apparente cruauté, Ciro est l’accoucheur qui, en le jetant dans l’abîme, provoque le cri d’où naîtra une voix nouvelle, radicalement humaine dans son dénuement.
[1] Le roman a été traduit chez Gallimard en 2023.
[1] Pour une recension, voir : https://dimitrilorrain.org/2023/01/13/sortie-de-heteronormativity-and-psychoanalysis-de-jorge-n-reitter-routledge-2023/
[2] https://dimitrilorrain.org/seminaire-freud-a-son-epoque-et-aujourdhui/
La projection du biopic Lou Andreas-Salomé (2016) le vendredi 5 septembre à 20h au Cinéma Star ouvre le cycle « (Re)découvrir Lou Andreas-Salomé », que l’association strasbourgeoise À livre ouvert / Wie ein offenes Buch consacre tout au long de la saison 2025/26 à cette intellectuelle germanophone d’origine russe.
Figure hors normes, philosophe, écrivaine, psychanalyste et libre penseuse, Lou Andreas-Salomé a marqué son époque par sa lucidité et son indépendance, tout en restant trop souvent réduite à ses liens avec Nietzsche, Rilke ou Freud.
Le cycle d’événements, conçu avec la philosophe et traductrice Ondine Arnould dans la continuité du travail autour de la pensée et de l’œuvre de Monique Wittig (1), entend redonner toute sa place à cette voix singulière et inviter le public à (re)découvrir une œuvre encore trop méconnue, à la croisée de la réflexion, de la création et du dialogue.
Au fil de la saison, différents formats – projections, conférences, rencontres littéraires et lectures musicales – proposeront de revisiter les grands champs traversés par Lou Andreas-Salomé : littérature et traduction, psychanalyse et philosophie, questionnements sur le féminin et la création. Ces rendez-vous en partenariat avec 100% Mensch et l’Institut culturel français de Stuttgart, Theaterwelt Kehl et le Historischer Verein de Kehl, ainsi que la BNU, l’Orée 85 et Relatio (Bibliothèques idéales) mettront en dialogue chercheurs, traductrices (Ondine Arnould, Britta Benert, Arthur Hanoun, Esa Hartmann, Laurie Laufer, Lucile Vuillemin), et artistes (Manon Jürgens, Anne-Catherine Kaiser, Aline Martin et Jennifer Rottstegge) et sortiront Salomé de l’oubli et de l’université pour donner à entendre sa voix, des deux côtés du Rhin.
L’organisateur et contact presse :
A livre ouvert/ Wie ein offenes Buch (https://a-livre-ouvert.org)
Aline Martin, présidente / contact@a-livre-ouvert.org
A livre ouvert/ Wie ein offenes Buch a pour objet de promouvoir et de développer, dans un esprit d’ouverture et de dialogue, rencontres et partenariats culturels et artistiques des deux côtés du Rhin. Nous réinterrogeons la littérature depuis le Moyen-âge (parce qu’on n’en finit pas d’interroger le langage). Et réinterroger la littérature et le langage, c’est réinterroger l’histoire, la culture pour ne pas être réduit à ce qu’on est, trotzdem.
Ondine Arnould est doctoresse (selon le mot qu’elle a choisi) en philosophie et études germaniques à l’Université de Strasbourg avec sa thèse « Typologie comparée des féminités chez Friedrich Nietzsche et Lou Andreas-Salomé. » Philosophe germaniste et traductrice, elle veut ouvrir les portes de l’œuvre au grand public.
Programme détaillé :
– Vendredi, 5.9.2025, 20h, Lou Andreas-Salomé en images : la liberté envers et contre tout Projection du Biopic, suivi d’un débat collectif
Lieu : Cinéma Star (27 rue du jeu des enfants, F-67000 Strasbourg)
Billetterie ouverte le 24 août via le Cinéma Star
Lou Andreas-Salomé a vécu un destin extraordinaire, en plein chamboulement historique au tournant du 20e siècle en Europe : elle a toujours refusé la soumission, tant aux dogmes religieux qu’aux hommes, sans pour autant revendiquer une révolution politique. Bercée par un fort cosmopolitisme, elle a voyagé au service d’une quête intérieure de l’origine, en particulier en Russie avec Rainer Maria Rilke, son amant puis son ami. Entre fantasmes et élaborations psychologiques, Salomé ouvre des chemins qu’elle n’impose à personne. Cette découverte du « je » qui est le sien, celui d’une femme au tournant de la modernité, a beaucoup à nous apprendre encore aujourd’hui.
Échange avec le public en présence de :
Ondine Arnould, Esa Hartmann, Lucile Vuillemin, Aline Martin, Jennifer Rottstegge
– Samedi, 11.10.2025, 15h, Traduire Lou Andreas-Salomé : un cosmopolitisme personnel
Table ronde avec lecture d’extraits dans le cadre de “D’une langue vers l’autre”
Lieu : Lieu de l’Europe (8 rue Boecklin, F-67000 Strasbourg)
(Re)découvrir Salomé, mais en quelle langue ? L’intellectuelle écrivait majoritairement en allemand, quoique de manière particulière : son écriture fleuve semble marquée par son cosmopolitisme, à travers une langue allemande somme toute syncrétique, c’est-à-dire qui entremêle plusieurs influences culturelles. Par exemple, comme Novalis, Salomé entremêle le sacré au jargon positiviste. De plus, son écriture imagée s’élabore au moyen de néologismes et de structures grammaticales complexes. Comment rendre cette complexité en français ? Sans compter la difficulté du sujet auquel se confronte centralement la penseuse : revaloriser, et donc tenter de définir, le féminin en tant que fondement nécessaire à l’humanité. Nous trouvons ici une difficulté majeure dans les traductions – souvent difficiles d’accès lorsqu’il s’agit des œuvres romanesques et théoriques de l’autrice –, à savoir, par exemple, que « Mensch » se trouve communément traduit par « homme » en français, générant nombre de confusions. Comprendre Salomé requiert pour le lectorat français d’interroger la traduction de sa langue singulière.
Intervenantes Table ronde : Ondine Arnould, philosophe et germaniste ; Lucile Vuillemin, traductrice ; Britta Benert, professeure en études germaniques, Maître de conférences HDR à l’Université de Strasbourg. Littérature comparée XIXe- XXIe siècles, études germaniques interculturelles.
Lectrices : Aline Martin et Jennifer Rottstegge
– Samedi 21 mars 2026 : Lou Andreas-Salomé, Friedrich Nietzsche et Rainer Maria Rilke : la création en question
Table ronde avec lectures d’extraits (1h), suivie d’une lecture scénique et musicale
Lieu : Kulturhaus Kehl (Am Läger 12, D-77694 Kehl
Entrée libre
Un des fers de lance de Lou Andreas-Salomé, tant dans sa vie que dans ses écrits théoriques, n’est autre que la création au croisement du corps, du sacré et de l’art. Le féminin y joue un rôle majeur, non sans ambivalence. L’art et l’esthétique sont pourtant les pans les moins traduits et étudiés de Salomé, malgré une production prolifique. Par cet événement, il s’agit de donner voix à l’intellectuelle, tout en la resituant en sein des relations fécondes qu’elle a pu entretenir à ce propos de manière initiatique avec le philosophe Friedrich Nietzsche, ainsi que durant sa maturité avec le poète Rainer Maria Rilke. En complément de cet approche théorique, il s’agira de créer à notre tour, afin de faire (re)découvrir Salomé dans ses introspections de manière pratique.
Intervenant.e.s Table ronde :
Esa Hartmann : Maître de conférences d’études germaniques et chercheuse associée à l’Université de Strasbourg.
Arthur Hanoun : doctorant en philosophie et psychanalyse à la Sorbonne
Ondine Arnould : Professeure certifiée de philosophie, et docteure membre associée en philosophie et études germaniques de l’université de Strasbourg
Lecture : Aline Martin et Jennifer Rottstegge
Musique : Anne-Catherine Kaiser, piano et Manon Jürgens, chant
– Samedi, 11 avril 2026, 16h : Lou Andreas-Salomé et la psychanalyse : une amitié introspective
Médiathèque du Neudorf (place du Marché du Neudorf, F-67100 Strasbourg)
Table ronde avec lectures d’extraits (1h), suivie d’une lecture scénique et musicale
Durant sa maturité et jusqu’à la fin de sa vie, Salomé a été marquée par la découverte de la psychanalyse, notamment lors de sa rencontre avec Sigmund Freud avec lequel elle entretint une relation très particulière de disciple hérétique à la loyauté sans faille. Pourtant le « narcissisme comme double-direction » élaboré par Salomé n’est que peu étudié : on retient le plus souvent la « Lettre ouverte à Freud » comme hommage au Père de la psychanalyse. Un pendant psychanalytique moins connu chez Salomé réside également dans l’amitié que celle-ci a entretenu avec Anna Freud, qui fut marquée par une correspondance très nourrie et une certaine projection de soi en l’autre. S’il ne s’agit pas nécessairement de théorie psychanalytique, la correspondance donne à saisir un geste thérapeutique pratique et plus largement une amitié féminine riche que les lectures, lors de la table ronde ainsi que du spectacle, sauront faire entendre.
Intervenant.e.s Table ronde :
Laurie Laufer : psychanalyste et professeure au département d’Études psychanalytiques de l’UFR Institut des Humanités Sciences et Sociétés (IHSS) à l’Université Paris Cité. Elle est directrice de l’UFR Institut des Humanités Sciences et Sociétés.
Arthur Hanoun : doctorant en philosophie et psychanalyse à la Sorbonne
Ondine Arnould : Professeure certifiée de philosophie, et docteure membre associée en philosophie et études germaniques de l’université de Strasbourg
Lecture : Aline Martin et Jennifer Rottstegge
Musique : Anne-Catherine Kaiser, piano et Manon Jürgens, chant
NOTE:
(1): voit par exemple: https://a-livre-ouvert.org/evenement/la-pensee-wittig-rencontre-quai-des-brumes/
Chères amies, chers amis,
Mon amie Frédérique Riedlin (psychanalyste, Strasbourg) qui participe à la Convention, m’invite à relayer l’information, donc la voici.
Chères amies, chers amis,
J’aimerais ici dire quelques mots du très beau livre de Jean-Michel Rabaté, Lacan l’irritant (Stilus, 2023).
Dans cet ouvrage, il propose une mise en perspective de Lacan en insistant sur la dimension fécondement irritée et irritante de sa parole et de sa pensée – et plus encore du texte (ce que l’on pourrait appeler le « texte-Lacan ») que nous lisons lorsque nous fréquentons ses écrits et séminaires.
En effet, aux Etats-Unis, où Jean-Michel Rabaté vit et enseigne (Université de Pennsylvanie), existe à nouveau un grand intérêt pour Lacan comme pour la psychanalyse – tout comme il existe une psychanalyse, particulièrement freudo-lacanienne, fort créative. Ce regain d’intérêt est permis par l’essor de ce que l’on y appelle les studies (dont particulièrement les gender studies). Et l’éclairage de Jean-Michel Rabaté sur Lacan nous donne une piste novatrice pour donner à entendre d’une nouvelle manière l’enseignement de Lacan, mais aussi la psychanalyse, dans le nouveau contexte culturel qui existe aux Etats-Unis, mais aussi plus généralement.
En somme, contre tout anti-américanisme et contre tout conservatisme, il s’agit pour Jean-Michel Rabaté, comme il le dit dans la vidéo que je relaie plus loin, de rendre à Lacan et à la psychanalyse leur pouvoir irritant, sans aller jusqu’à l’offense. Pour aider le sujet contemporain, s’interrogeant souvent en termes d’identité (d’ailleurs socialement minoritaire : de genre ou autre), à justement ouvrir cette interrogation. Ce dans le nouveau contexte culturel, où, je dirais, le discours collectif, par ce questionnement en termes d’identité, rend maintenant – et fécondement – le sujet beaucoup plus sensible aux questions du pouvoir et de la violence désubjectivante, sous toutes leurs formes (1).
Dans sa réflexion sur l’identité, Jean-Michel Rabaté rejoint d’ailleurs la psychanalyse contemporaine qui accueille pleinement – et ne rejette donc pas – cette interrogation actuelle des sujets en termes d’identité, afin d’ouvrir à la levée du désir subjectif s’y trouvant bien souvent (2).
Dans mes termes, je dirais que, dans la lecture de Jean-Michel Rabaté, Lacan apparaît non pas comme une autorité discursive, mais comme le passeur irrité et irritant d’une conflictualité discursive et psychique. Cela vient ouvrir ce que les discours collectifs contemporains, seraient-ils aussi fécondement progressistes, ont tendance à refermer. Et, dans la cure pratiquée en s’appuyant sur Lacan, cela permet de rendre la parole du sujet à nouveau singulière, créative, et donc critique. Bref, l’affect d’irritation qui habite et que suscitent la parole et la pensée de Lacan – et plus encore le « texte-Lacan » – est bien le vecteur de l’ouverture d’une telle conflictualité, d’une telle créativité, d’une telle mise en crise. Ce, au niveau collectif, contre toute recherche de giron dans un discours collectif normatif. Mais aussi, ce qui va de pair, au niveau subjectif, contre toute refermeture de la parole du sujet sur la léthargie d’un confort qui obture la possibilité d’avancées subjectivantes à venir.
Ainsi, en nous donnant à lire Lacan comme un « trouble-fête » et un « taon dans la cité » (tel Socrate selon Platon), ce livre redonne à celui-ci sa dimension critique et subversivement créative.
Ce qui est ici critiqué et déconstruit par Lacan, tel que l’éclaire Jean-Michel Rabaté, c’est aussi la conception mainstream du sujet et de l’auteur. Cela lui permet de situer le « retour » de Lacan à Freud comme une « transformation » de la « discursivité psychanalytique fondée par Freud » – telle que l’a éclairé Foucault (p. 13).
Alors la psychanalyse apparait comme « à la fois un discours pris dans les sciences humaines, un discours portant sur la sexualité, le désir, le sujet clivé de l’inconscient, la topique du moi, les pulsions, et une archive, un système autopoïétique qui se révise sans cesse, un texte foisonnant et plein de lacunes qu’il s’agit de relire avec attention » (p. 20).
Plus encore, c’est bien, avec Freud et Lacan, l’existence de la « pulsion de mort » ou plus largement la destructivité pulsionnelle, qui est affirmée. Ce contre tout idéalisme visant à prendre le sujet dans un optimisme béat, dans un culte de la positivité (pensons par exemple à la psychologie positive) mystificateur. En somme, il existe inéluctablement chez l’être humain une « cruauté », une destructivité. Et cette « cruauté », cette destructivité, dans la parole ou dans l’écriture, doit pouvoir – comme nous l’enseignent Lacan et Winnicott – se déployer, et non pas être réprimée, pour se déployer de manière créatrice. Pour Lacan, « dans le travail d’écriture » (p. 75).
En ce sens, la lecture de Jean-Michel Rabaté passe aussi par l’éclairage du fait que la psychanalyse de Freud et de Lacan est à relier aux Lumières obscures (p. 106) au sens d’Adorno et de Horkheimer (3).
L’un des points les plus vifs et les plus ouvrants du livre est l’insistance – en écho à Derrida, et au débat entre Lacan et Derrida – sur le fait que le dernier Lacan est un Lacan élaborant la question de l’écriture. Ce point est certes bien connu des spécialistes et, mais le livre nous en offre un éclairage novateur.
Car la « mémoire » psychanalytique et culturelle que l’écriture, au sens de Lacan, déploie, consiste en une « mémoire qui se fabrique elle-même en gérant sa part d’oubli » (p 109). Bref, comme dit auparavant, l’écriture du texte-Lacan est une archive créative, elle est même le système autopoïétique d’un « écrivain pluralisé » (p. 115), « disséminant » (4) la « subversion du sujet » (p. 116). En ce point, d’ailleurs, Lacan met au travail Joyce qu’il a longuement médité, Joyce qui « détiss(e) » le tissage du texte (p. 142), le tissage de la mémoire culturelle dans laquelle nous sommes tous pris. Ce – en va-t-il là d’une éthique ? – afin que le sujet ainsi redéfini accède au geste de « s’autoriser de soi-même et d’un Autre » (p. 148), ce sans se prendre pour une autorité.
A mon sens, cela ouvre à une conception du psychanalyste – et de l’écrivain – comme tisseur, comme passeur critique et créatif, irritant et en cela porteur de nouveauté. A l’opposé de toute autorité (5) .
Plus encore, cela soutient le fait que le sujet, dans la cure analytique, déploie une telle mémoire, une telle écriture créative, mais aussi une telle élaboration ouvrante – et même sinthomale (je parlerai plus loin du concept de sinthome) – de ce que Lacan appelle le non-rapport sexuel, c’est-à-dire l’absence de complémentarité entre deux sujets liés sexuellement.
Pour tout cela, Jean-Michel Rabaté lit Lacan avec Freud, avec la littérature (Sade…), la philosophie (Kant et Nietzsche – lui aussi un philosophe de l’irritation), les sciences humaines (particulièrement Luhmann).
Et, ayant donc parlé du sinthome, je ne puis finir ce texte sans pointer le fait que ce livre approfondit le travail déployé dans Joyce, hérétique et prodigue (Stilus, 2022).
Cet ouvrage articulant Joyce, Lacan et Derrida, pour le dire trop rapidement, éclaire le dernier Lacan comme un joycien hérétique. Il éclaire aussi que je propose d’appeler le texte-Lacan comme le déploiement d’une écriture du sinthome. Rappelons ici ce qu’est le sinthome – création conceptuelle géniale de Lacan, qui permet une avancée clinique fondamentale dans la cure. Le sinthome, je dirais, est cette création symptômale spécifique travaillant à même la lettre (et liée au hors-sens et à l’équivoque, la surdétermination maximale).
Ici, c’est bien de la créativité de ce symptôme spécifique qu’est le sinthome, dont il est question. Ce contre toute logique d’adaptation sociale (il existe bien sûr une forme d’inscription sociale qui n’est pas adaptative), entravant chez le sujet la fragilité, le ratage, et ainsi toute subjectivité, toute singularité, toute vitalité psychique et discursive.
Plus encore, cette forme spécifique du symptôme qu’est le sinthome a pour grand mérite de faire tenir le sujet là où la béance (ce point de réel, de pulsionnalité pure, de jouissance (6), où le psychisme et la parole défaillent absolument, laissant le sujet dans un désarroi radical) pourrait l’orienter vers une destructivité ou une autodestruction débridée.
Dans cette opération psychique spécifique du sinthome, relevant donc d’une écriture psychique, la langue est détruite et recréée pour échapper à la logique de destructivité – surmoïque – qui l’habite.
Bref, face à la question cruciale de la béance, habitant tout sujet, et face au discours surmoïque (7) qui hante le sujet et l’empêche d’élaborer la béance, l’un des apports cliniques absolument novateurs de Lacan, consiste dans le fait de soutenir la création psychique d’un sinthome (8). Et cet apport clinique fondamental de Lacan s’est appuyé sur une invention théorique dans la lecture de Joyce, en premier lieu dans le séminaire XXIII, de 1975-1976, sur le sinthome.
Et c’est cela que Jean-Michel-Rabaté éclaire à sa manière, au plus vif et au plus crucial de la clinique psychanalytique, mais aussi au plus vif et au plus crucial de la créativité subjective en général : lorsqu’il en va pour le sujet de devenir psychiquement et discursivement vivant là où il pourrait psychiquement et discursivement mourir – ou là où il est psychiquement et discursivement non-vivant.
En cela, son livre nous permet d’appréhender en quoi la psychanalyse est bien un « nouveau discours » culturellement révolutionnaire (p. 11), qui a tant à apporter subjectivement, collectivement, et, justement, culturellement.
NOTES
(1) : Didier Fassin et Roland Rechtmann, L’empire du traumatisme, Flammarion, 2007.
(2) Voir entre autres Patricia Gherovici, Transgenre, Lacan et la différence des sexes, Stilus, 2021 ; Nicolas Evzonas, Devenir trans de l’analyste, PUF, 2024, particulièrement p. 410-411 ; Jonathan Nicolas, « A l’ombre des jeunes filles en fleurs, une esquisse des identités adolescentes », in Jonathan Nicolas et Thierry Goguel d’Allondans (dir.), Choisir son genre ?, Chronique sociale, 2022, p. 169-180.
[3] Dans leur Dialectique de la raison. Sur cette question, voir E. Roudinesco, Sigmund Freud en son temps et dans le nôtre, Seuil, 2014.
[4] En écho à Derrida.
[5] La relation entre passeur et autorité est une question qui m’intéresse particulièrement et que j’ai élaborée à ma manière dans mon texte https://dimitrilorrain.org/2023/06/09/texte-que-peut-nous-dire-la-psychanalyse-de-lautorite-et-de-la-transmission-aujourdhui/
[6] Sur la question de la jouissance, je renvoie particulièrement à Darian Leader, La jouissance, vraiment ?, Stilus, 2020.
[7] Sur la dimension surmoïque du sinthome, voir particulièrement, Geneviève Morel, La Loi de la mère, Anthropos/Economica, 2008.
[8] Concernant le sinthome comme création symptômale, je renvoie à Geneviève Morel, et, dans le cas du sujet identifié trans, à Patricia Gherovici, Transgenre. Lacan et la différence des sexes, Stilus, 2021 : https://dimitrilorrain.org/2023/01/14/video-patricia-gherovici-transgenre-lacan-et-la-difference-des-sexes-stilus-2021/ https://dimitrilorrain.org/2023/01/14/video-patricia-gherovici-transgenre-lacan-et-la-difference-des-sexes-stilus-2021/
**
Présentation du livre par l’éditeur :
« Le concept d’irritation amène à travailler la problématique de l’autorité avec Foucault, Luhmann et Lacan. Lacan, comme Socrate, « taon de la cité », rejoint Freud lorsqu’il manifeste son irritation face à Nordau et Viereck. Freud en vient à postuler la pulsion de mort comme fondamentale, tandis que Lacan, irrité-irritant, moins « auteur » que tisseur, passe de la logique du signifiant au temps (« taon ») biologique des pulsions. »
https://www.editions-stilus.com/lacan-lirritant.html
**
De plus, j’aimerais ici relayer une passionnante vidéo avec Jean-Michel Rabaté présentant cet ouvrage. Il y dialogue avec Elisabeth Roudinesco à la librairie le Divan le 8 mars 2023. Luis Izcovich modère et présente cette rencontre. Dans ce débat fort élaboratif, se déploie, la parole si subtile, si fraîche, de Jean-Michel Rabaté, présentant sa lecture de Lacan et son travail pour un lacanisme ouvert, ainsi que son élaboration de la littérature, de la philosophie, des sciences humaines. Entre autres, l’on pourra aussi y trouver une réflexion sur la transmission de la psychanalyse dans la situation contemporaine, sur l’évolution culturelle aux Etats-Unis mais aussi plus généralement, où il vit (il enseigne à l’Université de Pennsylvanie), particulièrement en ce qui concerne les questions du genre et du racisme. Aussi nous donne-t-il à appréhender les spécificités – fécondes et conflictuelles – de cette évolution culturelle, en contraste avec la perspective dominante en France. Particulièrement en insistant sur les apports de la perspective intersectionnelle – qu’il considère comme déployant une féconde surdétermination de l’identité. En professeur à l’écoute de ses étudiants, il nous y donne aussi à entendre ce qui a lieu dans les jeunes générations, en termes de créativité mais aussi de fragilité psychique – celle-ci étant, je dirais, liée à un contexte global particulièrement difficile.
LE LIEN VERS LA VIDEO :SUR YOUTUBE (STILUS)
https://www.youtube.com/watch?v=cHaMXH9VKSU
**
Jean-Michel Rabaté est professeur de littérature anglaise et de littérature comparée à l’Université de Pennsylvanie. Cofondateur de la galerie Slought à Philadelphie, éditeur du Journal of Modern Literature. En plus d’innombrables articles, il a publié une quarantaine de livres, sur la littérature, la psychanalyse, l’art contemporain, la philosophie, et particulièrement sur Beckett, Pound ou Joyce, Lacan, Derrida….
Il a dirigé le passionnant Cambridge Companion to Lacan, en 2003, avec des contributions de Bernard Burgoyne, Nestor Braunstein, Tim Dean, Judit Feher-Gurewich, Darian Leader, Deborah Luepnitz, Catherine Liu, Dany Nobus, Jean-Michel Rabaté, Dania Rabinovitch, Elisabeth Roudinesco, Charles Shepherdson, Colette Soler, Joseph Valente, Alenka Zupanzic.
Entre autres, il a publié Les Guerres de Jacques Derrida, Presses de l’Université de Montréal, 2016 ; Rire au soleil, Campagne Première, 2019 ; Rires Prodigues: Rire et jouissance chez Marx, Freud et Kafka, Paris, Stilus, 2021, et James Joyce, Hérétique et Prodigue, Paris, Stilus, 2022.
Parmi ses autres livres, que je ne peux tous citer ici, j’évoquerai :
Lacan, Bayard, 2005. Et plus récemment: Rust, 2018, Kafka L.O.L., 2018; After Derrida, 2018; Understanding Derrida / Understanding Modernism, 2019; Knots: Post-Lacanian Readings of literature and film, 2020; Rires Prodigues, 2021, Knots, Post-Lacanian readings of film, literature and culture, New York, Routledge, 2020.
Son site :
https://www.jeanmichelrabate.com
**
Elisabeth Roudinesco est historienne de la psychanalyse, entre autres chargée de séminaire à l’Ecole Normale Supérieure.
Sur le blog, voir par exemple : https://dimitrilorrain.org/2021/10/30/penser-lantifreudisme-dextreme-droite-avec-elisabeth-roudinesco-2010/
Chères amies, chers amis,
J’aimerais vous informer de la sortie du passionnant dossier sur la question « Les dispositifs de l’objet, aujourd’hui », sous la direction de Patrick Martin-Mattera (psychologue et psychanalyste, UCO Angers) (1) et Olivier Douville (psychanalyste, psychanalyste, Maître de conférences des Universités et directeur de publication de la revue Psychologie Clinique) (2), dans la revue Psychologie clinique (nouvelle série, n°55, 2023/1, EDP Sciences).
Quatrième de couverture: « Ce numéro de Psychologie clinique interroge les dispositifs de l’objet aujourd’hui : objet reste, déchet et rebut, fétiche ou relique, objet d’amour ou objet de haine ; quels sont les aspects actuels du rapport à l’objet qui caractérisent notre condition humaine au regard des enjeux psychologiques, sociaux, anthropologiques, spirituels ? Se dessineront ainsi des articulations possibles entre objet du fantasme, objet de la demande de l’Autre et objet de la pulsion.
Les textes de ce numéro se déploient autour d’une modernité qui se présente ici surtout comme le prolongement d’un éternel malaise dans la civilisation, saisi par le questionnement sur le statut actuel de l’objet, dépendant des dispositifs qui lui donnent forme et fonction. »
Plusieurs textes dans le dossier étudient la question de l’objet lathouse, à la suite de ce qu’en a dit Lacan, concernant les oeuvres d’art dans le monde numérique, le management contemporain, la toxicomanie, le racisme et le capitalisme dans le Brésil contemporain.
J’aimerais rappeler que l’objet lathouse a été défini par Lacan (3), et que c’est une question élaborée par Patrick Martin-Mattera et Alexandre Lévy (4) (5). Comme l’écrivent Patrick Martin-Mattera et Olivier Pitel dans leur article « Dispositif de monstration et rapport à l’objet: des lathouses au virtuel dans l’oeuvre d’art » dans ce numéro de Psychologie clinique: « avec la notion de lathouse, Lacan reconsidère la conception de l’objet dans le contexte de la fin du XXe siècle, où les discours du capitalisme et de la science mènent au stade ultime d’un impératif de jouissance immédiate qui jamais ne trouve à s’épuiser. Les lathouses sont des objets portés à un impératif de consommation immédiate, un pousse-à-consommer qui est aussi un pousse-à-jouir accessible au meilleur prix » (6).
Dans ce dossier, concernant les dispositifs de l’objet, il est aussi question de la relique et du fétiche, de la névrose actuelle, de l’adolescence, et de la désubjectivation dans les situations extrêmes.
Pour la présentation de ce numéro par Patrick Martin-Mattera et Olivier Douville, voir https://www.cairn.info/revue-psychologie-clinique-2023-1-page-5.html
Pour l’accès en ligne au numéro: https://www.cairn.info/revue-psychologie-clinique-2023-1.htm
NOTES:
(1) Patrick Martin-Mattera est psychologue, psychanalyste, Professeur à l’Université Catholique d’Angers, membre du laboratoire RPPsy. De lui, je citerai ici son très important livre Théorie et clinique de la création. Perspective psychanalytique, Anthropos-Economica, 2005. Pour plus de détails sur ses publications: https://recherche.uco.fr/user/151/publications-chercheur-annee.
(2) Olivier Douville est psychanalyste, Maître de conférences des Universités et directeur de publication de la revue Psychologie Clinique. De lui, je citerai ici son fort fécond ouvrage, entre psychanalyse et anthropologie, Les figures de l’autre. Pour une anthropologie clinique, Dunod, 2014. Pour plus de détails sur ses travaux, voir https://www.olivierdouvile.com/
(3) J. Lacan, Le séminaire XVII (1969-1970), L’Envers de la psychanalyse, Paris, Seuil, 1991.
(4) Patrick Martin-Mattera et Alexandre Lévy, « Le »concept » de lathouse dans l’oeuvre de Jacques Lacan. Implications psychologiques, cliniques et sociales », Bulletin de psychologie, n°550, p.311-319. Article accessible en ligne: https://www.cairn.info/revue-bulletin-de-psychologie-2017-4-page-311.htm?ref=doi
(5) Alexandre Lévy est psychologue, psychanalyste, Maître de conférence à l’Université Catholique d’Angers, membre du laboratoire RPPsy. De lui, je citerai ici l’ouvrage collectif qu’il a codirigé (avec David Bernard), Pas de limites? Approche psychanalytique de la vie moderne, Presses Universitaires de Rennes, 2021. Pour plus de détails sur ses publications: https://recherche.uco.fr/user/146/publications-chercheur-annee
(6) p. 43.
Vous trouverez ici le texte lié à mon intervention du même nom à la très belle journée d’études « Pratiques et contre-pratiques de l’autorité » du 30 mai 2023, à la MISHA de Strasbourg. Cette journée a été organisée par l’Amicale étudiante de philosophie, avec le soutien du CRePhac et de la Faculté de Philosophie de l’Université de Strasbourg[1].
**
J’aimerais dans cette intervention élaborer sur ce que la psychanalyse peut selon moi dire de l’autorité et de la transmission aujourd’hui.
Avant d’en venir à cette question, j’aimerais faire quelques rappels nécessaires sur la psychanalyse. La psychanalyse, envisagée de manière freudo-lacanienne[2], déploie une technique d’écoute et de parole spécifique, liée à la règle psychanalytique. Je rappelle que dans cette règle, le sujet associe librement, il dit ce qui vient. Freud parle pour cela d’ « Einfall ». Ainsi, en psychanalyse, tout énoncé linéaire, logique, narratif, est désorganisé. Ce au profit de l’insistance sur le geste d’énonciation, sur le dire dans son caractère surgissant, d’événement, créateur. C’est cela le symbolique tel que l’a éclairé Lacan, quelque chose de créateur, pas autre chose – et certainement pas un ordre social normatif. Bref, en psychanalyse, ce n’est pas la thématique de la parole qui compte, mais la forme, la structure, la dynamique créatrice de la parole, du discours.
Pour faire un parallèle, les pensées philosophiques de Nietzsche, d’Adorno ou de Levinas – aussi dans leurs formes fragmentaires pour les deux premiers – rejoignent cette exigence de se centrer sur le geste d’énonciation créateur. Je souhaiterais aussi évoquer la superbe réflexion d’Adorno sur la poésie d’Hölderlin comme paratactique, scandée par des vides[3]. En effet, chez Hölderlin, plus largement dans la poésie moderne, il y a quelque chose de cela dans la parole analytique. Je parlerai plus loin de la réflexion d’Adorno sur Hölderlin.
Du coup, dans la cure, se déploie une parole constamment bifurquante qui fait se lever une dynamique discursive créatrice. En ce sens, la psychanalyse vise à produire des bougés discursifs chez le sujet, ainsi qu’un changement de sa parole dans le sens de la créativité de parole. Il en va là pour le sujet de la capacité de de produire de nouveaux mots, de nouveaux signifiants, ou de nouvelles significations de mots qui sont anciens pour lui. De nouvelles perspectives aussi. Fondamentalement, c’est sur ces sauts de parole créatifs que la psychanalyse travaille. Pour que le sujet se centre en fait sur la forme – la structure – de sa parole, plus que sur la signification des énoncés. Afin de porter attention – point fondamental – à l’ambiguïté, l’équivocité, la « surdétermination » (Freud) du dit, comme du dire. Et à déployer cette poéticité de la parole – dont le rêve est l’expression comme l’a montré Freud[4]. Afin de rendre sa parole plus créative.
Je ne sais si vous avez déjà essayé de pratiquer l’analyse de rêve, sur une feuille libre, même en dehors de la cure. Il s’agit d’associer librement, à partir de chaque élément énoncé précédemment. Alors la parole se déploie en étoile, elle échappe à toute linéarité, elle déploie des énoncés latents, inconscients, qui habitent le psychisme du sujet, derrière le contenu manifeste, conscient. Et, déployée dans la cure, cette forme spécifique de parole ouvre à une autre forme de discours, qui va permettre pour le sujet la découverte de la forme, de la structure, de sa parole. Ici, l’on retrouve l’omniprésence de la sexualité bien sûr, mais ce n’est pas là-dessus que j’insisterai aujourd’hui.
Joue dans la cure l’écoute de l’analyste. Celle-ci permet que se fasse jour et soit reconnu, dans la parole du sujet, son désir inconscient, présent dans les mots clés – dans les signifiants – de sa parole, qui sont chargés de ce désir. C’est bien ce désir, lié à l’ambiguïté, l’équivocité, la surdétermination, la poéticité spécifique de la part latente, inconsciente, de la parole du sujet, que la cure cherche à faire lever. Pratiquement, cela permet que ce désir enrichissant la parole et la vie se déploie dans les actes et paroles du sujet, de manière énigmatique, mais créatrice. Car cela ouvre le sujet à une créativité qu’il n’avait souvent pas encore, ou pas autant. La psychanalyse rend le sujet énigmatiquement créatif, en parole, en acte, existentiellement. Elle rend la dynamique de parole du sujet, et son existence, plus créatrices en ce sens.
Mais c’est aussi la dimension d’énigme du désir du sujet, habitant et structurant sa parole de manière latente, que la psychanalyse amène à appréhender et à accepter. Car sur le fond, l’inconscient, je ne peux le comprendre ni l’épuiser, même si je peux en appréhender certains éléments pour plus de créativité. D’ailleurs, mes élans amoureux, amicaux, existentiels, intellectuels, professionnels, ne me sont-ils pas énigmatiques ? Sais-je pourquoi je suis attiré par quelqu’un ou quelque chose, pourquoi je le désire, ou je l’aime ? non, juste, cela me parle, je ne sais de quoi, mais cela me parle. Eh bien l’inconscient, le désir inconscient, c’est cela, ce « cela me parle ». Qu’il s’agit de laisser déployer en son énigme.
Aussi avec le risque que cela implique. Qui est le risque de la singularité du désir qui se dit, puisqu’alors je m’écarte des demandes de mon environnement. Des tutelles que celui-ci veut parfois ou souvent m’imposer.
Ce « cela me parle », je tiens à le préciser, n’est pas arbitraire éthiquement. Car le désir inconscient enrichissant la parole et la vie, montre l’expérience analytique, eh bien il nait du renoncement pulsionnel[5]. Et le désir a ceci d’éthique que, dans son déploiement, il régule créativement la vie pulsionnelle et sa satisfaction, évite sa décharge directe – particulièrement de la destructivité liée à la vie pulsionnelle, contre soi ou contre l’autre -, dans le déploiement dialectique de la créativité et du symptôme[6]. Bref, il en va là d’une éthique créative, qui ouvre à une régulation créative car sublimée des pulsions, et non d’une morale répressive[7].
Cette éthique ouvre aussi à l’accueil de l’autre, de l’autre comme sujet autre, hors de toute logique névrotique de contrôle, voire pire, de toute logique de pouvoir, de maîtrise. Il en va là, loin de la morale et du surmoi moraliste, d’une éthique de la créativité, de la créativité désirante. Je tiens juste à préciser que, si Lacan a ouvert la réflexion sur l’éthique de la psychanalyse, sur cette question éthique de l’accueil de l’autre, je me réfère particulièrement à Lucien Israël ou à Winnicott. Malgré leurs immenses apports, particulièrement concernant la dimension tragique de la subjectivité et du collectif, Freud et Lacan ne sont pas allés jusque-là. L’idée d’un accueil de l’autre en tant qu’autre sujet leur est restée lointaine, sans doute du fait du pessimisme existentiel lié à leur conservatisme politique, ce qui leur fait le plus souvent contre-investir tout progressisme (8). Ce que Lucien Israël et Winnicott, dans leur optimisme tragique, ne font pas[8]. Il reste que concernant Freud et Lacan, il faut préciser que leur pessimisme – comme leur conservatisme – est dialectique: qu’il s’oppose à tout déclinisme, de la même manière que la dimension fécondement irritante de leurs pensées s’oppose au discours courant normopathe et à son hypnose de l’optimisme indemnisant (9) – auquel j’essaie d’opposer pour ma part un optimisme tragique.
Je parlais de Lucien Israël. J’aimerais rappeler que Lucien Israël est un analyste élève de Lacan qui a permis que dans l’Est de la France la psychanalyse freudo-lacanienne est solidement implantée. Et qui s’est donné le droit d’être infidèlement fidèle – pour parler comme Derrida – à Lacan. J’aimerais aussi évoquer son grand livre, qui est d’ailleurs un excellent livre d’introduction à la psychanalyse sous sa forme solidement créative : Boiter n’est pas pécher[9].
Ainsi, dans la cure analytique, contrairement à d’autres thérapies plus adaptatives, par l’interprétation, l’analyste ne donne pas la signification ultime d’un mot, au contraire il cherche à aider le sujet à élaborer créativement, à déployer dans sa parole, plus d’ambiguïté, d’équivocité, de surdétermination, de poéticité, de désir, pour que cela se déploie dans son discours, sa vie psychique, ses actes, son existence. Comme le dit mon ami Nicolas Janel, l’interprétation analytique est ainsi une désinterprétation[10]. Ce qui implique que l’analyste ne déploie pas un savoir de surplomb, depuis une position d’autorité.
Et ceci étant mis en place dans la cure, le sujet alors peut faire plusieurs choses : il peut revenir sur l’histoire des mots qu’il énonce et sur l’histoire de la forme de sa parole dans son environnement. Oui, il peut revenir sur leur signification dans la parole de son environnement, revenir aussi sur la forme de sa parole, et de la parole dans son environnement. Ce pour que sa parole à lui, par rapport à celle de son environnement, se singularise[11], se charge de désir, se fasse créative, se charge de nouveau, de nouveaux signifiants, ou d’une écoute nouvelle des mots importants dans son discours ou dans le discours de son environnement. Pour toujours rendre sa parole – en lien au signifiant – plus ambigüe, surdéterminée, poétique, riche symboliquement. Plus créativement désirante. Et sa vie, aussi, plus créativement désirante. Et éthiquement désirante – avec ce que cela implique de l’accueil de l’autre dans son altérité, son énigme, son geste, son désir, sa créativité.
Dans la cure encore, cela passe par le repérage de ce qui dans la parole du sujet, et dans celle de son environnement, relève de l’ évitement du désir – de la défense contre le désir, plus ou moins massive. Cette défense est d’ailleurs liée à la tendance narcissique au contrôle dont je vous parlerai plus loin. Liée aussi aux demandes de l’environnement. Qui amènent à laisser son désir de côté, le plus souvent.
Bref, Freud a montré l’existence de la réalité psychique en plus de la réalité extérieure. Mais c’est aussi la réalité discursive que la psychanalyse permet de prendre en compte – Freud en premier lieu, et Lacan plus encore après lui. Cette réalité discursive dont, d’une autre manière, les sciences humaines nous parle tant – Foucault en 1er lieu[12].
Et tout ça, cela implique que l’analyste, dans son écoute, ses interventions, n’est pas en position d’autorité mais d’écoute. Qu’il refuse la position d’autorité. C’est un point important. D’ailleurs, le psychanalyste n’est aussi pas en position d’autorité, parce que ne prend pas de décision pour le patient. Par exemple à la différence du médecin.
Plus encore, l’expérience analytique montre que, dans le déploiement de sa parole, le patient croit et croira toujours quelque part, dans son fantasme narcissique, que l’analyste est le détenteur d’un savoir – voire du pouvoir – sur son désir inconscient. Que l’analyste est une autorité au sens fermé du terme. Eh bien dans la cure, il s’agit – c’est d’ailleurs là l’apport de Lacan contre Freud – d’amener le sujet à se dégager de ce fantasme de savoir. J’aimerais préciser que cette autorité de savoir que le sujet érige dans son fantasme, Lacan, l’appelle d’ailleurs le « Sujet Supposé Savoir ».
En ce sens, contre le fantasme comme piège de la croyance en une autorité, la cure vise le fait que le sujet reconnaisse, appréhende quelque peu – énigmatiquement, dans l’écoute analytique – son désir inconscient. Alors comme le dit Lacan, le sujet s’autorise de son désir[13]. Et du coup il n’a plus besoin d’ériger une autorité fantasmatique qui saurait ce qu’il en est de son désir inconscient. Bref, le sujet, pour s’autorise de son désir, doit mettre en crise toute autorité.
Car personne, aucune autorité, ne peut savoir ce qu’il est en du désir inconscient, ni l’autre, ni soi. Le désir inconscient, on peut le métaphoriser, le dire, et donc le (re)créer, ou l’écouter et l’interpréter, et ainsi le reconnaître (en une réflexivité où, comme le dit Lacan, « la raison peut faire du poids »), et l’appréhender, pour le libérer et libérer sa force éthiquement créatrice – discursivement, dans les actes que l’on pose, existentiellement, dans le lien à l’autre. Pas le comprendre, dans une maîtrise de savoir, en position d’autorité.
Plus encore, il s’agit aussi, dans la cure, concernant ce fantasme d’une autorité de savoir, de le déconnecter d’un scénario de pouvoir si ce scénario existe. La psychanalyse se positionne par définition contre le pouvoir.
Pour détailler ce point, le fantasme narcissique – imaginaire en termes lacaniens – qui habite interminablement chaque sujet (y compris l’analyste, mais celui-ci sait dialectiser ce fantasme) est aussi un fantasme de contrôle de ce qui échappe au sujet. C’est-à-dire un fantasme de contrôle du réel au sens psychanalytique : la mort, le sexe ; ou encore de contrôle des difficultés internes et externe, ou encore de sa détresse fondamentale, et surtout donc son désir inconscient.
Bref, lorsque je parle de symbolique, de l’imaginaire et du réel, j’élabore sur ce triptyque génialement inventé par Lacan pour nous orienter dans la pratique psychanalytique.
Ceci est important car tout sujet qui parle cherche toujours quelque part, en son narcissisme, à se protéger du réel, à le contrôler. C’est quelque chose d’humain. Le désir inconscient est inéluctablement énigmatique, et existence est difficile ; cela est bien compréhensible – même si à élaborer.
D’ailleurs, en philosophie, Nietzsche a insisté sur la part d’illusion inéluctable chez le sujet, pour faire face au tragique de l’existence ; mais aussi et sur le fait que cette inéluctable part d’illusion, il s’agit de la traverser mais non de croire faire disparaître. Eh bien la psychanalyse va dans ce sens.
Bref, tout sujet subjectivé a toujours un narcissisme, un imaginaire en termes lacaniens, c’est-à-dire une tendance au contrôle. Et il s’agit, dans la cure, non de la nier, cette tendance narcissique humaine au contrôle, mais de la lire dans la parole du patient, de la reconnaître et ainsi d’éviter qu’elle s’enkyste en une tendance à la maîtrise. Il s’agit dans la parole analytique de faire en sorte que ce fantasme narcissique – comprenant donc en son noyau, comme l’a montré Lacan, la croyance en une autorité de savoir – soit traversé, perlaboré, que le sujet le repère, le dialectise le plus possible, en désactive en bonne partie l’effet. Pour que le sujet accède à une plasticité psychique, une capacité de mise en crise de soi. De « penser contre soi », comme dit Sartre. Bref, dans la cure, au niveau du changement de la forme de parole du sujet, il s’agit d’aider le sujet à mettre en place une capacité de plasticité psychique, liée à la créativité de sa parole. Et que cette plasticité psychique et cette créativité de parole perdurent elle pour toujours déjouer le plus possible l’interminable tendance narcissique au contrôle.
Plus encore, ce que montre la cure, certes de manière contre-intuitive, c’est que, comme le dit Nietzsche dans ses termes à lui, à un certain niveau, l’existence de ce narcissisme est même à souhaiter, pour pouvoir le dialectiser. Car alors le sujet existe en tant que sujet, lorsqu’il essaie de se protéger du réel. Si le sujet n’existe pas comme sujet, s’il n’a pas de narcissisme, il est au contraire plongé dans le réel – et désubjectivé. En effet, j’aurais dû dire tout de suite que tout sujet a une tendance au contrôle, mais aussi que cette tendance peut : soit être narcissique, névrotique, subjectivée, si le sujet est subjectivé ; soit relever de la logique de maitrise totale, si le sujet est désubjectivité, sans narcissisme et sans désir, et cherche à tout maitriser. Dans ce dernier cas, il n’y pas vraiment, dans la parole du sujet, de subjectivité, pas de désir ou de symbolique, pas de narcissisme ou d’imaginaire non plus. Pour prendre un exemple, Trump, contrairement à ce qu’on dit, en ce sens, est un sujet qui n’a pas de narcissisme, il est juste totalement désubjectivé, conformiste. Et désubjectivant. Il parle un discours collectif sans sujet, et donc sans narcissisme et sans désir. La conflictualité entre narcissisme et désir, allant d’ailleurs toujours de pair – et la psychanalyse visant à dialectiser le narcissisme et la tendance au contrôle pour laisser se déployer le désir créatif.
Mais j’en reviens au fantasme narcissique, chez le sujet subjectivé. Donc, quelque part ce fantasme narcissique, cette tendance au contrôle, persistera toujours. Car, subjectivement, le symptôme du sujet renvoie au fantasme narcissique, à la tendance au contrôle du sujet. Et le symptôme, marque de singularité, marque de défense singulière, ça ne disparait pas. A un certain niveau, pour que la subjectivité singulière du sujet existe – que le sujet ne soit pas désubjectivé, il faut du symptôme. La psychanalyse fait l’éloge du symptôme, contre les thérapies plus adaptatives qui refusent la singularité du sujet, et donc son symptôme.
Ici, ce que propose la psychanalyse, c’est une conception dialectique du narcissisme et du symptôme, de reconnaître l’existence du narcissisme, de traverser le narcissisme ; et donc aussi de travailler à traverser par la parole le symptôme lié au narcissisme ; bref de dialectiser le symptôme – même s’il y aura toujours heureusement du symptôme. La psychanalyse, c’est en ce sens déployer créativement une plasticité psychique et discursive, une capacité de mise en crise de soi, de pensée contre soi, de changer de discours[14] ; c’est en ce sens travailler à assouplir le symptôme, la tendance au contrôle, et plus largement les mécanismes d’évitements ; c’est, comme dit Lacan, savoir y faire avec son symptôme, de manière créative. Et non pas nier le symptôme, ou la tendancea au contrôle et les mécanismes d’évitements du sujet, comme le font le scientisme et les thérapies plus adaptatives.
D’ailleurs, pour élaborer sur cette question, concernant le scientisme contemporain dans le champ des thérapies et plus généralement, Lacan les a très bien repérés, en parlant de ce qu’il appelle le « service des biens »[15]. Ce afin de qualifier la grande machinerie scientifique et économique, mais aussi discursive et psychique, dominante dans nos sociétés – en même temps, ajouterais-je, qu’il existe aussi des interstices, des niches ou des espaces institutionnels ou collectifs qui y échappent. Dans ce service des biens, le sujet est pris dans tout un système de tutelles – au pluriel –, discursives et psychiques, auxquelles on lui demande de s’adapter, de se soumettre, dans une servitude volontaire. Ce qui produit des éléments de désubjectivation – ou la « vie abîmée » au sens d’Adorno[16]. Car, dans nos sociétés modernes, aujourd’hui comme hier, nous avons bien à faire, et Lacan qui a fait l’éloge des recherches de Foucault le sait bien, à un système de tutelles discursives et psychiques. Celui-ci enserre les sujets, et le collectif, déploie un véritable rejet de la parole, une véritable « logophobie » (Foucault) et désubjective massivement – malgré quelques niches et quelques espaces plus ouverts[17]. Et il érige d’ailleurs une forme spécifique, contemporaine, d’autorité au sens fermé du terme, de direction de parole – de direction de conscience, dirait Foucault[18]. Et ce système de de pouvoir, de tutelles discursive et psychique, il s’agit, dans la psychanalyse ou plus largement, de le reconnaître afin d’essayer d’ouvrir des interstices ou même des espaces subjectivants.
Et, dans mon optique, le psychanalyste essaie, s’il le désire, d’aider le sujet à écouter le discours allant dans le sens de ces tutelles, discours dans lequel il est pris, et il essaie de l’aider à se dégager de ce système de tutelle. Cette écoute du ou des discours collectifs, particulièrement ceux allant dans le sens de la mise sous tutelle, par l’analyse et dans la cure, cela aide le sujet se positionner singulièrement par rapport à ceux-ci, et donc à se subjectiver.
Sachant que ce système de tutelles contemporain va avec une normativité patriarcale, androcentrée, hétéronormative et binaire[19], mais aussi mettant en place le clivage ou le dualisme humain/non-humain[20]. Plus encore, ce système de tutelles produit de nos sociétés modernes un type de sujet désubjectivé et isolée, sans lien – je dirais : sans lien de parole désirant. Sur ce point, d’ailleurs, j’aimerais rappeler qu’Horkheimer et Adorno insistent largement, en qualifiant ce sujet adapté au système de tutelles de la modernité, de « monade », désubjectivée, désingularisée, coupée de tout lien, et privé de parole et de lien de parole[21]. Bref, la parole et la vie psychique de ce sujet adapté aux systèmes de tutelle sont fondées sur la maîtrise – et non l’accueil. Ce qui va avec une conception du savoir en termes de pouvoir.
Mais j’en reviens à la traversée du narcissisme et du symptôme, qui est une question clé. Pour cela – et pour aider le sujet à se dégager du système de tutelle -, en amont, il s’agit dans la cure, par la qualité de l’écoute de l’analyste, elle-même désirante, elle-même fondée sur le désir inconscient, sur le désir de désir (Lacan) de l’analyste, elle-même créative, éthique, accueillante et plastique, elle-même soucieuse des défenses de l’analyste, il s’agit donc que la parole du sujet permette la mise en crise, et la dialectisation, de cette tendance au contrôle qui ne cesse de revenir. C’est en ce sens que le psychanalyste ne peut avoir une position d’autorité. Il est un appui temporaire, c’est tout. Et un passeur, en ce qu’il transmet une technique.
Plus largement, la parole du sujet, dans ce processus analytique, met aussi en crise toute autorité, et plus encore toute tutelle.
Plus encore, Lacan, dans son débat avec Freud et certains élèves de Freud, a voulu insister sur le fait que le sujet n’est pas tant dépendant de ses parents en tant qu’autorités, mais dépendant, comme il le dit, du symbolique, du signifiant, des mots de son environnement, de la forme de parole de son environnement. Car cette prise en compte de la dépendance par rapport aux mots, au signifiant, au symbolique, cela ouvre au fait de prendre en compte, je dirais, le caractère dialectique de la transmission en ce qu’elle est discursive et psychique. Ici il me faut dire, concernant ce caractère dialectique de la transmission, que Lacan nous permet d’appréhender les choses ainsi. Il a insisté sur le fait que le sujet est dépendant du symbolique, du langage en ce qu’il est symbolique, et même qu’il doit en être dépendant pour exister comme sujet, qu’il doit être inscrit dans le symbolique pour pouvoir après cela mobiliser, dans sa parole, ce qu’il appelle le trésor du signifiant. Justement le sujet doit être pris dans la symbolique, être inscrit dans lui, pour pouvoir élaborer de manière désirante, subjective, le langage en ce qu’il est symbolique, de manière créatrice. Ce qui s’oppose au fait d’être pris de manière désubjectivée dans une autre relation au langage, elle désubjectivée, qui fait que le sujet parle un discours collectif verrouillé, fermé, sans symbolique, sans subjectivité, sans créativité, sans désir inconscient, sans éthique. Ici le sujet est juste un membre anonyme de la « majorité compacte », pour évoquer la belle expression de Freud.
Bref, dans son enfance, le sujet a besoin que son environnement, ses parents, le monde des adultes, l’inscrive dans le symbolique – entendu comme créateur, et non pas comme un ordre social, normatif. Car, comme y insiste Lacan, le niveau du symbolique n’est pas celui du social – qui existe, et que, je dirais, nous devons prendre en compte, mais sans rabattre le symbolique sur le sociale ni le social sur le symbolique.
Alors, inscrit dans le langage en tant que symbolique, le sujet peut pour parler – conflictuellement, créativement et dans son symptôme – mobiliser ce que Lacan appelle génialement le « trésor du signifiant ». Je tiens à préciser que cette mobilisation du trésor du signifiant n’est pas le fait d’un acte de parole conscient: la parole du sujet, mais aussi son désir, sont bien plutôt pris dans les mots, dans la forme de parole et de son environnement. Dans la cure, le sujet est amené à le constater et à l’accepter. Et à parler depuis cefte prise, cette inscription, pour l’approfondir et l’ouvrir de manière créative.
Plus encore, les parents ou les adultes, qui transmettent – s’ils y arrivent – le symbolique, le langage, inscrivent le sujet dedans, sont-ils à ce niveau en position d’autorité ? Non pas.
Certes, à un certain niveau, en ce qu’ils décident pour l’enfant, ils sont en position d’autorité. Mais au niveau dont je parle, de la transmission, ils ne sont pas en position d’autorité mais ils sont des passeurs d’une transmission symbolique – que ce soit dans leur créativité – de parole, symbolique -, ou dans leur symptôme. Le symptôme étant une marque de désir, de subjectivité singulière existante mais non encore déployée ; et le symptôme est en cela, je le répète, opposé à l’adaptation toujours privée de symptôme, toujours marquée par un rejet de la subjectivité.
Sachant que, à un autre niveau, dans les relations intergénérationnelles, les parents inscrivent aussi leurs enfants dans leur faille discursive et psychique, dans leur part d’évitement ; mais aussi que la jeune génération travaille toujours dans cette faille, dans l’évitement des anciennes générations. En ce sens, la transmission du symbolique par l’ancienne génération est justement nécessaire pour que la jeune génération puisse élaborer cette faille de cette ancienne génération, et même si possible dialectiser la faille, ou sortir de la faille de l’ancienne génération. Pour que le sujet puisse créer, depuis son propre désir, sa propre vie, sa propre manière d’y faire avec son symptôme, en élaborant le trésor du signifiant qui a été transmis. Car le sujet, si sa parole se fait sa créative, reprend les mots de son environnement pour les ouvrir à la nouveauté de son désir singulier – en se positionnant par rapport à ce qu’a voulu son environnement pour lui. Au contraire, si sa parole est fermée, eh bien sa parole est prise dans les mots de son environnement – en ce qu’ils sont fermés.
Ici encore, du point de vue du symbolique, on le voit, le parent ou l’adulte, s’il arrive à déployer une transmission symbolique, est plus un passeur, en plus d’être l’inéluctable vecteur d’une faille. Il est plus un passeur qu’une autorité.
Sur cette question de l’autorité, j’en reviens à Freud. Pour une partie de sa pratique et de sa pensée, conflictuelle et pour tout dire contradictoire même si géniale, Freud était encore, comme l’a éclairé Lacan[22], largement pris dans le paradigme patriarcal, mettant l’autorité, et une autorité fort directive, au centre de son discours. Freud croyait en la nécessité d’un père fort, comme il dit. En ce sens, dans la cure, il était souvnt très directif, il prenait souvent le patient dans un face à face narcissique, « imaginaire » en termes lacaniens. Où il était le père, l’autorité érigeant son savoir psychanalytique (tel qu’il se le représentait), auquel le patient devait se soumettre. Avec les conséquences, je dirais, patriarcales, androcentrées et héténorormatives, binaires et dualistes, de cela. Ce même si par ailleurs il a fondé les bases permettant de faire de la psychanalyse une pratique subjectivante et s’il aussi élaboré des éléments de sortie du patriarcat, de l’androcentrisme, de l’hétéronormativité, de la binarité, du dualisme humain/non-humain.
Car, je l’ai dit, sur cette question de l’autorité comme plus généralement, Freud est contradictoire, et sa parole est conflictuelle. En effet, il a fécondement différencié la psychanalyse et le travail culturel de l’hypnose, de la logique autoritaire, à la fois hypnotique et mimétique, dont il a étudié les ressorts en ce qui concerne la psychologie des masses[23]. De plus, il a fécondement critiqué ce qui dans le social – en premier lieu pour lui la religion – relève de la recherche d’un refuge dans un giron paternel[24]. Et puis, il a fécondement insisté sur le fait que la traversée du complexe d’oedipe (qui consiste dans le fait que le sujet a un objet premier et doit connaitre un tiers qui l’oriente vers le monde) et l’élaboration subjective de la sexualité par l’enfant fondent le mouvement du sujet vers l’indépendance, l’autonomie, par rapport aux figures parentales. En ce point, très exactement, Freud parle en effet d’ « orientation autonome dans le monde ». Je le cite : « les recherches sexuelles de ces premières années sont toujours solitaire ; elles représentent un premier pas vers l’orientation autonome dans le monde et éloignent considérablement l’enfant des personnes se son entourage » [25]. Bref, Freud parle ici des éléments d’autonomie que le sujet met en place dans son enfance, pour pouvoir s’autonomiser plus tard. C’est une question que je reprendrai avec Winnicott plus loin.
Ainsi Freud est-il conflictuel, comme tout sujet subjectivé. Nous sommes ici dans les contradictions de Freud, dans son symptôme. Qu’il n’a pas assez traversé, malgré tout le travail qu’il a effectué. Chaque sujet subjectivé, plus encore créateur, est conflictuel, a ses angles morts, Freud le premier.
Plus encore, je me demande si ce ne sont pas tous les créateurs (en psychanalyse, philosophie, etc.) de la société massivement patriarcale qui nous a précédé (car je considère que nous sommes nous dans une société où le patriarcat, pour existant, est mis en crise), qui ne sont pas pris dans la contradiction suivante. Celle entre d’un côté leur inscription dans le patriarcat et dans son directivisme, et de l’autre le mouvement fondamentalement créatif, subjectivant, de leur pensée, qui contredit et traverse ce directivisme.
Face à Freud, Lacan s’est explicitement opposé à la dimension très directive, patriarcale, de sa pratique et de sa pensée. Il a insisté sur la fonction symbolique paternelle – ce que de nos jours je préférerais appeler la fonction symbolique tierce, au regard des nouvelles configurations d’orientation sexuelle et de famille. Et ce geste, Lacan l’a mené pour désactiver la figure narcissique, imaginaire, du père, que l’on trouve chez Freud et largement dans le mouvement psychanalytique jusqu’à nos jours, relevant d’un narcissisme patriarcal non traversé.
Bref, c’est fondamentalement contre ce primat freudien de l’autorité que Lacan a construit cette pratique et cette théorie en termes de créativité de la parole ou de symbolique, de narcissisme ou d’imaginaire, et de réel. Pour déployer donc son triptyque Symbolique-Imaginaire-Réel.
Plus encore, même si Lacan n’a pas parlé du psychanalyste comme « passeur », ce qu’enseigne Lacan implique que le psychanalyste est lui aussi un passeur, une forme spécifique de passeur. Insister sur ce point permet que l’analyste ne prenne pas – comme Freud et nombre de ses élèves – le patient dans une relation d’autorité, dans une croyance narcissique et névrotique (comme chez Freud) en l’existence d’une autorité de savoir (soi-disant psychanalytique), de contrôle du désir inconscient. Ou pire (et ce n’est pas le cas de Freud !), dans une logique plus psychotique et désubjectivée que la névrose (où il y a symptôme subjectif), d’une autorité de maîtrise générale sur soi, les autres, le monde : autorité autoritaire, et même paranoïaque. En une paranoïa adaptée socialement.
Car, pour faire un saut, je dirais que, au niveau du fonctionnement collectif, le leader autoritaire est en effet lié au service des biens en ce que le discours de ce leader est inscrit dans un fonctionnement social et un discours collectif paranoïaques. Ce comme le montre génialement Lucien Israël dans son grand livre Boiter n’est pas pécher – entre autres en lecteur d’Adorno, de Foucault, de Levinas. Et ce discours collectif paranoïaque s’oppose massivement au symbolique, au langage comme symbolique, comme créatif, comme subjectif, comme singulier, comme désirant, comme au narcissisme comme porteur de symptôme singulier.
En même temps que, je le rappelle, le sujet, lorsqu’il parle de manière créative, reprend les mots de son environnement pour les ouvrir. Bref, si sa parole ouvre à des nouveaux signifiants, ceux-ci sont en même temps bien pris de quelque part, du trésor du signifiant ; ils sont transportés – « métaphorisés » au sens étymologique – autrement.
Bref, je dirais que la psychanalyse montre qu’au niveau inconscient – nous ne nous en rendons pas compte, mais nous le faisons – la parole, c’est comme la cuisine, on reprend toujours des recettes. Si la création a lieu dans la parole depuis un vide symbolique[26], la tabula rasa symbolique, elle, n’est pas à souhaiter dans la parole, comme dans la cuisine. Car si le cuisinier ne suit aucune recette, le plat est infâme. Et cela signifie que le sujet peut en venir à élaborer des recettes de manière personnelle, créative, en variant sur des recettes choisies ou reçues. Autrement dit, il y a là une autonomisation discursive et psychique possible, pour parler comme Lucien Israël – qui approfondit en ce point Freud. Ce qui implique aussi pour le sujet, dans l’histoire de sa parole toujours en train de se faire, de laisser chuter certains mots et certains discours, de faire le tri. D’abandonner les recettes qu’on lui a apprises, et qu’il faisait mécaniquement, mais dont il ne veut plus pour lui.
Plus encore, pour parler de ce que j’appellerais le mouvement dialectique de l’autonomisation discursive et psychique, je dirais ceci. Ce mouvement demande donc dans un premier temps l’inscription du sujet dans le langage comme trésor des signifiants, dans une transmission symbolique, discursive et psychique – ce qui va avec une dépendance par rapport aux personnes qui opèrent cette transmission. Ce qui demande en amont un passeur, qui a un désir de transmission symbolique : ce que Lacan appelle, je l’ai dit, en psychanalyse un désir de désir, un désir du désir du sujet.
Puis dans un deuxième temps, en s’appuyant sur cette inscription, le sujet peut élaborer subjectivement cette inscription, s’autonomiser, sortir de cette dépendance intersubjective, passer de l’hétéronomie à l’autonomie discursive et psychique, en reprenant de manière créative ce qu’il a symboliquement reçu, avec des éléments de saut créatif. Ce qui demande ici encore une figure qui fait appui, qui accepte ce geste d’autonomisation – et qui à ce niveau, par cette acceptation, se fait passeur, car il sait que c’est dans cette reprise subjective, cette infidèle fidélité que peut uniquement avoir lieu la transmission[27].
Sur cette question de l’autonomisation discursive et psychique, dans ses deux temps dialectiques, je voudrais citer Paul Celan. « Prends l’art avec toi pour aller dans la voie qui est le plus étroitement la tienne. Et dégage-toi »[28].
Et puis, pour évoquer deux grandes figures de l’histoire de la psychanalyse, Mélanie Klein et Donald Winnicott, j’aimerais aussi citer ce dernier. Ce dans une lettre à celle-ci, à laquelle il doit beaucoup, en même temps qu’il élabore ce qu’elle fait en se donnant le droit d’avoir son geste de critique de son apport là où il lui semble être problématique. Je cite Winnicott : « il est très important que votre travail soit reformulé par des gens qui font des découvertes selon une voie qui leur est propre et les présentent avec leurs propres mots. C’est de cette façon seulement que l’on gardera le langage en vie. Si vous stipulez qu’à l’avenir seul votre langage sera utilisé pour rapporter les découvertes des autres, alors le langage mourra. (…) Vos idées ne vivront que pour autant qu’elles seront redécouvertes et reformulées par des gens originaux, tant à l’intérieur du mouvement analytique qu’à l’extérieur[29]. »
Voilà en tout cas ce que je dirais déjà de la transmission, aussi donc en bonne partie avec Lucien Israël élaborant Lacan. Car Lacan ouvre fondamentalement à un trouage, à une détotalisation de l’héritage du langage, du signifiant, de la mémoire – de l’Autre comme symbolique, dirait-il.
Il reste que Lacan, malgré son apport fondamental, est lui aussi contradictoire. Il a aussi parfois déployé son apport dans une directivité problématique, particulièrement avec ses élèves[30] – ce que certains philosophes comme Foucault, Deleuze, Derrida, Castoriadis, ont critiqué à raison.
A ceci, j’aimerais ajouter que certains des élèves de Lacan, dont Lucien Israël, ont déployé un freudo-lacanisme qui reprendre l’apport lacanien en le dégageant de cette directivité lacanienne[31].
A mon sens la critique de cette directivité problématique Lacan, qui est un symptôme, nous permet en retour de mieux mettre en perspective son apport fomidable ; et au sein de cet apport, nous pouvons je pense relever le fait qu’il a solidement ouvert, dans la champ de la psychanalyse, la voie pratique et théorique, vers la singularisation – je dirais l’ « autonomisation » – discursive et psychique. Mais je dois repréciser de suite que c’est avec Freud et Lucien Israël que je parle d’autonomisation. En effet, Freud parle, je l’ai dit, de l’autonomie du sujet dans ses élaborations de sa sexualité, mais il parle aussi, par exemple, de l’autonomie du sujet, lorsqu’il développe l’idée (dans l’esprit des Lumières[32]) selon laquelle les grands écrivains sont des « éducateur(s) et de(s) libérateur(s) des êtres humains », soucieux de l’ « avenir culturel de l’humanité »[33]. A la différence de cela, Lacan ne parle lui jamais d’autonomisation ni d’émancipation, il ne parle pas de liberté mais plutôt de « peu de liberté » – ce qui implique tout de même un peu de liberté –; en même temps que pourtant, au fondement de son enseignement, il fait référence aux Lumières (sous leur forme féconde) et parle de singularisation du discours du sujet par rapport à l’Autre avec un grand A, comme discours collectif ambiant – ce qui selon moi va dans les faits quelque chose comme une autonomisation discursive et psychique !
Plus encore, en ce qui concerne les discours collectifs, il est vrai qu’il existe de manière courante tout un discours collectif de l’ « autonomisation » qui relève de la mise sous tutelle – comme l’ont relevé, avec Lacan, Adorno et Foucault. Cela se retrouve particulièrement dans le discours managérial contemporain[34]. Dans mes termes, je dirais que nous avons ici quelque chose comme une « pseudo-autonomisation » qui d’ailleurs rejette la dépendance première du sujet, et donc empêche toute transmission et toute autonomisation psychique et discursive.
J’ai dit que Lacan fait référence aux Lumières. Voilà ce qu’il avance dans le séminaire Ou pire : « Et dans (…) mes Écrits, vous le voyez (…) j’invoque les Lumières. Il est tout à fait clair que les Lumières ont mis un certain temps à s’élucider. (…). Contrairement à tout ce qu’on en a pu dire, les Lumières avaient pour but d’énoncer un savoir qui ne fût hommage à aucun pouvoir »[35]. Ici, Lacan insiste sur le fait que la psychanalyse telle qu’il la conçoit est une élucidation et une élaboration des Lumières – et une élaboration sur Kant qui écrit que « Les Lumières, c’est la sortie de l’homme hors de l’état de tutelle dont il est lui-même responsable »[36]. Or, il me semble que ce projet de sortie de la tutelle reste fécond, concernant les Lumières, même si la critique des Lumières – entre autres de leur évolutionnisme et de leur dualisme entre humain et non-humain – est nécessaire.
J’aimerais maintenant prendre un moment pour évoquer la pratique psychanalytique et la pensée de Lucien Israël. Que nous dit-il ? Dans la lignée de Freud (du Freud plus ouvrant), il nous dit que la psychanalyse ouvre à une séparation subjectivante d’avec les figures de transmission ou d’autorité, dont parentales. Mais aussi d’avec l’analyste – qui lui n’est pas une autorité.
En effet, à propos de la séparation, Israël, traite de manière très parlante de l’éthique de la psychanalyse et du fait que le psychanalyste doit justement avec l’analysant, dans son appui pour la dynamique psychanalytique, faire preuve d’une certaine humilité et ne pas se considérer comme la fin en soi du processus psychanalytique. Bien plutôt, il doit être au service du déploiement du processus psychanalytique, et donc de la subjectivation du psychanalysant. Pour élaborer cela dans mes termes, je dirais que le psychanalyste, et en premier lieu son désir, est un simple appui pour la subjectivation, qui pourra être abandonné le moment venu - dans le mouvement dialectique de l’autonomisation discursive et psychique.
Plus encore, Israël parle bien d’ « autonomie »[37], tout en faisant l’éloge de l’individualisme de la culture occidentale (sous sa forme féconde) : « le mérite de notre civilisation est d’être une civilisation individuelle et subjective »[38]. Et en étant lucide sur la question du pouvoir : « dans notre civilisation, tout conspire au maintien d’une dépendance par rapport au pouvoir »[39].
Une question se pose alors concernant Israël : y a-t-il un auteur, en plus de Freud, qu’il a élaboré pour parler ainsi d’autonomie ? A mon sens, c’est Adorno, qu’il ne cite pas sur ce point, mais évoque ailleurs, particulièrement concernant ce que le philosophe allemand appelle la « personnalité autoritaire » – dans les Études sur la personnalité autoritaire – et où il évoque bien cette question de l’autonomie. D’ailleurs Adorno a développé une pensée rigoureuse de l’autonomie comme sortie de la tutelle – particulièrement dans « Education à la majorité »[40]. Opposée comme il le dit à tout le discours de la pseudo-autonomie qui en fait sert la mise sous tutelle. De la réflexion d’Adorno dans ce texte, je parlerai d’ailleurs plus loin.
Pour en revenir à la transmission qu’opère la pratique psychanalytique, je dirais que le psychanalyste transmet la technique psychanalytique et l’éthique en acte dans la cure, tels qu’il les élabore lui, le psychanalyste, pour que l’analysant les élabore à sa manière, dans son indocilité subjectivante, son infidèle fidélité.
D’ailleurs, le fait que le psychanalyste fasse preuve de plasticité, et pratique l’accueil de l’autre sujet dans son altérité, permet cela. Et, toujours pour élaborer sur le lien entre psychanalyse et philosophie, j’aimerais d’ailleurs ici insister sur le fait que sur cette question de l’accueil de l’autre sujet dans son altérité, Lucien Israël élabore explicitement Levinas[41].
Mais j’en reviens maintenant à Lacan. Car, pour essayer d’éclairer sur cette question de l’autonomie, j’aimerais maintenant parler d’un point précis du large débat de Lacan avec Marx. En effet, Lacan a parlé de l’inscription nécessaire du sujet dans le symbolique, dont je vous ai parlé plus avant, en termes d’ « aliénation ». A mon sens, il a ainsi voulu insister sur la dépendance du sujet par rapport au symbolique, sur la prise du sujet dans le signifiant, mais en même temps il a temps cherché à s’approprier polémiquement le concept marxiste d’aliénation – en même temps qu’il a mis au travail psychanalytiquement certains apports de Marx. Et à s’opposer de manière quelque peu conservatrice à toute réflexion – marxiste ou bien progressiste – sur l’autonomie. Pour ma part, je trouve assez malheureuse cette utilisation conservatrice du terme d’aliénation. Car cela vient plus obscurcir nos enjeux que les éclairer, et cela amène à mon sens Lacan ne pas pleinement voir la conséquence de son geste fondamental à lui : d’orienter la psychanalyse vers l’autonomisation, discursive et psychique, en ce que celle-ci a de dialectique, et est permise par une transmission véritable. En tout cas, c’est ainsi que j’interprète – dans le sens de ce que j’appelle un progressisme subjectivé[42] – le geste de Lacan sur ce point.
J’ai donc parlé d’un certain conservatisme de Lacan. Mais tomme toujours chez lui, les choses ne sont pas unilatérales. Ce conservatisme est bien complexe. Il reste que ce conservatisme s’exprime paradigmatiquement lorsqu’il avance que la revendication sociale et culturelle des jeunes générations de son époque, dans le cadre de Mai 68 et plus largement, relève fondamentalement de la recherche d’une nouvelle forme de Maître. A ceci, je réponds avec mon ami Benjamin Lévy, qu’il existe des revendications problématiques, mais aussi des revendications désirantes[43].
J’aimerais maintenant en revenir à la dialectique de l’autonomisation discursive et psychique, Cette dialectique de l’autonomisation, elle peut se déployer dans la cure psychanalytique, mais aussi ailleurs. Et pour parler de cette autonomisation véritable en ce qu’elle est dialectique, j’ai plus avant cité Celan. Mais j’aimerais ici évoquer Adorno, qui l’a bien pensée dans ses termes à lui, cette autonomisation discursive et psychique. Il l’a pensée à ma connaissance dans deux textes.
Le premier de ces textes, c’est dans la courte et géniale interview « Education à la majorité ». Dans ce texte, s’appuyant sur Freud, sur le Freud créatif insistant sur le mouvement d’indépendance du sujet par rapport aux figures parentales (dont je vous ai parlé plus avant), il élabore l’idée selon laquelle, selon lui, le sujet a, dans son cheminement psychique (et discursif) :
1. dans un premier temps : besoin d’un « moment d’autorité », d’une « identification à la figure du père (nous dirions de nos jours au tiers[44]) et à la figure paternelle de l’idéal du moi » ;
2. puis dans un deuxième temps, il avance que le sujet « doit se séparer de cette identification pour accéder à l’état de majorité ». Et Adorno insiste sur le fait que ce moment d’identification à la figure paternelle (nous dirions tierce) ne doit pas être « vénéré » ni « maintenu », mais bien envisagé de manière critique et dépassé[45].
Le deuxième de ces textes, où il a pensé l’autonomisation discursive et psychique, c’est dans sa réflexion sur Hölderlin dont je vous au parlé, intitulée « Parataxe » que l’on trouve dans « Notes sur la littérature ». Nous y trouvons d’ailleurs la même théorie de l’autonomisation discursive et psychique. Adorno voit en effet dans la poésie d’Hölderlin, je traduis, quelque chose qui exprime « la dureté de son destin » ; et ce destin a à voir, dit-il avec une « grande indépendance par rapport aux pouvoirs de son origine, particulièrement la famille ». Je cite encore Adorno : « dans les faits, cela le mène loin. Hölderlin a cru en l’idéal qu’on lui a appris, et l’a en tant que protestant pieux vis-à-vis de l’autorité, intériorisé jusqu’à en faire une maxime. Puis il a dû expérimenter que le monde est autre que les normes que cet idéal a implantées en lui ». Et Adorno insiste aussi sur le fait que c’est dans le travail poétique sur la « langue », qu’a lieu ce qu’il appelle génialement la « sublimation de sa première conformité » – en termes psychanalytiques je parlerais de traversée de l’idéal que l’environnement familial transmet dans ses symptômes. Puis Adorno précise même que ce travail poétique sur la langue prend la forme de ce qu’Hölderlin lui-même appelle l’ « inversion des mots » et « l’inversion des périodes »[46], du rythme au sens poétique, justement dans la poésie paratactique, introduisant du vide – évidant la parole. D’ailleurs, Celan, que j’ai aussi évoqué car il a aussi pensé cette autonomisation discursive et psychique, parlera lui aussi d’inversion ou plutôt de « renverse de souffle »[47].
Et, pour revenir à la psychanalyse, je vous l’ai dit, cette autonomisation de la parole du sujet par l’inversion des mots et du rythme de parole, qu’Adorno et Celan mettent en lumière, en général ou dans l’écriture poétique, elle peut aussi avoir lieu dans la cure (tel que je la conçois avec Lacan et Israël). Et, pour faire écho à ce qu’avance Adorno, j’ajouterais même à cela qu’elle peut avoir lieu dans la cure par le retour du sujet sur l’envers, ou bien l’équivocité, des mots, mais aussi dans la mise en place dans la parole du sujet de ce que Lacan appelle des scansions, des moments d’expérimentation du vide – en termes poétiques : des moments de parataxe.
Plus encore, pour essayer de bien poser les enjeux entre les différents auteurs que j’évoque, je dirais que, de leur côté, Lacan et Lucien Israël ont insisté sur la transmission symbolique – qui est aussi transmission du désir. Alors que de l’autre, Freud et Adorno ont plus insisté sur l’identification au père (ou au tiers) et l’idéal. Mais Lacan et Lucien Israël rejoignent Adorno sur cette question : il existe une part d’idéal – et symptômale – du discours du parent que le sujet doit reprendre et traverser, pour s’en détacher.
Dans cette réflexion sur la transmission et l’autonomisation comme dialectique, j’aimerais aussi, évoquer les élaborations de Winnicott[48]. En effet, Winnicott insiste sur la manière dont, dans la cure, l’analysant utilise (c’est là son terme) l’analyste pour son geste à lui de subjectivation. Mais il insiste aussi sur la manière dont dans le champ de l’éducation et de la transmission en général, le jeune sujet utilise le parent ou la figure adulte d’appui pour son geste à lui de subjectivation, dans lequel il fera ce qu’il désire lui de ce qui lui a été transmis. Et dans lequel la figure d’appui – ce que j’appelle le passeur – ne peut soutenir la subjectivation du jeune sujet que s’il laisse le sujet faire son geste à lui, en ce qu’il est différent du sien, et accepte donc d’être utilisé en ce sens.
Dans la réflexion de Winnicott, nous retrouvons d’ailleurs les deux temps de l’autonomisation psychique et discursive évoqués avant :
1. Dans un premier temps, il en va de l’enrichissement de la vie psychique et la parole du sujet, par son appui préalable sur les figures de transmission, ou dans la cure, sur l’analyste. Et c’est là un appui sur la créativité de ces figures d’appui, dans ce qu’il appelle le jeu, la dimension ludique de toute élaboration dans le lien de parole (qu’il appelle transitionnel), qui permet au sujet de déployer sa créativité à lui. Cela implique d’ailleurs ajoute à cela Winnicott, le fait que le sujet peut pleinement vivre avec ces figures d’appui (parentales, adultes ou autres – psychanalytiques si nécessaire) son état de dépendance ou de minorité psychique et discursive. Cela permet aussi que le sujet déploie dans son enfance, ou dans le premier temps de sa subjectivation, ce que j’appellerais des éléments d’autonomie que le sujet, pour pouvoir dans un deuxième temps s’autonomiser – point sur lequel Freud a insisté, comme je l’ai évoqué plus avant.
2. Dans un second temps peut alors avoir lieu l’autonomisation et la singularisation de la vie psychique et de la parole du sujet lorsque le sujet, ayant vécu jusqu’à son terme cet état de dépendance et de minorité, peut s’en détacher.
Cela implique d’ailleurs, comme le montre Winnicott qui a d’ailleurs développé des réflexions très intéressantes sur la démocratie[49], deux choses :
A. Dans la vie psychique et la parole du jeune sujet, à l’adolescence, cela implique une nécessaire mise à mort fantasmatique des figures d’autorité – une mise à mort fantasmatique et non réelle. Et ici, selon Winnicott, la figure d’appui a pour fonction de survivre et d’accueillir ce geste autonomisant, subjectivant.
B. Toujours dans la vie psychique et la parole du jeune sujet adolescent, Winnicott insiste aussi sur la nécessaire mise en crise du discours des parents et des figures d’appui. Et ce qui aide alors ici, c’est que ceux-ci acceptent cette mise à mort fantasmatique et cette mise en crise. D’ailleurs cette mise en crise s’appuyant, pour devenir subjectivante, sur ce qui a été transmis, par une élaboration de ce qui a été transmis de créatif et de fécond (mais aussi, ajouterais-je, une traversée des failles des figures d’appui)
Bref, dans sa réflexion politique fort stimulante, Winnicott insiste sur la relation entre l’existence politique et sociale de la démocratie et l’existence psychique et existentielle de la crise d’adolescence. Selon lui, la démocratie est selon lui un système politique et culturel où les jeunes générations peuvent mettre en crise le(s) discours des anciennes générations.
J’en reviens à la cure. Que fait l’analyste dans la cure ? Eh bien il écoute, de manière également flottante, comme nous dit Freud. Il pratique une technique d’écoute et de parole, qu’en passeur il transmet. Sans être en position d’autorité. Il laisse-être, dit Lacan. Ainsi propose-t-il ce que j’appelle un lien de parole désirant. Permettant au sujet déjà subjectivé de cheminer dans le sens que j’évoquais. Mais permettant aussi au sujet désubjectivé – pour peu qu’il ne soit pas pris dans une désubjectivation trop massive, mais qu’il ait gardé une capacité d’ouverture – de s’inscrire dans le langage, dans le symbolique. De naître ainsi au désir inconscient, à une parole subjective, symboliquement créative. Ainsi, à ses patients non subjectivés, l’analyste peut procurer un lien de parole désirant, une expérience de rencontre symbolique et de dépendance au symbolique, discursive, psychique, pour qu’il puisse naitre à sa subjectivité, à son désir, en s’inscrivant dans la symbolique[50].
Et avec le patient déjà subjectivé, il peut l’inviter à revivre sa dépendance discursive et psychique, passée, pour la retraverser autrement, de manière plus désirante, subjectivante, plus autonomisante discursivement et psychiquement.
On comprend dès lors pourquoi les institutions, les dispositifs de tutelle et de pouvoir, et le service des biens, ont tant de mal avec la parole psychanalytique. Comme avec la vraie parole en général. C’est pour cela qu’avec Foucault je parle de « logophobie », de haine du discours, de haine de la parole.
De plus, ce que je vous ai présenté ici implique que, concernant le sujet né à sa subjectivité par une inscription dans le symbolique, qu’il peut cheminer vers son autonomisation discursive et psychique, et sortir des tutelles discursives et psychiques que certaines parties de son environnement cherche à lui imposer. Bref, la technique de parole psychanalytique va dans le sens de la singularisation du discours du sujet par le déploiement du désir inconscient. Cela passe par le dégagement de la parole du sujet du discours collectif – et de la norme collective – dans lequel celui-ci est plongé.
Ainsi, par la forme même de son écoute, le psychanalyste écoute-t-il le discours collectif dans lequel l’analysant est plongé. Dès lors, si le travail psychanalytique se fait, aide-t-il aussi le sujet dans le travail d’écoute du discours collectif et de la norme dans lesquels il est pris, et ainsi vers la sortie de toute tutelle discursive, psychique, sociale. Vers le dégagement discursif de toute norme aussi, car cette autonomisation implique dénormativation, une singularisation. Vers le dégagement discursif de toute norme, qu’elle soit institutionnelle, ou culturelle, c’est-à-dire de toute norme patriarcale, androcentrée, hétéronormée, binaire en termes de genre, ou dualiste du point de vue de la relation humain/non-humain. Et vers la relation de mise en crise de l’autorité que cela implique, particulièrement si cette autorité déploie une parole normative.
Je dirais même, en ce point, que dans sa manière de dénormativer la parole, la psychanalyse, à sa manière, mais comme la parole démocratique, produit ce que
concernant la démocratie appelle un vide au centre[51]. Et ce vide au centre, sur ces deux plans différents que sont la psychanalyse et la démocratie, eh bien il implique que toute norme est remise en question, débattue., mise en crise. Car la dynamique démocratique implique elle aussi une dénormativation sociale permanente. Liée au fait que le collectif est ouvert aux singularités des sujets, et de leurs paroles. Bref, la dénormativation démocratique contemporaine, dont relève les nouveaux discours collectifs féministes, sur l’orientation sexuelle, sur le genre, écologiste, est bien parallèle à la dénormativation psychanalytique, et ces deux dénormativations peuvent se rencontrer – sans se confondre.
Tout ce que je dis là implique pour le sujet que, s’il a la chance de pouvoir vivre un lien subjectivant, un lien de parole fécond – et ce peut être l’analyste –, il peut, par l’analyse en 1er lieu, avoir une marge de manœuvre par rapport au système de tutelle dans lequel est. Cela passe par le déploiement d’une créativité. Cette créativité peut ouvrir des interstices, voire des espaces, ou échouer ; puisqu’avoir son geste implique toujours un risque. Plus encore, cette créativité peut aussi travailler à une mutation discursive subjective et collective qui rend le collectif favorable à la subjectivité – et donc démocratique.
Ainsi, concernant la question de l’autorité dans nos sociétés (par exemple l’autorité parentale), eh bien, il me semble que la psychanalyse, si elle est soucieuse de la question de la transmission, ouvre à la prise en compte, à la reconnaissance, ou même à la création, de formes d’autorité, mais aussi donc de transmission, qui sont des appuis pour la subjectivation. Sachant qu’une autorité ouvrante assumera aussi une fonction de transmission, qui permettra au sujet de la remettre en question.
Tout ceci me semble important à dire, particulièrement dans notre société où une très grande partie des jeunes générations met en crise la verticalité patriarcale et déploient des liens plus horizontaux. Cela va régulièrement avec le déploiement de revendications désirantes, pour parler comme mon ami Benjamin Lévy, qui a développé une réflexion très féconde sur la relation entre psychanalyse et politique dans son très important livre L’ère de la revendication.
Cette horizontalité nouvelle, mise en place par l’évolution culturelle et par une très grande partie des jeunes générations, peut être l’espace de déploiement d’une transmission, car la transmission, ça opère depuis un ailleurs – mais non pas depuis une verticalité –, et depuis un ailleurs symbolique. Je tiens à insister sur ce point pour répondre sur ce point aux conservateurs qui eux ont une conception verticale de la transmission. Bref, il existe bien – en psychanalyse et plus largement – une pensée progressiste subjectivée de la transmission. Et c’est sur ce point, insistant sur la nécessité de poser en psychanalyse le débat dans les termes d’une politique subjectivée, et donc aussi sur celle de caractériser – encore une fois avec mon ami Benjamin Lévy – l’écart entre progressisme et conservatisme, que je conclurai ma réflexion.
[1] https://www.misha.fr/agenda/evenement/colloque-pratiques-et-contre-pratiques-de-lautorite
[2] Pour une présentation plus détaillée de la manière dont j’appréhende la psychanalyse dans notre situation contemporaine, je me permets de renvoyer à « Apports de la psychanalyse créative », https://dimitrilorrain.org/2022/07/22/apports-de-la-psychanalyse-creative-texte-paru-dans-lettre-de-la-fedepsy-n10-juillet-2022/, et « Dynamique de parole créatrice et création du lien de parole désirant », https://dimitrilorrain.org/2023/04/09/texte-dynamique-de-parole-creatrice-et-creation-du-lien-de-parole-desirant.
[3] Adorno, « Parataxe » dans Notes sur la littérature.
[4] Voir Freud, L’interprétation du rêve.
[5] Je fais ici particulièrement référence à la réflexion de Lacan sur l’éthique de la psychanalyse.
[6] Ce sont deux niveaux différents, mais toujours articulés.
[7] Sur cette question de l’opposition entre éthique créative et morale répressive, je renvoie à A. Didier-Weill, Les Trois temps de la loi, mais aussi au texte de D. Winnicott, « Morale et éducation », dans Processus de maturation chez l’enfant, Paris, Payot, 1970, p. 55-70.
(8) Sur les oscillations de de Freud sur la question politique, on pourra consulter Florent Gabarron-Garcia, L’héritage politique de la psychanalyse. Ainsi qu’Elizabeth Ann Danto, Freud′s Free Clinics – Psychoanalysis and Social Justice 1918–1938. Concernant ce que j’appelle le pessimisme – dialectique – de Lacan, je le relie à la part de fascination – à mon sens mélancolique – pour la mort que l’on trouve dans son oeuvre, telle que l’étudient en philosophie J. Rogozinski dans Le Moi et la chair et, dans une optique psychanalytique freudo-lacanienne, P. Guyomard, dans La jouissance du tragique, Paris, Aubier, 1998.
[8] Sur ces questions de l’optimisme tragique d’Israël et de Winnicott, je renvoie à D. Lorrain, « Dynamique de parole créatrice et création du lien de parole désirant », https://dimitrilorrain.org/2023/04/09/texte-dynamique-de-parole-creatrice-et-creation-du-lien-de-parole-desirant.
(9) Sur la dimension fécondement irritante de Freud et de Lacan, voir J.-M. Rabaté, Lacan l’irritant, Paris, Stilus, 2023. Sur le caractère dialectique de leurs pessimismes, je renvoie à D. Lorrain, « Dynamique de parole créatrice et création du lien de parole désirant », https://dimitrilorrain.org/2023/04/09/texte-dynamique-de-parole-creatrice-et-creation-du-lien-de-parole-desirant.
[9] Strasbourg/Toulouse, Arcanes/Erès, 2010.
[10] N. Janel , https://dimitrilorrain.org/2021/03/20/nicolas-janel-la-psychanalyse-est-une-operation-de-creation/
[11] Sur cette singularisation de la parole, voir J. Lacan, Le Séminaire : Livre XVI. D’un Autre à l’autre, 1968-1969, Paris, Seuil, 2006 ; Lucien Israël, Boîter n’est pas pécher, Strasbourg/Toulouse, Arcanes/Erès, 2010 ; mais aussi D. Lorrain, https://dimitrilorrain.org/2023/04/09/texte-dynamique-de-parole-creatrice-et-creation-du-lien-de-parole-desirant.
[12] M. Foucault, par ex. L’archéologie du savoir.
[13] J. Lacan, Le Séminaire : Livre VII. L’éthique de la psychanalyse, 1959-1960, Paris, Seuil, 1986.
[14] Sur ce point, voir mon intervention au séminaire de l’ARPPS : https://www.youtube.com/watch?v=Qq7p_il9vCI&t=5720s.
[15] J. Lacan, Le Séminaire : Livre VII. L’éthique de la psychanalyse, 1959-1960, op. cit.
[16] Minima Moralia.
[17] Foucault parle de « logophobie » dans L’ordre du discours. Sur cette question, je renvoie à D. Lorrain, « Apports de la psychanalyse créative », https://dimitrilorrain.org/2022/07/22/apports-de-la-psychanalyse-creative-texte-paru-dans-lettre-de-la-fedepsy-n10-juillet-2022/.
[18] Sur cette direction de parole ou de conscience, je renvoie à D. Lorrain, « Apports de la psychanalyse créative », https://dimitrilorrain.org/2022/07/22/apports-de-la-psychanalyse-creative-texte-paru-dans-lettre-de-la-fedepsy-n10-juillet-2022/.
[19] Sur cette question, voir D. Lorrain, « Dynamique de parole créatrice et création du lien de parole désirant », https://dimitrilorrain.org/2023/04/09/texte-dynamique-de-parole-creatrice-et-creation-du-lien-de-parole-desirant.
[20] Sur cette question, dans mon intervention au séminaire de l’ARPPS du 9 mai 2023, j’élabore psychanalytiquement les apports de Ph. Descola, Par-delà nature et culture, Paris, Gallimard, 2005 ; et B. Latour, Nous n’avons jamais été modernes, Paris, La Découverte, 1991. Sur ce point, je renvoie aussi à G. Cometti, Lorsque le brouillard a cessé de nous écouter. Changement climatique et migrations chez les Q’eros des Andes péruviennes, Peter Lang, 2015.
[21] M. Horkheimer et T. W. Adorno, Dialektik der Aufklärung (trad. fr : Dialectique de la raison), Fischer, 1969, p. 43.
[22] M. Safouan, Le Transfert et le Désir de l’analyste, Paris, Seuil, 1988.
[23] S. Freud, Psychologie des masses et analyse du moi.
[24] L’avenir d’une illusion.
[25] Ce dans Trois essais sur la théorie sexuelle, trad. Ph. Koeppel, Paris, Gallimard, 1987, p. 127.
[26] Sur cette question, voir D. Lorrain, « Apports de la psychanalyse créative », https://dimitrilorrain.org/2022/07/22/apports-de-la-psychanalyse-creative-texte-paru-dans-lettre-de-la-fedepsy-n10-juillet-2022/.
[27] Sur cette question de la transmission, je me permets de renvoyer à « Avec Delphine Horvilleur: sur l’interprétation, une lecture de « Le rabbin et le psychanalyste » (Hermann, 2020) », https://dimitrilorrain.org/2020/12/04/avec-delphine-horvilleur-sur-linterpretation-une-lecture-de-le-rabbin-et-le-psychanalyste-hermann-2020/
[28] Le Méridien : « Geh mit der Kunst in deine allereigenste Enge. Und setze dich frei ».
[29] D.W Winnicott, Lettres vives, Paris, Gamillard, p. 69.
[30] Je renvoie ici, pour une critique de leur maître, à : S.Leclaire Rompre les charmes, Paris, Inter Éditions, 1981 ; L. Israël, Boîter n’est pas pécher; ou M. Safouan, La Psychanalyse. Science, thérapie — et cause, Vincennes, Thierry Marchaisse, 2013. Une autre critique fort ouvrante de ce versant problématique de la pratique, la pensée et l’enseignement de Lacan, est celle de Patrick Guyomard, La jouissance tragique, Paris, Aubier, 1992.
[31] Sur ce point, je renvoie à « Dynamique de parole créatrice et création du lien de parole désirant », https://dimitrilorrain.org/2023/04/09/texte-dynamique-de-parole-creatrice-et-creation-du-lien-de-parole-desirant.
[32] Sur l’ambiguïté des Lumières, voir Th. Adorno et M. Horkheimer, Dialectique de la raison. Sur les Lumières alors que nous prenons la mesure du grand partage, voir C. Pelluchon, Les Lumières à l’âge du vivant.
[33] « Dostoïevski et le parricide », dans Résultats, idées, problèmes II, Paris, PUF, 1995, p. 162.
[34] Voir particulièrement R. Gori, La Fabrique des imposteurs.
[35] Lacan J. Lacan, Le Séminaire, Livre XIX, Ou pire, 1971-1972, 15.12.71, éd. Valas, p. 27.
[36] I. Kant, « Qu’est-ce que les Lumières », in Vers la paix perpétuelle. Que signifie s’orienter dans la pensée ? Qu’est-ce que les Lumières ? , trad. J-F. Poirier et F. Proust, Flammarion, 1991.
[37]Boiter n’est pas pécher, p 83.
[38] Idem., p 83
[39] Idem., p. 101.
[40] Pour ma part, je fais référence au texte allemand « Erziehung und Mündigkeit » dans le recueil de textes Erziehung und Mündigkeit Frankfurt, Suhrkamp, 1971, p. 133-147.
[41] Je renvoie à « Dynamique de parole créatrice et création du lien de parole désirant », https://dimitrilorrain.org/2023/04/09/texte-dynamique-de-parole-creatrice-et-creation-du-lien-de-parole-desirant.
[42] Je renvoie à « Dynamique de parole créatrice et création du lien de parole désirant », https://dimitrilorrain.org/2023/04/09/texte-dynamique-de-parole-creatrice-et-creation-du-lien-de-parole-desirant.
[43] Benjamin Lévy, L’ère de la revendication, Paris, Flammarion, 2020.
[44] Pour prendre en compte les nouvelles configurations familiales.
[45] « Erziehung zur Mündigeit », op. cit., p. 140.
[46] « Parataxis », op. cit., p. 477-478.
[47] Voir son texte Renverse du souffle.
[48] J’évoquerai surtout le grand livre de Winnicott : Jeu et réalité.
[49] Winnicott développe cette réflexion dans « Concepts actuels du développement de l’adolescent », in Jeu et réalité, Paris, Gallimard, 1975 et « L’immaturité de l’adolescent », in Conversations ordinaires (Home is where we start from), Paris, Galllimard, 1988. Bref, même s’il a malheureusement été problématiquement critique du féminisme (par ex. dans ce même livre), Winnicott nous donne à penser.
[50] Sur ce lien de parole désirant, je renvoie à « Dynamique de parole créatrice et création du lien de parole désirant », https://dimitrilorrain.org/2023/04/09/texte-dynamique-de-parole-creatrice-et-creation-du-lien-de-parole-desirant.
[51] C. Lefort, L’invention démocratique.
Chères amies, chers amis,
Je relaie ici la sublime interprétation par Jakub Józef Orliński de l’air « Vedrò con mio diletto », issu de l’opéra d’Antonio Vivaldi « Il Giustino ». Accompagnement : Alphonse Cemin (piano). Enregistrement en direct d’Aix-en-Provence dans le cadre de l’émission spéciale de Carrefour de L’Odéon, le 8 juillet 2017, sur France Musique.
Ici, les paroles, bouleversantes, en italien et en français, où il est question de plaisir et de joie, d’amour et d’absence :
Vedrò con mio diletto
L’alma dell’alma mia, dell’alma mia
Il core del mio cor
Pien di contento, pien di contento
Vedrò con mio diletto
L’alma dell’alma mia, dell’alma mia
Il cor di questo cor
Pien di contento, pien di contento
E se dal caro oggetto
Lungi convien che sia, convien che sia
Sospirerò penando
Ogni momento
Vedrò con mio diletto
L’alma dell’alma mia, dell’alma mia
Il core del mio cor
Pien di contento, pien di contento
Vedrò con mio diletto
L’alma dell’alma mia, dell’alma mia
Il cor di questo cor
Pien di contento, pien di contento
.
Je verrai avec mon plaisir
L’âme de mon âme, de mon âme
Le cœur de mon cœur
Plein de contentement, plein de contentement
Je verrai avec mon plaisir
L’âme de mon âme, de mon âme
Le cœur de ce cœur
Plein de contentement, plein de contentement
Et si du cher objet
Il faut qu’il soit loin, il faut qu’il soit
Je soupirerai de douleur
A chaque instant
Je verrai avec mon plaisir
L’âme de mon âme, de mon âme
Le cœur de mon cœur
Plein de contentement, plein de contentement
Je verrai avec mon plaisir
L’âme de mon âme, de mon âme
Le cœur de ce cœur
Plein de contentement, plein de contentement
.
Merci à Dominique Marinelli pour la relecture de la traduction. Je conclus ce texte par une pensée pour mon ami Jorge Reitter, avec qui j’ai la joie d’échanger largement sur la musique, entre tant d’autres choses.
Chères amies, chers amis,
Pour celles et ceux qui comprennent l’anglais, je vous mets ici le lien vers la passionnante intervention de Patricia Gherovici et Manya Steinkoler sur le récent livre collectif qu’elle ont dirigé : Psychoanalysis, Gender and Sexualities: From Feminism to Trans* (Routlegde, novembre 2022). Cette intervention, menée dans le cadre du podcast de Vanessa Sinclair Rendering uncounscious, que je vous conseille très vivement, vous présente l’ouvrage en détails.
RU231: PATRICIA GHEROVICI & MANYA STEINKOLER ON PSYCHOANALYSIS, GENDER & SEXUALITIES
Elaborant particulièrement les apports féministes et trans, mais aussi ceux des études de genre, ou encore des pensées queer, cet ouvrage collectif est un livre majeur. Il ouvre entre autres à une psychanalyse freudo-lacanienne ouverte, car relisant Freud et Lacan de manière novatrice, mais aussi, lorsque cela est nécessaire, critique. La préface de Patricia Gherovici et de Manya Steinkoler propose une réflexion particulièrement éclairante sur la situation contemporaine de la subjectivité et de la psychanalyse.
.
Présentation de l’éditeur
Transcending the sex and gender dichotomy, rethinking sexual difference, transgenerational trauma, the decolonization of gender, non-Western identity politics, trans*/feminist debates, embodiment, and queer trans* psychoanalysis, these specially commissioned essays renew our understanding of conventionally held notions of sexual difference.
Looking at the intersections between psychoanalysis, feminism, and transgender discourses, these essays think beyond the normative, bi-gender, Oedipal, and phallic premises of classical psychoanalysis while offering new perspectives on gender, sexuality, and sexual difference. From Freud to Lacan, Kristeva, and Laplanche, from misogyny to the #MeToo movement, this collection brings a timely corrective that historicizes our moment and opens up creative debate.
Written for professionals, scholars, and students alike, this book will also appeal to psychoanalysts, psychologists, and anyone in the fields of literature, film and media studies, gender studies, cultural studies, and social work who wishes to grapple with the theoretical challenges posed by gender, identity, sexual embodiment, and gender politics.
Transcending the sex and gender dichotomy, rethinking sexual difference, transgenerational trauma, the decolonization of gender, non-Western identity politics, trans*/feminist debates, embodiment, and queer trans* psychoanalysis, these specially commissioned essays renew our understanding of conventionally held notions of sexual difference.
Looking at the intersections between psychoanalysis, feminism, and transgender discourses, these essays think beyond the normative, bi-gender, Oedipal, and phallic premises of classical psychoanalysis while offering new perspectives on gender, sexuality, and sexual difference. From Freud to Lacan, Kristeva, and Laplanche, from misogyny to the #MeToo movement, this collection brings a timely corrective that historicizes our moment and opens up creative debate.
Written for professionals, scholars, and students alike, this book will also appeal to psychoanalysts, psychologists, and anyone in the fields of literature, film and media studies, gender studies, cultural studies, and social work who wishes to grapple with the theoretical challenges posed by gender, identity, sexual embodiment, and gender politics.
.
Table des matières
Introduction
Part 1: The Genealogy of Sex and Gender
1. ‘Freud’s Ménage à quatre’
Tim Dean
2. ‘Glôssa and « Counter-Will »: The Perverse Tongue of Psychoanalysis’
Elissa Marder
3. ‘The Gender Question from Freud to Lacan’
Darian Leader
4. ‘Two Analysts Ask, « What is Genitality? Ferenczi’s Thalassa and Lacan’s Lamella »‘
Jamieson Webster and Marcus Coelen
5. ‘Undoing the Interpellation of Gender and the Ideologies of Sex’
Genevieve Morel
Part 2: Queering Psychoanalysis: Fantasy, Anthropology and Libidinal Economy
6. ‘The Role of Phantasy in Representations and Practices of Homosexuality: Colm Tóibín’s The Blackwater Lightship and Edmund White’s Our Young Man‘
Eve Watson
7. ‘Oscar Wilde: Father and Som‘
Ray O’Neill
8. ‘Does the Anthropology of Kinship Talk about Sex?’
Monique David-Ménard
9. ‘From Fundamentalism to Forgiveness: Sex/Gender Beyond Determinism or Volunteerism’
Kelly Oliver
10. ‘Sexual (In)difference in Late Capitalism: « Freeing Us from Sex »‘
Juliet Flower MacCannell
Part 3: Being and Becoming TRANS-*
11. ‘Tiresias and the Other Sexual Difference: Jacques Lacan and Bracha L. Ettinger’
Sheila L. Cavanagh
12. ‘In-Difference: Feminisim and Transgender in the Field of Fantasy’
Oren Gozlan
13. ‘Translation, Geschlecht and Thinking Across: On the Theory of Trans-‘
Ranjana Khanna
14. ‘Scenes of Self-Conduct in Contemporary Iran: Transnational Subjectivities Knitted On Site’
Dina Al-Kassim
15. ‘Lacanistas in the Stalls: Urinary Segregation, Transgendered Abjection, and the Queerly Ambulant Dead’
Calvin Thomas
16. Dany Nobus, ‘Becoming Being: Chance, Choice and the Troubles of Trans*cursivity’
Dany Nobus
17. ‘Just Kidding: Valeria Solana’s SCUM and Andrea Long Chu’s Females‘
Elena Comay del Junco
18. ‘Transgender Quarrels and the Unspeakable Whiteness of Psychoanalysis’
Yannik Thiem
.
Patricia Gherovici et Manya Steinkoler ont déjà publié ensemble Lacan On Madness: Madness Yes You Can’t ( Routledge, 2015) et Lacan, Psychoanalysis and Comedy (Cambridge University Press, 2016).
.
Patricia Gherovici est psychanalyste, elle exerce à Philadelphie et à New York. Elle a obtenu en 2020 le Sigourney Award pour son travail clinique et théorique à propos de la question du genre et de la communauté latino aux Etats-Unis.
Elle a est la co-fondatrice et la directrice du Philadelphia Lacan Group et de l’Associate Faculty, Psychoanalytic Studies Minor, University of Pennsylvania (PSYS).
Elle est membre honoraire de l’IPTAR, l’Institute for Psychoanalytic Training and Research à New York.
Elle participe aussi aux travaux de l’institution de Formation Pulsion : https://pulsioninstitute.com/
Elle est encore membre fondatrice de l’institut de Das Unbehagen qui associe autour de la psychanalyse des cliniciens, des universitaires, des artistes et des intellectuels.
A noter encore: sa passionnante intervention (en anglais) sur le futur de la psychanalyse (avec le Covid, la mondialisation des échanges psychanalytique grâce à Internet…), sur le site de Vanessa Sinclair (New York), dans le cadre du podcast « Rendering unconscious »:
RU212: PATRICIA GHEROVICI – IS THERE A FUTURE FOR PSYCHOANALYSIS?
D’ailleurs, je vous conseille très vivement ce podcast: http://www.renderingunconscious.org/
Ici le site (en anglais) de Patricia Gherovici : https://www.patriciagherovici.com/
Et le site passionnant (en anglais), que je vous conseille (beaucoup de vidéos, de textes etc.) de Das Unbehagen : http://dasunbehagen.org/
Parmi ses livres, l’on trouve son livre de référence sur la question trans : « Transgenre. Lacan et la différence des sexes (Stilus, 2021). Voir : https://dimitrilorrain.org/2023/01/14/video-patricia-gherovici-transgenre-lacan-et-la-difference-des-sexes-stilus-2021/
Et puis son absolument passionnant « Lacan dans le ghetto. Psychanalyser le « syndrome porto-ricain », qui a reçu le Gradiva Award et le Boyer Prize. Mais aussi Please Select Your Gender: From the Invention of Hysteria to the Democratizing of Transgenderism (Routledge, 2010).
Elle a aussi publié avec Chris Christian, Psychoanalysis in the Barrios: Race, Class, and the Unconscious (Routledge, 2019, vainqueur du Gradiva Award et du American Board and Academy of Psychoanalysis Book Prize).
.
Manya Steinkoler est psychanalyste à New York et professeur de littérature, cinéma et théorie psychanalytique d’orientation lacanienne, Borough of Manhattan community college, City university of New York (CUNY).
Elle a aussi dirigé, avec Vanessa Sinclair, le livre collectif On Psychoanalysis and Violence: Contemporary Lacanian Perspectives (Routledge, 2018).
En français, elle a publié différents articles, et a participé à l’ouvrage collectif dirigé par J.-J. Moscovitz (auquel a participé entre autres Benjamin Lévy) Violence en cours, Erès, 2017.
Chères amies, chers amis,
Je vous mets ici le lien vers la passionnante intervention de Patricia Gherovici à la librairie Le Divan (Paris), le 12 octobre 2021. Elle y dialogue, entre autres, avec Luis Izcovich et Patrick Landman, à propos de son très important ouvrage « Transgenre. Lacan et la différence des sexes (Stilus, 2021) :
En effet, le livre majeur de Patricia Gherovici ouvre à une avancée fondamentale dans la réflexion psychanalytique contemporaine, en ce qui concerne la clinique des sujets trans, mais aussi plus généralement concernant ce que la prise en compte des subjectivités trans permet d’ouvrir en psychanalyse et dans la pensée et dans la société contemporaines.
Pour cela, la réflexion de l’autrice retraverse Freud et Lacan autrement. Cela ouvre une nouvelle lecture de leurs œuvres, mais aussi à une psychanalyse – et à une psychanalyse freudo-lacanienne (1) – prenant pleinement en compte la diversité sexuelle et la diversité des cheminements de genre, mais aussi la féconde démocratisation qui a lieu dans les jeunes générations, avec ce qu’elle apporte de fécond pour la subjectivation (2).
Présentation de l’éditeur (3)
Ce livre porte sur un sujet d’actualité, celui de l’identité sexuelle. Relève-t-elle de l’anatomie, de la culture, du discours ? Quelle est la part du choix du sujet par rapport à l’identité assignée ?
Il s’agit, dans cet ouvrage en français, de la version augmentée du livre Transgender Psychoanalysis, paru en 2017 aux États-Unis. Au moment où l’on assiste à des bouleversements de société concernant le sexe et les transformations du corps, ce livre constitue une contribution fondamentale au débat sur la norme sexuelle.
Il prend appui sur des questions qui traversent la société américaine et il aborde, à partir des récits cliniques, la place de la psychanalyse avec des patients dits « trans ».
Traduit de l’anglais par Marie-Mathilde Bortolotti-Burdeau.
Patricia Gherovici est psychanalyste, elle exerce à Philadelphie et à New York. Elle a obtenu en 2020 le Sigourney Award pour son travail clinique et théorique à propos de la question du genre et de la communauté latino aux Etats-Unis.
Elle a est la co-fondatrice et la directrice du Philadelphia Lacan Group et de l’Associate Faculty, Psychoanalytic Studies Minor, University of Pennsylvania (PSYS).
Elle est membre honoraire de l’IPTAR, l’Institute for Psychoanalytic Training and Research à New York.
Elle participe aussi aux travaux de l’institution de Formation Pulsion : https://pulsioninstitute.com/
Elle est encore membre fondatrice de l’institut de Das Unbehagen qui associe autour de la psychanalyse des cliniciens, des universitaires, des artistes et des intellectuels.
A noter encore: sa passionnante intervention (en anglais) sur le futur de la psychanalyse (avec le Covid, la mondialisation des échanges psychanalytique grâce à Internet…), sur le site de Vanessa Sinclair (New York), dans le cadre du podcast « Rendering unconscious »:
RU212: PATRICIA GHEROVICI – IS THERE A FUTURE FOR PSYCHOANALYSIS?
D’ailleurs, je vous conseille très vivement ce podcast: http://www.renderingunconscious.org/
Ici le site (en anglais) de Patricia Gherovici : https://www.patriciagherovici.com/
Et le site passionnant (en anglais), que je vous conseille (beaucoup de vidéos, de textes etc.) de Das Unbehagen : http://dasunbehagen.org/
Parmi ses autres livres, l’on trouve son absolument passionnant « Lacan dans le ghetto. Psychanalyser le « syndrome porto-ricain », qui a reçu le Gradiva Award et le Boyer Prize. Mais aussi Please Select Your Gender: From the Invention of Hysteria to the Democratizing of Transgenderism (Routledge, 2010).
Elle a aussi publié différents ouvrages collectifs : avec Manya Steinkoler, Lacan On Madness: Madness Yes You Can’t ( Routledge, 2015) et Lacan, Psychoanalysis and Comedy (Cambridge University Press, 2016); avec Chris Christian, Psychoanalysis in the Barrios: Race, Class, and the Unconscious (Routledge, 2019, vainqueur du Gradiva Award et du American Board and Academy of Psychoanalysis Book Prize.
Particulièrement : à noter la sortie d’un nouveau passionnant livre collectif qu’elle a dirigé avec Manya Steinkoler : Psychoanalysis, Gender and Sexualities: From Feminism to Trans* (Routlegde, novembre 2022) :
NOTES :
(1) : Pour un telle psychanalyse freudo-lacanienne ouverte, voir: Benjamin Lévy, L’ère de la revendication, Flammarion, 2022 ( https://dimitrilorrain.org/2022/01/18/a-noter-la-sortiede-louvrage-de-benjamin-levy-lere-de-la-revendication-flammarion-janvier-2022/); Dimitri Lorrain, « Apports de la psychanalyse créative », in Lettre de la FEDEPSY n°10, juillet 2022 (https://dimitrilorrain.org/2022/07/22/apports-de-la-psychanalyse-creative-texte-paru-dans-lettre-de-la-fedepsy-n10-juillet-2022/; André Michels, « De la pulsion comme subversion du genre », in Laurence Croix et Gérard Pommier (dir.), Pour un regard neuf de la psychanalyse sur le genre et les parentalités, Erès, 2018.; Stéphane Muths, « ’’Un garçon dans un corps de fille’’, identités de genre et effraction pubertaire », in Thierry Goguel d’Allondans et Jonathan Nicolas (dir.), Choisir son genre ?, op.cit., p. 99-120; Jonathan Nicolas, « A l’ombre des jeunes gens en fleurs, une esquisse des identités adolescentes », in Thierry Goguel d’Allondans et Jonathan Nicolas (dir.), Choisir son genre ?, op.cit., à. 169-180; Jorge N. Reitter, Heteronormativity and Psychoanalysis, Routledge, 2023: https://dimitrilorrain.org/2023/01/13/sortie-de-heteronormativity-and-psychoanalysis-de-jorge-n-reitter-routledge-2023/; Frédérique Riedlin, « Sur un air de famille(s). À partir d’une question de Judith Butler. La parenté est-elle toujours déjà hétérosexuelle ? », in Laurence Croix et Gérard Pommier (dir.), Pour un regard neuf de la psychanalyse sur le genre et les parentalités, Toulouse, Erès, 2018. Voir encore notre réflexion collective au séminaire « Freud à son époque et aujourd’hui » (FEDEPSY): https://dimitrilorrain.org/seminaire-freud-a-son-epoque-et-aujourdhui/
(2) : Voir Benjamin Lévy, L’ère de la revendication, op. cit.
Chères amies, chers amis,
Pour celles et ceux d’entre vous qui lisent l’anglais, je vous informe ici de la sortie du très important ouvrage de mon ami Jorge Reitter, « Heteronormativity and psychoanalysis » (1), avec une belle préface de Patricia Gherovici.
*
Dans ce livre nourri en profondeur de l’expérience de la cure, et écrit de manière fort vivante, Jorge Reitter nous éclaire sur ce qu’il appelle l’« expérience gay » envisagée dans sa spécificité, et sur la psychanalyse depuis cette expérience.
Sa réflexion élabore, de manière rigoureusement psychanalytique, les apports de la pensée de Michel Foucault, mais aussi des études féministes, queer, lesbiennes et gaies. Elle nous éclaire sur la manière dont le discours collectif hétéronormatif et binaire oriente les pratiques et les théories psychanalytiques vers une norme désubjectivante. Et en quoi cela amène à une scotomisation ou à un rejet de la subjectivité des sujets gays, et à leur normalisation s’opposant à leur subjectivation.
Aussi ce livre nous permet-il d’appréhender la position du sujet gay dans ce que Jorge Reitter appelle – en élaborant Foucault – le « dispositif de l’hétéronormativité », c’est-à-dire le dispositif de pouvoir, portant sur la sexualité, que déploie le discours collectif hétéronormatif et binaire. Un point important est d’ailleurs que ce discours collectif voit dans l’hétérosexualité la seule forme de sexualité légitime, et donc rejette la diversité sexuelle.
De plus, nous pouvons noter que l’auteur ne parle pas de l’hétérosexualité comme en soi normative ; ce que j’élabore ainsi : c’est la forme binaire (désubjectivée) de l’hétérosexualité qui est normative, mais une autre hétérosexualité (subjectivée) existe bien, même si minoritaire, à l’écart de l’hétéronormativité.
Ainsi, plus généralement, ce livre nous aide à appréhender les ressorts et l’histoire de l’hétéronormativité et de la binarité pour chaque sujet, qu’il soit LGBT+ ou hétéro.
Pour cela, Jorge Reitter relit Freud et Lacan en détails, en essayant de « ne pas jeter le bébé avec l’eau du bain ». Il rappelle que Freud nous a révélé la contingence de l’objet sexuel. Ce qui fait que – comme le disait Freud lui-même – l’homosexualité ne peut être considérée comme « pathologique ». Bref, il n’existe pas de norme sexuelle, et il s’agit d’essayer d’en tirer toutes les conséquences.
Cela permet à Jorge Reitter, en s’appuyant sur toute une bibliographie souvent encore à découvrir en France, d’éclairer ce qui dans les œuvres de Freud et de Lacan pose de manière géniale les problèmes fondamentaux de la subjectivité et de la psychanalyse, mais aussi ce qui participe de l’hétéronormativité et de la binarité.
En ce sens, le complexe d’Oedipe, montre l’auteur, vaut aussi bien pour les sujets non hétérosexuels. Plus largement, le complexe d’Oedipe est relié dans le livre à la « tâche », pour le sujet, « de devenir indépendant de l’autorité (du désir) des parents » (2).
Plus encore, Jorge Reitter nous propose une formulation fort élaborative, quand il établit que le sujet gay reconnaît la différence des sexes – envisagée au plus près de la clinique, et de manière non hétéronormative ni binaire (3). Juste, ajoute-t-il, le sujet gay se positionne autrement par rapport à celle-ci que le sujet hétérosexuel.
Bref, ce livre nous permet donc d’envisager les problèmes classiques de la psychanalyse (comme ceux du complexe d’Oedipe ou du complexe de castration, ou encore celui de la différence des sexes, mais aussi celui du symbolique) sous un nouveau jour, pleinement ouvert à la diversité sexuelle et dégagé de la gangue hétéronomative et binaire.
Et, en suivant les réflexions de Jorge Reitter, nous pouvons reprendre à notre compte de manière créative – et non normative – l’interrogation fondamentale de Freud sur le rôle central de la sexualité dans la subjectivité, et dans l’enfance du sujet : sur la sexualité en ce qu’elle est fondamentalement hors-norme – queer diront certains.
Cela ouvre au fait de solidement prendre en compte – avec Lacan – le donné fondamental consistant dans le fait que, pour citer Jorge Reitter, « être dépendant de l’Autre et être très marqué par son désir est une condition nécessaire » (4) à la subjectivation. Car, dirais-je, ce sont, dans un premier temps, cette dépendance à l’Autre (à l’Autre du langage, mais aussi à l’Autre qui a donné au sujet le langage) et cette marque du désir (liée à cette dépendance à l’Autre), qui permettront au sujet, dans un deuxième temps, de devenir indépendant de l’autorité, du désir, des parents.
Dans la cure, cela nécessite le fait que la parole du sujet déploie ce qu’il en est du signifiant, mais aussi que « l’attention de l’écoute analytique (soit) portée sur la structure du signifiant » (5).
D’ailleurs, dans son insistance de l’émancipation du sujet par rapport aux autorités, Jorge Reitter rejoint à mon sens l’insistance de Serge Leclaire, dans son débat avec Lacan, sur le fait que le désir de l’Autre gagne, dans la cure, à prendre une forme « un peu déliée » (6). En d’autres termes, il gagne à prendre une forme pleinement créative, dégagée de toute volonté directive (7). On le voit, chez Jorge Reitter comme chez Leclaire, c’est là une lecture de Lacan – et de son éclairage sur la créativité du signifiant – qui s’émancipe de Lacan, lorsque cela est nécessaire.
Aussi, au regard des vifs et fort compréhensibles débats contemporains à son propos (8), le complexe d’Oedipe (comme son pendant le complexe de castration) n’apparaît-il pas comme quelque chose d’en soi normalisateur, même si son élaboration a pu, chez Freud et après lui, prendre une forme hétéronormative et binaire.
Par là même, ce livre fort important nous propose une articulation très subtile, et au plus près de l’expérience psychanalytique, entre psychanalyse et politique. Car nous trouvons ici une réflexion très opérationnelle sur la question du pouvoir – en lien au langage. En effet, de manière très concrète, pour Jorge Reitter, il s’agit dans la cure d’ « être attentif à la place que le sujet a dans le discours qui le nomme, et qui le situe dans des relations de pouvoir » (9).
Cela nous permet aussi de nous rappeler ce que dit Lacan, en passant par les Lumières, de la relation de la psychanalyse au pouvoir : « Et dans (…) mes Écrits, vous le voyez (…) j’invoque les Lumières. Il est tout à fait clair que les Lumières ont mis un certain temps à s’élucider. (…). Contrairement à tout ce qu’on en a pu dire, les Lumières avaient pour but d’énoncer un savoir qui ne fût hommage à aucun pouvoir » (10).
En somme, cet ouvrage constitue un apport fondamental sur tout un ensemble de questions cruciales. Il en va là de la mise en place d’une psychanalyse – et d’une psychanalyse freudo-lacanienne (11) – ouverte à la fois à la diversité sexuelle, à la diversité des cheminements de genre, mais aussi à la féconde démocratisation qui a lieu dans les jeunes générations, avec ce qu’elle apporte de fécond pour la subjectivation (12). Cette psychanalyse ouverte se positionnant de manière psychanalytique contre les discriminations. Ici, l’enjeu est aussi que cette psychanalyse ouverte soit aussi capable de soutenir solidement la subjectivation des sujets, en utilisant pour cela les apports cliniquement fondamentaux, et toujours actuels (pour peu qu’on les réinterprète de manière créative comme le fait l’auteur), de Freud et de Lacan.
Et je finirai sur ce point : Jorge Reitter insiste sur le fait que la psychanalyse qui se positionne contre les discriminations, c’est aussi la psychanalyse qui se positionne contre elles dans les institutions psychanalytiques. Ce alors que l’institution psychanalytique a mis tant de temps à dépathologiser l’homosexualité. D’ailleurs, l’institution psychanalytique, en cela, a bien été contre la volonté de Freud qui, il s’agit de le rappeler, était favorable au fait que des gays ou des lesbiennes deviennent analystes. C’est bien ce que montre le fait qu’il a longtemps collaboré avec Hirschfeld, ce sexologue et militant historiquement important pour la reconnaissance des droits LGBT (13).
*
Présentation de l’ouvrage par l’éditeur
Heteronormativity and Psychoanalysis proposes a critical reading of the Freudian and Lacanian texts that paved the way for a heteronormative bias in the theory and practice of psychoanalysis.
Jorge N. Reitter’s theoretical-political project engages in a genealogy of how psychoanalysis approached the ‘gay question’ through time. This book determinedly seeks to dismantle the heteronormative bias in the theories of psychoanalysis that resist new discourses on gender and sexuality. Drawing on developments by Michel Foucault and lesbian and gay studies on queer theory and feminist theorizing, Reitter draws attention to the normalizing devices that permanently regulate sexuality neglected by psychoanalysis as producers of subjectivities.
Accessibly written, Heteronormativity and Psychoanalysis will be key reading for psychoanalysts in practice and in training, as well as academics and students of psychoanalytic studies, gender studies, and sexualities.
Table des matières
Prologue by Patricia Gherovici
Prologue to the first edition
I. Heteronormativity and psychoanalysis
1) Oedipus gay
2) The original entanglement. How psychoanalysis could not escape the heteronorm
3) Oedipus reloaded
4) Towards a post-heteronormative Oedipus
II. Miscellanea
5) On the political incorrectness of eroticism
6) Rethinking the possible as such
7) Felix Julius Boehm
III. Bonus tracks
8) Talking with Jorge Reitter : neither the Other nor sexuality exists outside of power relations
Epilogue
Jorge N. Reitter est psychanalyste d’orientation lacanienne, il vit et exerce à Buenos Aires (Argentine).
Il enseigne à l’Université de la République, Uruguay. Il a enseigné à la Faculté de Psychologie de l’Université de Buenos Aires et à l’Université Nationale Autonome de Zacatecas (Mexique).
Pour une présentation de l’ouvrage (en espagnol), sur la passionnante et fort subtile Chaîne Youtube Asociación Libre (en espagnol), portant sur la psychanalyse, avec Matias Tavil, voir :
Jorge N. Reitter intervient aussi régulièrement sur Asociación Libre, animée par Matias Tavil, et que je vous conseille vivement si vous comprenez l’espagnol :
https://www.youtube.com/channel/UCn-ca92YLNQjj_GSE4zxvag
NOTES :
(1) : La page Internet du livre: https://www.routledge.com/Heteronormativity-and-Psychoanalysis-Oedipus-Gay/Reitter/p/book/9781032171845#
(2) : Heteronormativity and Psychoanalysis, p. 53.
(3) : Pour une clinique et une théorie ni hétéronormative ni binaire de la différence de sexes, voir P. Gherovici, Transgenre, Lacan et la différence des sexes, Stilus, 2021. Voir aussi Serge Hefez, Transitions, Calmann-Lévy, 2020.
(4) : Heteronormativity and Psychoanalysis, p. 60.
(5) : Heteronormativity and Psychoanalysis, p. 31.
(6) Serge Leclaire, Rompre les charmes, Inter Éditions, 1981, p. 167.
(7) : De ce point de vue, en ce qui concerne l’histoire de la psychanalyse en France, l’apport de Lacan, pour génial et mettant en crise le caractère massivement directif de l’enseignement de Freud (voir Moustapha Safouan, Le Transfert et le Désir de l’analyste, Seuil, 1988), n’a pas été sans réintroduire une certaine directivité. Leclaire, comme d’autres de ses élèves (Perrier La Chaussée d’Antin : Œuvre psychanalytique I., Paris, Albin Michel, 2008 et La Chaussée d’Antin II. : Œuvre psychanalytique II., Albin Michel, 2008), Lucien Israël (Boiter n’est pas pécher, Arcanes/Erès, 2010)…), proposent de mettre en crise de l’intérieur de l’apport lacanien le reste de directivité qui habite l’enseignement de Lacan.
(8) : Plus en détails, Jorge Reitter débat avec son ami Fabrice Bourlez sur cette question du complexe d’Œdipe. Dans son fort intéressant ouvrage Queer psychanalyse (Hermann, 2018), Fabrice Bourlez propose en effet une psychanalyse post-oedipienne, nourrie en premier lieu de Deleuze et de Guattari (L’Anti-Œdipe, Paris, 1972).
(9) : Heteronormativity and Psychoanalysis, p. 15.
(10) : J. Lacan, Le Séminaire, Livre XIX, Ou pire, 1971-1972, 15.12.71, éd. Valas, p. 27.
(11) : Pour un telle psychanalyse freudo-lacanienne ouverte, voir: Benjamin Lévy, L’ère de la revendication, Flammarion, 2022 ( https://dimitrilorrain.org/2022/01/18/a-noter-la-sortiede-louvrage-de-benjamin-levy-lere-de-la-revendication-flammarion-janvier-2022/); Dimitri Lorrain, « Apports de la psychanalyse créative », in Lettre de la FEDEPSY n°10, juillet 2022 (https://dimitrilorrain.org/2022/07/22/apports-de-la-psychanalyse-creative-texte-paru-dans-lettre-de-la-fedepsy-n10-juillet-2022/; André Michels, « De la pulsion comme subversion du genre », in Laurence Croix et Gérard Pommier (dir.), Pour un regard neuf de la psychanalyse sur le genre et les parentalités, Erès, 2018.; Stéphane Muths, « ’’Un garçon dans un corps de fille’’, identités de genre et effraction pubertaire », in Thierry Goguel d’Allondans et Jonathan Nicolas (dir.), Choisir son genre ?, op.cit., p. 99-120; Jonathan Nicolas, « A l’ombre des jeunes gens en fleurs, une esquisse des identités adolescentes », in Thierry Goguel d’Allondans et Jonathan Nicolas (dir.), Choisir son genre ?, op.cit., à. 169-180; Frédérique Riedlin, « Sur un air de famille(s). À partir d’une question de Judith Butler. La parenté est-elle toujours déjà hétérosexuelle ? », in Laurence Croix et Gérard Pommier (dir.), Pour un regard neuf de la psychanalyse sur le genre et les parentalités, Toulouse, Erès, 2018. Voir notre réflexion collective au séminaire « Freud à son époque et aujourd’hui » (FEDEPSY): https://dimitrilorrain.org/seminaire-freud-a-son-epoque-et-aujourdhui/
(12): Pour cette démocratisation, voir Benjamin Lévy, op. cit.
(13) : Sur Hirschfeld et la proximité de Freud avec lui, voir P. Gherovici, Transgenre, Lacan et la différence des sexes, Stilus, 2021, p. 82-91.
Au regard de l’évolution contemporaine des discours et des mécanismes psychiques, j’aimerais ici insister sur un point qui me semble particulièrement important. Tout un ensemble de discours collectifs avancent de nos jours que la psychanalyse sous sa forme actuelle serait « dépassée » – souvent pour justifier sa minoration institutionnelle. Or cela ne me semble pas juste.
En effet, s’il s’avère que la psychanalyse a pu souvent être dénaturée et devenir dogmatique, et ainsi renier sa créativité fondamentale, cela n’est heureusement pas toujours le cas. Elle existe aussi de nos jours sous une forme rigoureuse et créative (ce qui est la même chose). Dans ce cas-là, je dirais qu’elle se centre sur la création d’un lien de parole qui ouvre à la création du lien psychanalytique en tant que tel[1]. Bien sûr, la psychanalyse ne se réduit pas à ce lien de parole, que je définis plus loin comme désirant, même si c’est là selon moi une dimension importante, pour faire advenir et se déployer le processus psychanalytique.
Sous cette forme, la psychanalyse élabore sur les critiques qui lui sont adressées. De plus, elle remet au travail ses apports, afin de prendre en compte les subjectivités contemporaines.
Dès lors, la psychanalyse a une très grande efficacité subjectivante, comme nous le constatons en pratique. C’est le cas pour peu que le processus psychanalytique se mette en place, du fait d’un positionnement fécond du psychanalyste, dans le sens de la création du lien de parole et du lien psychanalytique. Bref, la psychanalyse en soi n’est pas « dépassée », et il s’agit de mieux la faire connaître sous sa forme véritable, créative. C’est en ce sens que je voudrais ici insister sur ses apports.
Dans ce cadre, la minoration institutionnelle actuelle de la psychanalyse acquiert à mon sens la signification suivante. Il s’agit, dans ces institutions, d’empêcher le lien de parole nécessaire au sujet, ne pas laisser exister la parole, et particulièrement pas le lien de parole ni la parole sous leurs formes psychanalytiques. Ce afin que la psychanalyse ne risque pas de sortir les sujets et les institutions de leurs routines, ni d’un ennuyeux confort. Ce confort étant lié à une logique d’adaptation et de sécurité, et au déploiement désubjectivant de la compulsion de répétition, qui vont de pair. Bref, la psychanalyse est institutionnellement souvent mise de côté pour ne pas qu’elle risque d’apporter du nouveau au niveau du lien de parole, et dès lors ni subjectivement ni collectivement[2]. Voilà à mon sens la principale raison de la minoration institutionnelle actuelle de la psychanalyse. Ce même si, en même temps, la forme dénaturée, dogmatique, qu’elle peut parfois prendre, la dessert. Cela, bien sûr, il nous faut aussi le constater.
Sur le fond, nous avons ici affaire au malaise dans la culture – tel que Freud l’a problématisé dans son ouvrage du même nom –, et au malaise dans la culture sous sa forme contemporaine. Bref, nous avons affaire aux forces subjectives et collectives allant contre la subjectivation et contre le lien de parole et la parole en général. Ce malaise dans la culture, la psychanalyse permet de l’appréhender de manière tragique.
Il reste qu’au regard de ce que nous dit la tradition philosophique, ce rejet de la parole et du lien de parole, que nous constatons aujourd’hui, n’a rien de nouveau. Déjà, Levinas, en 1961, dans Totalité et Infini, posait les questions vertigineuses de l’« antilangage » et de la dystopie d’un « monde absolument silencieux ». En effet, considérant que « le monde est offert dans le langage d’autrui » – et donc dans le lien de parole avec l’autre –, Levinas repérait déjà dans nos sociétés une tendance vers le déploiement de l’« antilangage », du « monde absolument silencieux ». Ici, dit-il, « l’interlocuteur a donné un signe, mais s’est dérobé à toute interprétation »[3] – et à tout lien de parole.
Et j’aimerais en ce point insister sur le rejet du geste d’interprétation, alors que l’interprétation introduit du subjectif, du singulier, puisque le sujet s’y autorise de sa propre lecture, de sa propre parole, et du lien de parole, marqué par la séparation – par la perte –, qu’il a avec l’autre[4].
Ici, nous dit encore Levinas, dans ce monde absolument silencieux, règne le « pur spectacle », la « pure objectivité », qui en son fond est un rire « ricanant », et qui relève du sarcasme et non de l’humour, un « rire qui cherche à détruire le langage »[5]. En termes psychanalytiques : ici se déchaîne le surmoi en ce qu’il enjoint le sujet à se taire, à ne déployer ni parole ni lien de parole[6].
Plus encore, dans une autre problématisation que celle de Levinas, Foucault, en 1970, avançait que, derrière la prolifération apparente des discours de surface, « il y a sans doute dans notre société (…) une profonde logophobie, une sorte de crainte sourde contre ces événements, contre cette masse de choses dites, contre le surgissement de tous ces énoncés, contre tout ce qu’il peut y avoir là de violent, de discontinu, de batailleur, de désordre aussi et de périlleux, contre ce grand bourdonnement incessant et désordonné du discours »[7]. Le coup de génie de Foucault[8] étant de montrer que cette logophobie trouve largement sa source dans les institutions, dans la manière dont les institutions en Occident sont historiquement, le plus souvent, construites et envisagées.
Ainsi, ces deux grands philosophes, de deux manières tout à fait différentes, ont repéré dans l’histoire de nos sociétés occidentales le rejet de la parole, que Foucault a situé au niveau institutionnel et collectif. Et nous pouvons constater de nos jours le fait que cette logophobie, et le rejet du lien de parole qui va de pair, se déploient de manière encore plus extensive qu’à leur époque, particulièrement dans ce que l’on appelle le champ du soin psychique.
Rien d’antimoderne dans mon propos. A mon sens, dans l’histoire de l’Occident, la logophobie est plus ou moins dominante suivant les époques, cela fluctue. L’œuvre de Foucault – même si je ne le suivrais pas sur tout, particulièrement concernant la psychanalyse – aide à appréhender sa logique et à en faire l’histoire[9]. Plus encore, c’est à mon sens en bonne partie la logique institutionnelle dominante dans nombre d’institutions contemporaines, liée aux relations de pouvoir, qui déploie cette logophobie, qui réprime la parole et le lien de parole. De plus, cette logique institutionnelle logophobe, existante à l’époque de Levinas et de Foucault – mais aussi de Lacan –, s’est bien depuis étendue, pour s’étendre à nombre de champs qui lui échappaient[10].
Ainsi, l’accélération de nos rythmes d’existence[11], liée à cette logique institutionnelle, arrive dorénavant souvent (pas toujours heureusement, car il existe des institutions où la parole peut exister et se déployer) à imposer une accélération de notre relation au langage, un court-circuitage de la parole, et ainsi à empêcher toute durée – tout après-coup – permettant la parole et le lien de parole.
Et face à cette logophobie et face à ce défaut de lien de parole[12], lorsque, dans la cure, le psychanalyste pose un lien de parole et qu’il donne la parole au patient, il arrive régulièrement (pas toujours bien sûr) que la parole surgisse, spontanément, et que, dans la cure, pour peu que le psychanalyste se positionne créativement en ce sens, il soit possible d’en faire une demande et une parole au sens psychanalytique.
Mais quelles sont les caractéristiques du lien de parole que gagne à poser le psychanalyste, afin de créer le lien analytique ? Eh bien, je dirais que ce peut être un lien de parole désirant, car marqué par la perte, mais aussi par le nouage désirant entre le réel, le symbolique et l’imaginaire. En somme, le désir de désir – et le désir de parole – du psychanalyste pose et propose un lien de parole désirant qui en appelle au désir et à la parole du patient, et au fait que la parole du patient soit désirante – et donc en premier lieu marquée par l’écart entre le manifeste et le latent.
Dans ce lien de parole désirant, l’écoute du psychanalyste ouvre au déploiement du désir, du latent, dans la parole du patient, ou bien, si nécessaire, à la naissance du désir, du latent, dans celle-ci. Elle ouvre à une singularisation de la parole et à une richesse symbolique, poétique, de celle-ci, ainsi qu’au nouage (ou à l’articulation sinthomale) entre le réel, le symbolique et l’imaginaire.
Ici, dans ce lien de parole désirant que (pro)pose le psychanalyste, l’écoute de celui-ci ouvre, du côté du patient, au déploiement d’une demande – la demande allant toujours dialectiquement avec le désir. Elle ouvre au fait que la parole du patient déploie une demande au sens psychanalytique, fondatrice du processus de la cure.
Plus encore, le phénomène contemporain du défaut et du rejet de lien de parole dans les institutions, je crois que c’est quelque chose que beaucoup de nos contemporains appréhendent. Avec la dite « crise du Covid », s’est en effet à mon sens révélé au grand jour le fait que les institutions contemporaines rejettent la parole et le lien de parole. Et cela est maintenant allé si loin en ce sens que, par contrecoup, les demandes de parole, de lien de parole, affluent. En effet, culturellement, il faut à mon sens noter qu’une bonne partie de nos contemporains refusent la logophobie, refusent le défaut de lien de parole. J’en veux pour preuve les éléments suivants. Avant tout, les demandes aux « psys », et particulièrement aux psychanalystes, affluent. L’intérêt en France pour la série « En Thérapie », malgré ses imperfections, témoigne aussi de cela. Plus encore, nombre de revendications contemporaines sous leurs formes ouvertes et démocratiques[13], particulièrement les revendications féministes ou liées au mouvement LGBTQIA+, sont aussi le plus souvent liées (comme elles le disent d’ailleurs elles-mêmes très régulièrement) à un refus du défaut et du rejet de la parole et du lien de parole dominant dans les institutions.
Mais, pour en revenir plus généralement aux nouvelles formes de mécanismes psychiques et de discours, il me semble que, parmi les différents facteurs contemporains expliquant ces formes nouvelles de mécanismes psychiques et de discours, pèsent à mon sens particulièrement deux éléments : le fait que le lien de parole est très souvent (pas toujours heureusement) empêché dans les institutions, parce que la logophobie y règne ; mais aussi l’appréhension par nombre de nos contemporains concernant ce défaut de lien de parole et cette logophobie. C’est un point important à relever cliniquement, il me semble, pour nous positionner dans le bon sens. Car si nous partons de cela, nous pouvons il me semble alors appréhender le fait que, si le psychanalyste se positionne dans le sens de la création d’un lien de parole désirant (qui est donc à mon sens régulièrement – et donc pas toujours – souhaité par les patients en quête d’un lien de parole), eh bien les choses peuvent s’ouvrir, et même qu’elles s’ouvrent assez régulièrement, dans le sens de la création du lien psychanalytique. Ainsi, telle que je l’envisage, la psychanalyse, pour tragique, relève d’un optimisme tragique, malgré tout.
Pour ma part, je vois dans les nouvelles formes de discours et de mécanismes psychiques, une nouvelle forme de demande[14], et même une nouvelle forme de possibilité de demande. À mon sens, cela implique, du côté du psychanalyste, une forme renouvelée de l’écoute psychanalytique[15], positionnée dans le sens de la création du lien de parole désirant et de la création du lien analytique.
C’est en ce sens que, comme le pointe le titre de ce texte, j’ai voulu ici insister sur les apports de la psychanalyse créative telle que je la conçois. J’ai ainsi voulu insister sur le fait que, sous sa forme créative, le psychanalyste peut travailler dans le sens de l’émergence, en une rencontre fondatrice[16], du lien de parole désirant entre le psychanalysant et le psychanalyste, et donc sur la création du lien psychanalytique. Alors, comme l’expérience de la cure permet de le constater et de l’éclairer, la psychanalyse a une grande efficacité subjectivante[17].
[1] Ce que j’élabore ici se situe dans l’apport de Lacan et de sa relecture créative. Sur la création du lien psychanalytique, voir particulièrement Lucien Israël, Boîter n’est pas pécher, Arcanes/érès, 2010 ; Jean-Richard Freymann, La naissance du désir, Arcanes/érès, 2005.
[2] Sur ce point, ce que dit Israël (op. cit.) n’a pas pris une ride.
[3] E. Levinas, Totalité et infini, essai sur l’extériorité, Livre de poche, 1991 (1961), p. 90-94.
[4] Sur l’interprétation, je me permets de renvoyer à ma réflexion intitulée « Sur l’interprétation. Une lecture de « Le rabbin et le psychanalyste » de Delphine Horvilleur. https://dimitrilorrain.org/2020/12/04/avec-delphine-horvilleur-sur-linterpretation-une-lecture-de-le-rabbin-et-le-psychanalyste-hermann-2020/
[5] E. Levinas, op. cit., p. 90-94.
[6] Tel que le psychanalyste Didier-Weill, d’ailleurs en lecteur de Levinas, le montre. Voir A. Didier-Weill, Les Trois temps de la loi, Seuil, 1995.
[7] M. Foucault, L’ordre du discours, Gallimard, 1971, p. 92-93. La leçon a été prononcée en 1970.
[8] De ce Foucault-ci, qui n’est pas le Foucault plus tardif. Ce dernier insiste plutôt sur la manière dont ce qu’il appelle le « pouvoir » fait parler. Autant de problématisations fécondes, d’hypothèses de travail différentes et donnant à élaborer la complexité des choses.
[9] C’est une longue histoire que le rejet du langage et de la parole : pour d’autres éléments concernant cette histoire, voir aussi l’admirable ouvrage du linguiste allemand J. Trabant, Humboldt ou le sens du langage, Mardaga, 1992. J’ai eu la chance de collaborer avec lui lorsque j’ai été Visiting Fellow à l’Université Humboldt de Berlin en 2011-2012.
[10] Sur l’institution contemporaine, voir les réflexions de R. Gori, par exemple La Fabrique des imposteurs, Les liens qui libèrent, 2013.
[11] Be. Stiegler, Dans la disruption, Les liens qui libèrent, 2016 ; H. Rosa, Accélération, La Découverte, 2010.
[12] Sur cette question du lien de parole et du défaut de lien de parole, j’élabore aussi sur la réflexion de Winnicott. Winnicott parle pour sa part de « déprivation » concernant ce que j’appelle le défaut de lien de parole. Voir par exemple Jeu et réalité, Gallimard, 2002.
[13] Il existe aussi des revendications contemporaines prenant une forme fermante, avec ses excès problématiques – ce qui à mon sens d’ailleurs sans doute reconduit une forme de logophobie. Sur cette question des revendications contemporaines, dans leur apport démocratique et leur complexité, voir Benjamin Lévy, L’ère de la revendication, Flammarion, 2022.
[14] J’élabore ici sur les récentes réflexions d’André Michels. Ainsi lors de la soirée de l’ASSERC « De la clinique psychanalytique à venir. Comment la concevoir ? », Strasbourg, le 25.2.22.
[15] Toujours comme nous y invite André Michels.
[16] Sur cette rencontre fondatrice, Lucien Israël a des pages fort éclairantes lorsqu’il parle de la « rencontre symbolique », dans Boiter n’est pas pécher, op. cit.
[17] La question est alors de savoir comment l’on peut penser plus en détails ce lien de parole désirant, et comment l’on peut envisager la création du lien de parole désirant, et donc du lien psychanalytique. C’est de cette question dont je traiterai, comme de notre situation discursive et psychique contemporaine, dans deux textes à venir, l’un dans la Lettre de la FEDEPSY, et l’autre sur le site de la FEDEPSY.
Chères amies, chers amis,
Ici la passionnante séance du 15.6..22 du séminaire « Freud, Lacan et nous. Les incidences du contemporain dans les processus de subjectivation », de l’association Psychanalyse actuelle, animé par J.-J. Moscovitz et Benjamin Lévy. Elle est consacrée au très important ouvrage de ce dernier, « L’ère de la revendication » (Flammarion, 2022). J’ai eu le plaisir de participer aux échanges.
Voici la présentation du livre sur le site de l’éditeur:
« Le ressentiment, l’indignation, la colère, la défiance et l’anxiété sont désormais omniprésents dans l’espace public, mais certaines voix s’élèvent pour réclamer le droit à un avenir meilleur. Se mettre à l’écoute des revendications collectives, aussi hétérogènes qu’elles puissent sembler ( féministes, antiracistes, écologistes, etc.), c’est devenir sensible à des trajectoires de vie, à des désirs singuliers qui incitent des femmes et des hommes à se montrer inventifs pour transformer la société.
D’un autre côté, la frustration prend parfois un chemin mortifère, s’inscrivant dans une dynamique paranoïaque, une radicalisation des pensées. Comment la revendication reste-t-elle porteuse d’avenir, et en vertu de quels mécanismes risque-t-elle au contraire de se retrouver du côté de la haine, de la destructivité ou même du meurtre ? J’ai voulu dans ce livre découvrir moins “si” que “comment” revendiquer peut être un bien en démocratie.
J’invite le lecteur à un voyage sur des eaux tumultueuses : des Gilets jaunes aux antivax, du mouvement #MeToo à Black Lives Matter en passant par les revendications LGBTQIA+, ce livre offre des outils pour mieux comprendre les débats contemporains. »
B. L.
A propos de ce livre:
Benjamin Lévy est psychanalyste, psychologue, philosophe, enseignant, ancien élève de l’ENS. Il a publié de nombreux articles, ainsi que plusieurs traductions d’ouvrages aux éditions Ithaque – dont par exemple la correspondance Freud-Federn (Cartes postales, notes & lettres de Sigmund Freud à Paul Federn, 1905-1938, Paris, Ithaque, 2018), autour de laquelle j’avais organisé une rencontre à la Librairie des Bateliers, Strasbourg, le 15.6.2019, pour un échange avec Jean-Raymond Milley.
Il publie aussi régulièrement des textes sur le blog (1).
Il anime avec Jean-Jacques Moscovitz le séminaire « Freud Lacan et Nous. Les incidences du contemporain dans les processus de subjectivation », de l’association Psychanalyse actuelle, hébergé dans les locaux de l’Ecole Normale Supérieure (2) .
Voici le lien vers son blog: https://benjaminlevy.wordpress.com/
NOTES:
(1): https://dimitrilorrain.org/category/textes-de-benjamin-levy/
(2): https://sites.google.com/site/psychanalyseactuel/seminaire-de-psychanalyse-actuelle?authuser=0
Ici un texte publié dans Ephéméride n° 11, Journal de la FEDEPSY, novembre 2020: https://fedepsy.org/category/ephemeride/
Ce texte a été rédigé à partir d’une intervention au séminaire FEDEPSY du 6.10.20, « Freud à son époque et aujourd’hui »
(Remarque de décembre 2022: je garde ce texte sur le blog, même s’il ne me semble pas assez insister sur le poids de la culture binaire dans le discours collectif de l’époque, et sur ses conséquences désubjectivantes, en 1er lieu pour les femmes et les sujets non hétérosexuels, mais aussi plus généralement.
Ceci sera une question importante pour notre réflexion au séminaire « Freud à son époque et aujourd’hui » en 2023: https://dimitrilorrain.org/seminaire-freud-a-son-epoque-et-aujourdhui/).
*****
J’aimerais vous parler du Monde d’hier de Stefan Zweig, plus précisément de trois chapitres de cet ouvrage : la « Préface », « Le monde de la sécurité » et « Universitas vitae ». Je me concentrerai donc sur le début de cet ouvrage. Pour travailler sur le contexte culturel de l’œuvre de Freud et sur le geste de Freud dans ce contexte, Le Monde d’hier est à ma connaissance une excellente présentation. Mon propos prendra la forme d’une sorte de zigzag entre des réflexions psychanalytiques, culturelles, mais aussi sur la littérature.
**
Avant d’en venir au Monde d’hier pour penser la Vienne de Freud et le geste de Freud, j’aimerais faire quelques remarques pour poser certains éléments nécessaires.
Premièrement, il s’avère que, si je ne parle que du début de cet ouvrage, ce livre mérite d’être lu en entier. En effet, il élabore aussi – littérairement – ce qu’il en est de l’advenue à l’échelle historique du réel au sens lacanien, de la mort et de la destructivité pulsionnelle, et même de la mort et de la destructivité collective de masse. Bref, il en va là du malaise dans la culture – dont le point culminant, innommable, est la Shoah[1]. Voilà qui permet de réfléchir au contexte du 2e temps de l’œuvre de Freud et de son geste.
Deuxièmement, concernant le contexte culturel de l’œuvre de Freud, je tiens à préciser que nous disposons bien sûr de nombreux travaux de psychanalystes, dont des psychanalystes de notre École de Strasbourg – évoquons Lucien Israël, Marcel Ritter, Jean-Marie Jadin, Jean-Richard Freymann[2]. De plus, nous disposons aussi des travaux de tout un ensemble d’historiens, de Schorske à Elisabeth Roudinesco, en passant par Jacques Le Rider et Peter Gay, ou encore Eli Zaretsky[3], pour ne citer que quelques noms. Et, bien sûr, en vous parlant, j’élabore leurs travaux.
Troisièmement, je vous propose de parler du contexte culturel de Freud dans l’optique d’une histoire psychanalytique de la culture, celle que je développe pour mes réflexions ailleurs sur Warburg[4] et sur Hamlet[5], et ici sur Zweig. Cette histoire psychanalytique de la culture, je l’envisage fondamentalement une histoire des discours[6], collectifs comme subjectifs. Cela me permettra d’essayer de vous présenter en quoi Freud a fondé le discours analytique en le dégageant des discours ambiants de son époque, mais aussi en élaborant des éléments féconds dans son contexte culturel, de manière radicalement ouvrante, pour fonder cette novation radicale qu’est la psychanalyse.
D’un point de vue psychanalytique, la réflexion sur le contexte culturel ne doit pas nous écarter de la question de l’inconscient, mais elle doit nous aider à parler prioritairement de l’inconscient, comme de la clinique psychanalytique. En somme, c’est pour envisager la complexité de la subjectivité, de la parole et de la psychanalyse que je m’intéresse ici à la question de la culture. En ce sens, je partirai de l’éthique de la psychanalyse telle que l’a éclairée Lacan. Celle-ci soutient la singularisation du discours du sujet par rapport au discours ambiant[7]. Et pour cela, je me baserai sur un approfondissement des apports de notre École de Strasbourg, comme du freudo-lacanisme le plus fécond.
Dans ce cadre comme ailleurs, le double héritage sur lequel se fonde notre École de Strasbourg a beaucoup à nous dire. En effet, ce double héritage s’appuie, pour parler des fondateurs, d’un côté, sur le souci de la clinique et de la créativité chers à Lucien Israël, et, de l’autre, la fidélité à l’apport de Lacan (que l’on trouve aussi chez Lucien Israël bien sûr) et l’étude systématique des textes chers à Moustapha Safouan.
Quatrièmement, au regard du contexte contemporain, je pense que le pas de côté relevant d’une histoire psychanalytique de la culture ouvre à une historicisation de nos interrogations et des discours contemporains. Cette historicisation n’est pas sans intérêt pour nous qui vivons dans une société où le présentisme règne le plus souvent[8].
Cette historicisation nous permet aussi de réfléchir à la manière dont nous pouvons donner à entendre, dans ce contexte contemporain, la psychanalyse, c’est-à-dire son apport et sa créativité, sa portée clinique et culturelle, mais aussi son soutien à la singularisation du sujet et de son discours propre par rapport au discours de son environnement.
Cinquièmement, il s’agira pour moi d’insister sur 4 axes : la portée actuelle du geste et de l’œuvre de Freud ; le contexte culturel et le geste de Freud dans ce contexte ; la clinique analytique, qui est en fait première ; et le texte de Freud et donc sa théorie, son vocabulaire, envisagé aussi en allemand. Quatre mots donc, pour être synthétique, et si je remets les choses dans l’ordre : clinique, théorie, actualité, contexte culturel.
Sixièmement, c’est en ce sens que j’aimerais essayer d’ouvrir de nouvelles voies, de nouvelles pistes avec Freud. Ce pour m’adresser au « profane », comme y insiste systématiquement Freud, face aux discours dominants contemporains qui se situent du côté du rejet du désir
C’est d’ailleurs ce que Freud a fait : ouvrir une nouvelle voie en fondant un dispositif et une technique, mais aussi une forme spécifique de science, appelés psychanalyse. Véritable exploit culturel si l’on considère l’histoire pour ce qu’elle est : quelque chose de tragique, de conflictuel, de dynamique et d’ouvert, et non comme un plat résultat à contempler a posteriori, de manière tout aussi plate. Et c’est dans cette histoire que j’aimerais pour ma part situer Freud et son geste, avec ce que cela implique en termes de prise en compte du contexte culturel de l’époque. En ce sens, je vous propose de nous intéresser à la manière dont Freud a inventé le discours psychanalytique en le dégageant des discours collectifs de l’époque.
**
J’en viens maintenant à Stefan Zweig. Quelques mots de présentation. Stefan Zweig est un écrivain juif viennois, né en 1881, vingt-cinq ans après Freud. Il appartient donc à la génération suivante, marquée par l’œuvre de Freud. Essayiste, romancier, il est l’une des figures intellectuelles et littéraires fondamentale du monde d’hier, de la Vienne et de l’Europe d’avant le nazisme. Son œuvre profonde, multiple, largement nourrie de celle de Freud, est toujours extrêmement lue.
Issu d’une grande famille de la bourgeoisie juive viennoise, Zweig est un représentant de l’humanisme cosmopolite, ce discours collectif important à l’époque – et j’aimerais dans ma réflexion positionner Freud dans la tectonique des discours collectifs de son époque. Zweig est un compagnon de route de la psychanalyse, un défenseur de celle-ci dans le débat public, un ami de Freud qui admire son œuvre et avec lequel il dialogue en profondeur, par exemple dans leur correspondance, où ils parlent bien sûr beaucoup de psychanalyse et de littérature, entre autres. Zweig a écrit divers textes sur Freud et sur la psychanalyse – dont il serait intéressant de parler à l’occasion, aussi pour en pointer les importantes limites. J’aimerais aussi noter ici que Zweig a présenté à Freud Romain Rolland et Salvador Dali. Le portrait de Freud qu’il fait à la fin du Monde d’hier est saisissant.
Avec la montée du nazisme, Zweig s’exile et s’installe au Brésil. En 1942, Zweig s’y suicide de désespoir.
**
Le Monde d’hier, que l’on présente souvent comme les Mémoires de Zweig, est en fait un portrait de la Vienne et de l’Europe jusqu’en 1939. C’est pour cela que le sous-titre de l’ouvrage est : « Souvenirs d’un Européen ». Ce livre, Zweig l’écrit au Brésil entre 1939 et 1941. C’est dans l’immédiat après-coup de la destruction de la Vienne et de l’Europe d’avant le nazisme que Zweig écrit les Mémoires de la Vienne de Freud et de cette Europe. Le livre paraît en 1943, un an après sa mort.
J’aimerais faire quelques remarques sur l’écriture et sur la réflexion de Zweig dans cet ouvrage, pour dire quelques mots de l’écoute psychanalytique de la parole littéraire, mais aussi pour insister sur ce qui fait, selon moi, la parole psychanalytique, telle que Freud l’a fondée.
Pour pénétrante, l’analyse de Zweig n’est pas sans être régulièrement marquée par d’importantes idéalisations. Par exemple, en ce qui concerne la monarchie habsbourgeoise régnant sur l’Autriche-Hongrie[9], ou en ce qui concerne la minimisation de la crise économique de 1873. Concernant la dictature brésilienne alors qu’il était installé là-bas, ou concernant la manière de lutter contre le nazisme, et concernant le caractère absolument destructeur du nazisme, Zweig n’a pas non plus été lucide. Sur l’Horreur du nazisme, c’est son ami l’écrivain viennois Joseph Roth qui l’aidera à ouvrir les yeux dans les années 1930[10]. Plus encore, Zweig refuse longtemps, jusqu’au milieu des années 30, d’engager sa parole politiquement, ce qui est critiquable dans une situation politique aussi tragique. Mais à partir de la moitié des années 30, il s’engage enfin pour défendre les Juifs et les enfants juifs, tout en refusant toujours de critiquer publiquement l’Allemagne nazie[11]. Il reste que cette réticence à s’engager, pour problématique, n’est pas une marque d’indifférence, mais qu’elle le déchire[12] – en termes analytiques, peut-être peut-on y voir quelque obsessionnalité.
Ces idéalisations et cette réticence à s’engager sont aussi liées au discours collectif, important à l’époque, de l’humanisme cosmopolite. Cet humanisme cosmopolite, Zweig en critique d’ailleurs lui-même les limites, dans Le Monde d’hier comme déjà dans son très bel essai de 1934 sur l’humaniste renaissant Erasme.
Il reste que j’aimerais tout de même relever que Zweig a eu le mérite de toujours militer, même aux heures les plus sombres, pour une union européenne transnationale.
De plus, indépendamment des accointances subjectives que l’on peut avoir ou non avec les choix esthétiques de Zweig comme écrivain, la position analytique me semble demander d’écouter dynamiquement cette idéalisation et ces limites dans la parole littéraire de Zweig. Ce d’autant plus que cette dernière est malgré tout restée ouverte, et que les limites de Zweig n’ont pas impliqué, à la différence d’autres intellectuels, des engagements politiques problématiques au regard de l’Histoire. Et puis le psychanalyste, dans l’écoute de la parole littéraire ou en séance, a lui aussi nécessairement, comme tout sujet, ses illusions – son fantasme. C’est pour cela que la parole psychanalytique, avant tout, relève d’un travail d’énonciation, d’écoute et de dialectisation des illusions – du fantasme – comme y insiste Lacan qui a parlé de nécessaire « naïveté » du psychanalyste[13]. D’ailleurs, Lacan a ajouté à cela que la résistance, dans la psychanalyse, c’est avant tout celle du psychanalyste. Voici ce qu’il dit en effet sur ce point : « Il n’y a qu’une seule résistance, c’est la résistance de l’analyste[14]. » Bref, comme nous le rappelle Lacan, la psychanalyse n’a donc rien à voir, malgré bien des déviations dans la pratique, avec la croyance en la possibilité d’une position de surplomb (de Savoir), qui dégagerait le sujet (-psychanalyste) de toute illusion, et lui donnerait la possibilité de considérer, depuis cette position de surplomb (de Savoir), les illusions et les idéalisations de l’autre[15].
En ce sens, le geste fondateur de Freud (en premier lieu dans L’Interprétation du rêve) fut justement, il le dit lui-même, de « partager » ses « rêves » autant que de les « interpréter ». Il s’est agi pour lui de témoigner de ses illusions, de son fantasme – et partant de la conflictualité inhérente à la subjectivité – autant que de les traverser et de se retourner dessus. C’est d’ailleurs en cela, dit-il, que consiste le « surmontement » ou « surmontement de soi », « (Selbst)überwindung », analytique. J’aimerais ici citer Freud. Dans L’Interprétation du rêve, dans le chapitre sur les affects dans le rêve, voici ce que dit Freud, plutôt littéralement :
« On ne peut pas se cacher le fait qu’un difficile surmontement de soi fait partie du fait d’interpréter et de partager ses rêves » (« Man kann sich’s nicht verbergen, daß schwere Selbstüberwindung dazu gehört, seine Träume zu deuten und mitzuteilen[16] »).
On pourra aussi citer par exemple la manière dont Freud témoigne, dans le chapitre sur la méthode de l’interprétation du rêve, de l’exigence éthique de la psychanalyse : « avoir à surmonter (…) des difficultés » dans le travail « d’interprétation du rêve » (« j’ai à surmonter des difficultés », « Schwierigkeiten (…) habe ich zu überwinden »). Et Freud de citer en français Delboeuf (philosophe et psychologue belge de la 2e moitié du XIXe siècle, qui a travaillé sur l’hypnose), dont il transpose la réflexion au champ psychanalytique : « tout psychologue est obligé de faire l’aveu même de ses faiblesses s’il croit par là jeter du jour sur quelque problème obscur [17]. »
En somme, la réflexion de Freud relève de la psychanalyse originelle (Octave Mannoni parle d’« analyse originelle », ce qu’approfondit Chawki Azouri[18]) fondatrice de la psychanalyse. Le geste théorique de Freud est pour lui une manière de traverser ses propres évitements, son propre fantasme, sa propre résistance, ses propres failles, sa propre obsessionnalité. Il en va là de l’éthique de la psychanalyse, comme traversée, avant tout par le psychanalyste, du fantasme, comme traversée de sa propre résistance, ouvrant à un retournement dialectique sur le fantasme. Ce qui seul soutient le travail analytique du psychanalysant. Ainsi en est-il concernant Freud en premier lieu dans son texte de 1905 sur sa patiente Ida Bauer, qu’il dénomme « Dora[19] » (tel que Lacan l’éclaire et le met au travail[20]). Et ce, même si, dans le travail avec Ida Bauer, Freud expérimentera ses propres limites.
Ainsi, à mon sens, réentendre le geste de Freud dans sa fraîcheur, réentendre sa psychanalyse originelle, c’est partir de cette exigence éthique qu’a éclairée Lacan (et qu’il a éclairée, afin que la psychanalyse ouvre la parole du sujet à l’Autre barré, au champ de l’Autre[21], et afin de soutenir et déployer le pacte symbolique qui fonde sa parole[22]).
Et, de ce point de vue, Zweig est un contemporain de Freud qui, comme d’autres, a entendu le message de Freud dans sa fraîcheur, et nous permet de réentendre celui-ci en ce sens. Car la parole littéraire de Zweig est marquée par Freud en ce qu’elle témoigne d’une traversée des illusions subjectives, d’une dialectisation de la conflictualité subjective, et d’une ouverture au réel et au devenir. Cela fait qu’on ne peut qualifier Zweig d’auteur platement idéaliste. Pour illustrer mon propos, je tiens à citer, dans une traduction personnelle, un passage du chapitre « Le coucher du soleil » dans le Monde d’hier :
« Ne serait-il pas meilleur pour moi – ainsi continuait ma rêverie en moi – que quelque chose d’autre advienne, quelque chose de nouveau, quelque chose qui me rende plus intranquille (unruhiger), m’excite plus et me rende plus curieux (gespannter), me rajeunisse, en exigeant de moi un nouveau et peut-être encore plus dangereux combat ? »
Bref, il y a bien là, dans l’écriture de Zweig, une forme littéraire de traversée éthique par le sujet de ses propres illusions. Il y a là une forme littéraire, non analytique (plus classiquement narrative donc que divisée, bifurquante, éclatée – comme l’est la parole analytique) du « surmontement de soi », tel que Freud l’envisage et le pratique dans le champ analytique et sous forme analytique.
Concernant son cheminement littéraire, Zweig situe celui-ci dans ce cadre : comme geste pour dégager sa parole du « complexe de sécurité » qui fut celui du discours de sa société, de son père, de sa famille. En somme, Zweig cherche à dégager sa parole du complexe de son père – et de la société telle que l’a construite la génération de ses parents. Intéressante définition de la subjectivation, je trouve.
Sans doute faut-il ajouter à cela que Zweig a aussi déployé son propre « complexe de sécurité », sa propre matrice d’illusions narcissiques que traverse le travail d’écriture dont ce livre est le fruit. En somme, il y a dans ce livre un travail explicite, assumé comme tel, de traversée dialectique et interminable de ses propres illusions.
Car Zweig sait que la vérité est un mi-dire, ou tout du moins qu’elle est un dire partiel, ainsi que le lui a dit Freud : « il n’y a pas plus de vérité à 100% que d’alcool à 100%. »
En somme, malgré les limites de Zweig, limites qu’il essaie de traverser, d’appréhender et qui le déchirent, étudier Le Monde d’hier est pour nous une manière d’entrer dans le contexte culturel de l’œuvre et du geste de Freud, et des débuts de la psychanalyse. Zweig pense avec Freud et parle de Freud, de sa théorie de la culture, de son apport culturel. Mais il ne nous parle pas en tant que telle de la psychanalyse comme dispositif ni comme discours. Il reste que lire Zweig est malgré tout utile pour se pencher sur le monde de Freud dans ses différentes facettes afin de mieux appréhender le geste de Freud, la naissance et les débuts de la psychanalyse. Mais aussi, je tiens à insister sur ce point, cela nous est utile afin d’appréhender la psychanalyse en tant que dispositif de parole spécifique. Et le dispositif spécifique de la psychanalyse déploie et écoute les signifiants du psychanalysant, pour, dans le transfert, ou mieux, dans la transférisation[23], soutenir le déploiement puis la traversée de son fantasme, en un retournement dialectique. Ce qui importe, c’est bien la dynamique de la parole du sujet afin de faire se lever son désir, et l’éthique et la créativité qui lui sont inhérentes. Et il me faut aussi insister sur l’importance, pour la psychanalyse, de la question de la singularisation de la parole du sujet, et du dégagement du discours ambiant dans lequel il est plongé. Car c’est une question qui m’importe particulièrement en ce qui concerne l’histoire de la culture dont je parle ici, qui est fondamentalement une histoire des discours. Oui, cela m’importe particulièrement pour essayer de voir comment Freud a dégagé sa parole des discours collectifs de son environnement. Pour voir comment il a construit le discours psychanalytique par rapport aux discours collectifs (au pluriel) de son époque, justement comme dispositif de dégagement par le sujet de sa parole des discours de son environnement – de dégagement de l’Autre, nous dit Lacan[24]. Car, lorsque je dis cela, je me base bien sûr sur Lacan qui, en élaborant Freud, est allé plus loin que lui[25].
**
En fait, j’aimerais ici vous présenter une élaboration avec ce que nous dit Stefan Zweig, concernant Vienne et l’Europe de la fin du XIXe siècle jusqu’en 1914. Et cela engage la question de la culture.
Plus précisément, j’aimerais mettre au travail ce que nous dit Zweig dans le même esprit que certaines analyses de Freud dans L’Homme Moïse et le monothéisme – que Zweig évoque à la fin du Monde d’hier. En effet, je trouve qu’il y a certains échos entre le Moïse et le Monde d’hier, en ce qu’il s’agit dans les deux ouvrages, comme l’écrit Freud, d’étudier « les progrès culturels de l’humanité et les changements intervenus dans la structure des communautés humaines[26] ». Plus encore, il s’agit pour Zweig (et ici Zweig met au travail Freud), comme pour Freud en général – et pour Lacan bien sûr – d’étudier dans leur complexité et leurs ambiguïtés les progrès et les régressions culturels. J’aimerais ici insister à quel point ce sont là des questions classiques à l’époque, que l’on retrouve par exemple aussi chez Nietzsche (Zweig a écrit sur Nietzsche), ou chez l’historien de l’art et de la culture Warburg dont je vous ai parlé ailleurs.
Bref, les réflexions de Zweig – mettant au travail Freud – sur la culture, son histoire, sa complexité, son évolution, sont bien fécondes pour nous. C’est aussi le cas pour donner à entendre la portée culturelle de la psychanalyse, concernant l’histoire de la culture, mais aussi dans notre situation culturelle contemporaine.
D’ailleurs, pour en revenir au Moïse de Freud, Freud essaie d’étudier, concernant la figure de Moïse et son apport, le judaïsme, ce qu’il appelle une « époque de floraison culturelle[27] ». Et dans le Monde d’hier, Zweig étudie certes les régressions culturelles de l’Europe qui mèneront à l’Horreur. Mais il étudie aussi les progrès culturels, liés aux Lumières, qui ont eu lieu avant celles-ci, et contre lesquels le nazisme comme « révolution culturelle » a réagi[28]. Et ces progrès culturels ne se font pas sans trancher dans bien des résistances. De ce point de vue, dans son livre, malgré ses limites, Zweig arrive à rendre compte de la dynamique et de l’ambivalence, de la complexité et des conflictualités du monde de Freud. Il pose aussi des questions qui restent à mon sens toutes d’une grande actualité.
Plus encore, concernant les discours et les mécanismes collectifs, Zweig met au travail Freud et sa réflexion sur la subjectivité et sur la culture. Il parle longuement de la sexualité. Mais aussi, il le dit, Zweig a pleinement conscience que le sujet est le produit de sa culture, je dirais, du discours collectif. En même temps, Zweig analyse avec lucidité, je cite, la « dissociation », ce que l’on appelle le clivage de l’objet qui est omniprésent dans les discours collectifs. Zweig analyse aussi, comme il le dit, la cruauté de la société, des collectifs, contre ceux qui révèlent leurs secrets et leurs injustices.
En somme, mon hypothèse ici est que, ce à quoi Zweig nous aide particulièrement, c’est à appréhender ce qu’il en est, concernant le monde de Freud, des dynamiques et de l’évolution de la culture, des discours collectifs et des subjectivités. Voilà qui nous sera utile pour appréhender Freud dans son contexte culturel.
**
À mon sens, Zweig nous permet de voir en quoi la société viennoise européenne connut une profonde évolution. Dès lors, j’aimerais maintenant en venir aux quatre temps de l’évolution culturelle de la Vienne de Freud, telle que Zweig les développe. Pour le reformuler dans des termes qui cherchent à mettre au travail le propos de Zweig, je dirais :
1er temps : Qu’il existe tout d’abord dans la Vienne de Freud ce que je propose d’appeler la « société d’avant-hier » où domine, comme le dit Zweig, le discours collectif du la bourgeoisie libérale ;
2e temps : Qu’advient à partir de la fin du XIXe siècle ce que j’appelle la société d’hier proprement dite ; grâce au travail culturel des générations de Freud et de Zweig (des membres de ces générations qui vont en ce sens) a lieu une ouverture des discours collectifs et des subjectivités ;
3e temps : Qu’advient aussi à la fin du XIXe siècle la société de masse (que Freud a étudiée dans sa Psychologie des masses), avec le déploiement du nationalisme qui mènera à la Première Guerre mondiale et au nazisme ;
4e temps : Et puis, tragiquement, a lieu dans les années 30 le triomphe du nazisme et la destruction de la culture européenne de l’époque et de l’Europe et le meurtre de masse des Juifs d’Europe, telle que les constate tragiquement Zweig entre 1939 et 1942 – lui qui appréhende que quelque chose relevant de l’Horreur absolue est en train d’arriver aux Juifs.
**
Commençons donc par le 1er temps, par ce que j’appelle donc la société d’avant-hier, qui est la société dans laquelle sont nés Freud puis la psychanalyse. Jusqu’à la fin du XIXe siècle, à l’époque que Zweig appelle « préfreudienne » (car il fait de l’œuvre de Freud un vecteur de changement culturel majeur) dominait le discours collectif de la bourgeoisie libérale. Ce discours collectif, Zweig en présente la complexité – sauf sur un point important, nous le verrons. Bref, si parfois on trouve une connotation de nostalgie quand il parle de cette société d’avant-hier, il s’avère que Zweig mène une solide critique de cette société.
D’un côté, ce discours collectif de la société d’avant-hier est marqué par l’évolutionnisme culturel, et sa religion ou son mythe collectif du Progrès inéluctable – qui occulte le réel au sens lacanien du terme. C’est là une époque où, nous dit encore Zweig (qui pointe les signifiants importants dans le discours ambiant de la Vienne de Freud), la « sécurité » (du sujet bourgeois, de la classe sociale bourgeoise, y insiste Zweig en lecteur de Balzac auquel il a consacré un essai) est recherchée et sans cesse invoquée. Il y a là une foi évolutionniste dans le progrès, dans la technique et la science.
Il y a là encore, ajoute Zweig, un « délire optimiste », croyant en un progrès moral et culturel rapide et continu. Dans cette société d’avant-hier, le moralisme domine et rejette la sexualité et le corps, mais aussi la singularité du sujet, tout en étant foncièrement hostile à la jeunesse, aux femmes, aux homosexuels et à l’amour. Le système économique est inégalitaire, et le libéralisme fait selon Zweig l’erreur humaine et politique de ne pas prendre soin d’une bonne partie de la population et de les laisser dans la misère. Mais les relations économiques et sociales, à Vienne, vont quelque peu vers des compromis et vers quelques progrès sociaux, constate Zweig qui politiquement est plutôt proche des sociaux-démocrates.
À Vienne donc, à la classe bourgeoise, ce système économique prodigue un rythme de vie tempéré, bien loin, précise Zweig, de l’« accélération » du rythme de vie qui aura lieu avec l’advenue de la société de masse à la fin du XIXe siècle (sur l’accélération, je renvoie aux travaux d’Hartmut Rosa). Il n’existe pas encore, insiste Zweig, à Vienne, ni en Autriche, de société de masse comme déjà en Allemagne, en France ou en Angleterre. La Vienne de Freud et de Zweig, c’est la Cacanie de Musil, autre auteur viennois de l’époque, dans son grand roman – passionnant pour nous – L’homme sans qualités : un royaume à l’État et à l’économie qui apparaissent désuets au regard de l’hyperorganisation économique et étatique qui naît ailleurs dans les grandes nations européennes. Pour le dire dans mes termes, Zweig insiste largement sur le caractère non hyperorganisé de cette société, qui n’est pas encore une société de masse. Et c’est un élément que je trouve particulièrement fécond dans sa description du contexte culturel – pour saisir la différence d’avec notre société à nous, j’y reviendrai à l’avenir.
Dans cette société, l’école relève d’une logique patriarcale et cherchant à soumettre les élèves et à rejeter, dit-il, leur énergie, leur élan, leur sexualité, leur désir. Il y a là, précise Zweig, un « autoritarisme » scolaire où la parole est fondamentalement « verticale » – ce qui fait que la parole des élèves comme sujets est rejetée. Il y a dans la Vienne de Freud, dit Zweig, un véritable rejet de la jeunesse. Ce rejet n’est d’ailleurs pas aussi présent à Berlin à la même époque, constate-t-il. D’ailleurs, Zweig nous en parle ; Berlin (lieu important aussi pour l’histoire de la psychanalyse) sera aussi un lieu d’ouverture tout à fait formidable à l’époque – comme en témoigne d’ailleurs récemment le dernier ouvrage de l’historien de l’art et de la culture Horst Bredekamp sur Warburg et sur l’ethnologie berlinoise de l’époque[29]. Je tiens à évoquer les travaux passionnants de Horst Bredekamp (qui a aussi travaillé sur Freud et Lacan[30]) car le passage que j’ai dans le passé fait à Berlin, comme Visiting Fellow dans le département de l’Université Humboldt qu’il dirigeait, a compté pour la réflexion que je développe ici.
En somme, dans la société d’avant-hier, ce sont le réel, le tragique qui sont évacués – du fait du mythe collectif évolutionniste[31]. Dans ce discours collectif libéral, les forces destructives inhérentes à la subjectivité sont, dit Zweig évoquant explicitement Freud, « refoulées » – réprimées – « sous une légère couche ». Sur ce point, il est manifeste que Zweig élabore ce que Freud nous dit dans les « Considérations sur la guerre et la mort » écrites pendant la Première Guerre mondiale, ainsi dans ses réflexions sur la culture – en premier lieu « Le Malaise dans la culture » de 1929.
En même temps, ajoute Zweig, cette société d’avant-hier est complexe et ambivalente. En effet, cet optimisme culturel du monde libéral a en même temps selon lui quelque chose de fécond sur certains plans, malgré tout, avec la valorisation du travail culturel et de l’indépendance du sujet que l’on trouve dans le discours collectif. C’est d’ailleurs ce qui se déploie dans le cadre des milieux intellectuels et artistiques gravitant autour de la revue Die Neue Freie Presse, à l’orientation politique libérale. C’est cette revue, haut lieu des débats viennois et européens, lieu lui ouvert à la jeunesse, qui va lancer Zweig. Cette revue accueillera bien d’autres figures importantes de l’époque, comme par exemple, pour parler de littérature, Schnitzler, l’écrivain préféré de Freud, ou le poète Rilke, qui est aussi ami avec Freud.
En somme, Zweig trouve, dans l’après-coup de son existence emportée, comme le monde, dans la destruction nazie (et le nazisme est avant tout le résultat de la société de masse poussée à son extrême), que ce monde d’avant-hier avait tout de même le mérite de valoriser (pour les hommes bourgeois, certes, comme il le dit) un rythme existentiel tempéré. Cette société d’avant-hier viennoise avait aussi le mérite de valoriser une relation au passé marquée par une exigence de mémoire ; alors que la société de masse, avec son rythme existentiel accéléré, a tendance à laisser de côté la mémoire, la transmission, dit Zweig. Car la question de la transmission est centrale pour Zweig, j’en parlerai une autre fois. Et tout ceci n’est pas sans intérêt pour nous, qui vivons dans une société où le présentisme règne le plus souvent.
De plus, ajoute Zweig, le discours libéral de l’époque est problématique politiquement. Il néglige les problèmes sociaux posés par le capitalisme débridé de l’époque, ce qui favorise, dit Zweig, la montée du nationalisme allemand antisémite. Mais le discours libéral est aussi (et cela, Zweig n’en parle pas) très germanocentré et très légitimiste vis-à-vis de la monarchie habsbourgeoise. En effet, la réalité politique de cette monarchie ne correspond pas au discours officiel « supranational ». De cela donc, Zweig ne parle pas car il idéalise la monarchie habsbourgeoise. De plus, il aura toutes les difficultés à véritablement prendre en compte ce qu’il en est véritablement de la montée de l’antisémitisme – ce qui se retrouve dans son portrait ambigu du maire chrétien-démocrate et antisémite de Vienne, Lueger.
Car avec la crise économique de 1873, due à un krach financier, et avec l’advenue de tout un ensemble de scandales financiers, les libéraux vont être politiquement discrédités. Alors de nouveaux partis de masse vont commencer à jouer un rôle politique. Ainsi des chrétiens-démocrates antisémites de Lueger. Ainsi aussi des sociaux-démocrates et des socialistes. Ceci est important à noter car cette évolution changera de manière très substantielle la tectonique des discours collectifs dans la Vienne de Freud.
D’ailleurs, Freud et Zweig, dans leurs œuvres, prennent en compte la crise qu’ont connu à l’époque les Lumières et le libéralisme politique. Ils tirent même les conséquences de la crise du libéralisme politique, et des limites des Lumières rationalistes et du libéralisme du parti libéral. Cela permettra à Freud, il me semble, de proposer une forme plus lucide et plus aboutie des Lumières[32] – plus « sombre » comme y insiste Élisabeth Roudinesco.
En conclusion de ce texte, qui appelle une suite, j’aimerais évoquer rapidement la société d’hier telle que la caractérise Zweig, et qui succède à la société d’avant-hier des pères de la génération de Zweig. Alors advient une société nouvelle, avec de nouveaux discours collectifs. Pour en dire deux mots, cela constitue par bien des points une évolution culturelle féconde dans laquelle Freud et la psychanalyse jouent un rôle central, ainsi que tout un ensemble d’auteurs et d’artistes qui pour partie sont associés à Freud, et qui sont surtout les acteurs historiques et culturels de l’ouverture qui a lieu avec l’advenue de la société d’hier.
**
Concernant cette société d’hier, Zweig insiste sur le fait qu’a lieu à l’époque une ouverture des discours collectifs et des subjectivités à la prise en compte de tout un ensemble d’éléments fondamentaux – prise en compte générale, pas psychanalytique, mais à laquelle la psychanalyse dans sa portée culturelle a participé. Ainsi a lieu à l’époque, sur différents plans, une véritable ouverture des discours collectifs et des subjectivités à différentes choses fondamentales pour la psychanalyse : à la sexualité et à la jeunesse, dans une certaine mesure aux femmes et au féminin, dans une certaine mesure aussi à l’homosexualité (La Confusion des sentiments de Zweig témoignant de celle-ci) – en même temps que le chemin sera encore long pour une plus importante reconnaissance. D’ailleurs sur ce point, ce que dit Zweig va dans le sens de ce que montre Élisabeth Roudinesco dans son très passionnant livre La Famille en désordre[33], qui nous aide à historiciser ces questions.
Sur la question du féminin qui nous importe, je tiens aussi à préciser que notre École de Strasbourg, particulièrement avec Lucien Israël, a aussi posé en profondeur et de manière éclairante cette question, au point d’insister sur le le fait que la psychanalyse relève d’une féminisation[34]. Je vous en parlerai une autre fois.
Mais j’approfondirai dans un autre texte ma réflexion sur Zweig, dont cette question de la société d’hier, de la nouvelle société qui advient en partie grâce à Freud et à la psychanalyse, mais qui aussi favorise en même temps le développement de la psychanalyse à cette époque.
[1] Sur cette question, je renvoie à J.-J. Moscovitz, D’où viennent les parents ?
[2] Citons entre autres J.-P. Dreyfuss, J-M. Jadin, M. Ritter, Qu’est-ce que l’inconscient ? Toulouse, Arcanes-érès.
[3] Citons par ex., parmi tant d’autres titres, E. Roudinesco, Freud en son temps et dans le nôtre ; de J. Le Rider, concernant Freud, voir Freud, de l’Acropole au Sinaï ; concernant Zweig et plus largement, Modernité viennoise et crises de l’identité, ou Les Juifs viennois à la belle époque (1867-1914), ainsi que la récente édition de S. Zweig, L’esprit européen en exil, éd. J. Le Rider et Kl. Renoldner, Bartillat, 2020, trad. J. Le Rider ; de Peter Gay, Freud ; de C. Schorske, Vienne fin de Siècle ; d’E. Zaretsky, Le Siècle de Freud.
[4] Je me permets de renvoyer à mon intervention « Mythe et fantasme dans le cheminement intellectuel et psychanalytique d’Aby Warburg » au séminaire de Jean-Richard Freymann, FEDEPSY, « Fantasmes et mythes », année 2020, séance du 12 juin 2020 :
[5] Pour un projet d’ouvrage chez Arcanes-érès.
[6] Concernant la question de l’histoire culturelle des discours, l’œuvre de Michel Foucault est incontournable. Voir par ex. L’Archéologie du savoir.
[7] L. Israël, Boiter n’est pas pécher, Arcanes-érès, coll. « Hypothèses », 2010.
[8] Sur le présentisme comme régime d’historicité relevant d’un présent qui se veut auto-suffisant et délié du passé et de l’avenir, voir l’ouvrage de l’historien du monde grec F. Hartog, intitulé Régimes d’historicité. Présentisme et expériences du temps.
[9] C. Magris, Le Mythe et l’empire.
[10] Voir Correspondance 1927-1938, Stefan Zweig/Joseph Roth, Payot et rivages, 20213, trad. P. Deshusses ; voir particulièrement la préface de ce dernier.
[11] Voir sur ce point les textes introductifs de J. Le Rider et de K. Renoldner à S. Zweig, L’esprit européen en exil, éd. J. Le Rider et Kl. Renoldner, Bartillat, 2020, trad. J. Le Rider ; ainsi que S. Zweig, Pas de défaite pour l’esprit libre, Albin Michel, 2020, trad. B. Cain-Hérudent ; et la préface de L. Seksik dans cet ouvrage.
[12] Ainsi qu’il l’exprime dans le texte « L’exigence de solidarité », L’esprit européen en exil, op. cit.
[13] Lacan, « Proposition du 9 octobre 1967 », dans Autres écrits.
[14] J. Lacan, Le Séminaire II., 1954-1955, Le moi dans la théorie de Freud, 19 mai 1955.
[15] Sur le fait que le psychanalyste n’en a jamais fini avec son fantasme, voir F. Perrier, La Chaussée d’Antin I.
[16] Gesammelte Werke, II./III., p. 489.
[17] Gesammelte Werke, II./III., p. 110.
[18] O. Mannoni, « L’analyse originelle », dans Clefs pour l’imaginaire ou l’Autre Scène ; Ch. Azouri, « J’ai réussi là où le paranoïaque échoue », Arcanes-érès, coll. « Hypothèses », 2015.
[19] S. Freud (1905), « Fragment d’une analyse d’hystérie (Dora), dans Cinq psychanalyses, Paris, Puf, 1995.
[20] J. Lacan, « Intervention sur le transfert », dans Écrits. Concernant le retournement dialectique du fantasme, voir Jean-Richard Freymann, « À quel banquet nous convie Lacan ? Lacan avec les psychanalystes », dans L’art de la clinique, Toulouse,Arcanes-érès, coll. « Hypothèses », 2013, p. 225-239.
[21] J.-R. Freymann, Éloge de la perte, Arcanes-érès, coll. « Hypothèses ».
[22] A. Didier-Weill, Les trois temps de la Loi.
[23] J.-R. Freymann, Amour et Transfert, Arcanes-érès, coll. « Hypothèses », 2020 (avec des textes de M. Ritter, G. Riedlin, L. Goldsztaub, M. Patris).
[24] Par exemple dans J. Lacan, Le séminaire livre XVI, 1968-1969, D’un Autre à l’autre.
[25] Sur cette question, je me permets de renvoyer à D. Lorrain, « Mythologie de Lacan, Mythologie de Freud, Ephéméride 9, https://fedepsy.org/category/ephemeride/
[26] L’Homme Moïse et la religion monothéiste, trad. C. Heim, Paris, Gallimard, 1986, p. 173, Gesammelte Werke XVI., p. 174.
[27] Ibid., p. 189.
[28] Selon l’expression de l’historien du nazisme J. Chapoutot dans son ouvrage La révolution culturelle nazie.
[29] H. Bredekamp, Aby Warburg, der Indianer.
[30] Citons sa Théorie de l’acte d’image.
[31] C’est une question importante dont j’ai parlé dans mon intervention récente sur Warburg, op. cit.
[32] Concernant Freud et les Lumières, voir É. Roudinesco, Sigmund Freud en son temps et dans le nôtre ; et A. Didier-Weill, Un mystère plus lointain que l’inconscient.
[33] Même si je ne suivrai pas tout à fait l’auteure sur la question de l’homosexualité, car je ne vois pas pour ma part de souhait de normativité dans la revendication par les sujets homosexuels des mêmes droits politiques que les sujets hétérosexuels.
[34] L. Israël, Boiter n’est pas pécher, Arcanes-érès, coll. « Hypothèses », 2010.

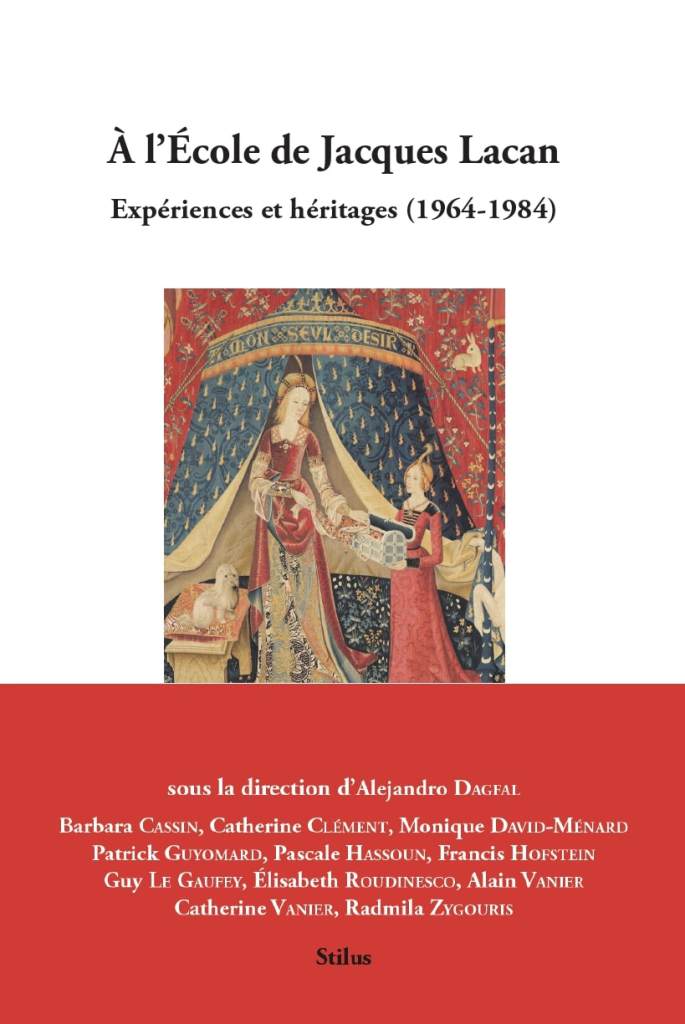
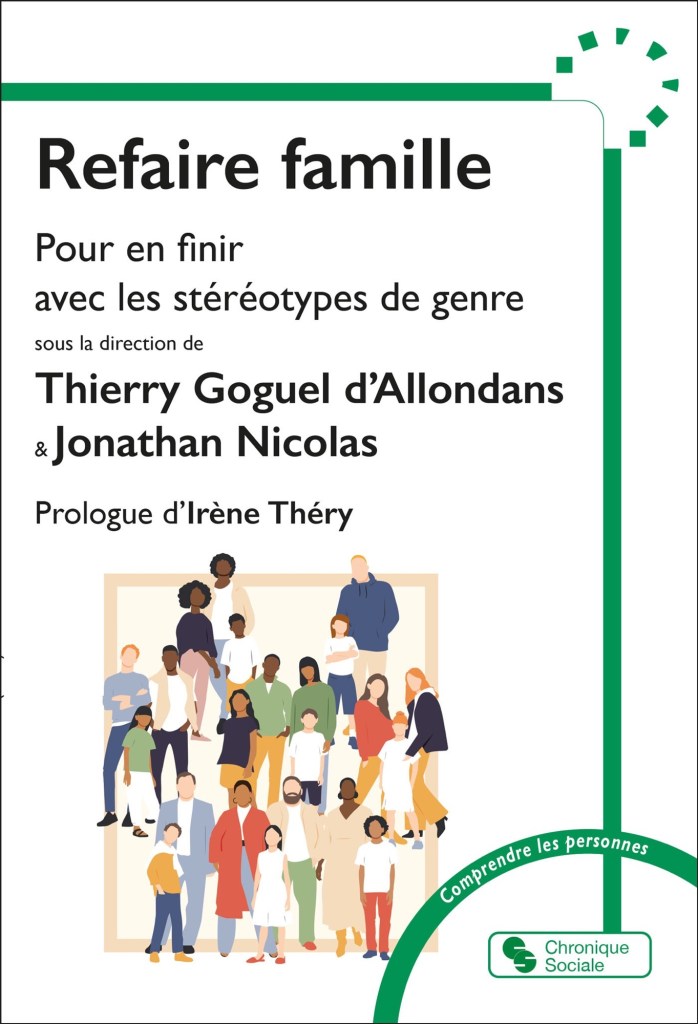
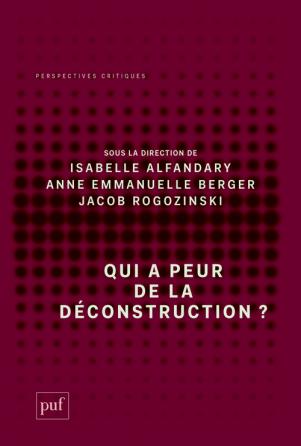
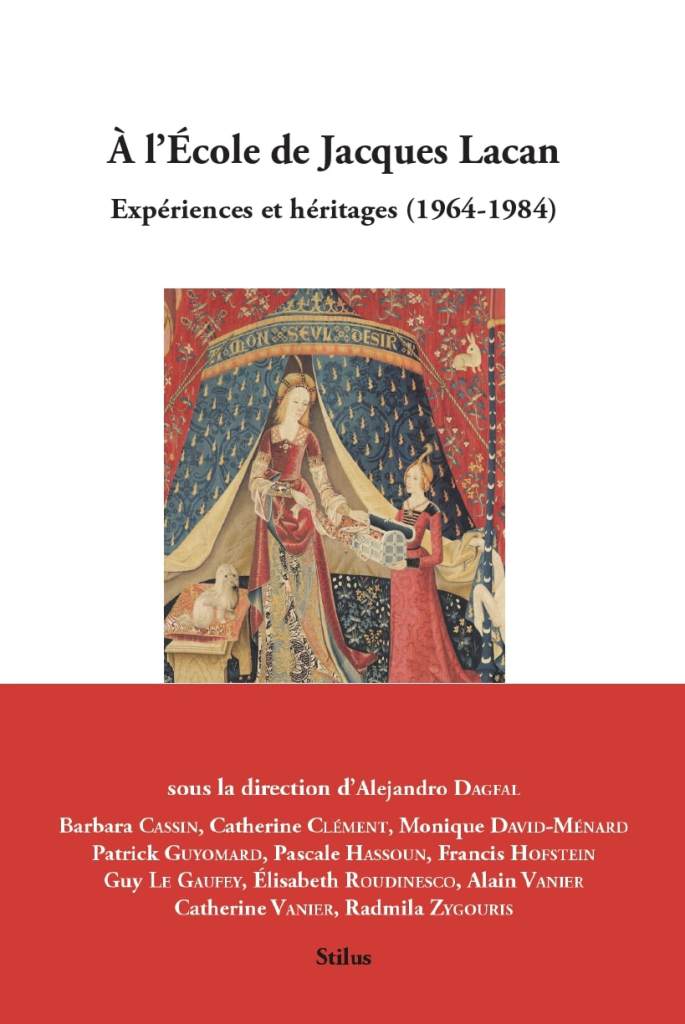
Vous devez être connecté pour poster un commentaire.